1
- Échec Scolaire

- Nouveau Psycho
- Inscrit le 13 Feb 2022
- 112 messages
Un article en 3 parties, je vous en propose seulement la première, car c'est long.
Je peux éventuellement poster la suite.
Loi, contrôle social et régulation [1/3]
**Ce texte est issu de l'ouvrage d'Alain Morel et de Jean-Pierre Couteron : Addictologie, et plus précisément de son chapitre 47, intitulé "Loi, contrôle social et régulation", écrit par Jean-Pierre Couteron, Nathalie Latour et Alain Morel.**
Le contrôle social a de tout temps existé, dans toutes les civilisations. Il fait partie des conditions d’existence d’une société. Historiquement, dans le domaine des drogues et des *« passions »*, les religions servirent à délimiter bons et mauvais usages, en lien avec les pratiques thérapeutiques traditionnelles. Progressivement, avec sa place grandissante dans l’expertise sociale, la découverte des alcaloïdes et l’invention du médicament, la médecine moderne se substitua aux religions pour jouer un rôle croissant dans la définition des bons et mauvais produits, des règles d’usage et des prescriptions médicales *(Courtwright, 2008)*.
En même temps que se dessinaient la responsabilité individuelle et la *« faute »* définie par les interdits, la loi pénale devint l’arme principale du contrôle social des substances. Cette logique de la désignation de la faute sociale et de la sanction pénale comme réponse apparemment adaptée pose aujourd’hui questions *(cf. chapitre 2, « Les sociétés et les drogues »)*, à la fois dans son efficacité *(sa légitimité, sa crédibilité et son équité)* mais aussi dans sa cohérence, avec des mesures qui s’empilent, selon les options retenues par les responsables politiques qui se succèdent *(Morel, Couteron, 2011)*.
Le contrôle social *« formel » (Assailly, Biecheler, 2006)* repose sur des mesures prises par voie réglementaire et législative, visant d’une part l’offre de substances et leur accès, et d’autre part l’usage lui-même. Depuis la fin du XXe siècle, l’application de ces mesures de contrôle de l’offre et de l’accès aux produits qu’elles soient pénales, administratives ou réglementaires, vise une *« régulation »* des usages : limitation des lieux de consommation, contrôle de la distribution, interdiction totale, augmentation des taxes, limitation de la publicité et de la communication, règles de prescription et de délivrance pour les médicaments.
Elles aboutissent à la coexistence entre des substances dont on cherche à limiter l’usage sans totalement les interdire, d’autres qui sont interdites quel que soit le type d’usage et des comportements comme les jeux d’argent dont on essaye de limiter l’abus tout en incitant l’usage.
Nos connaissances d’aujourd’hui imposent de repenser profondément la politique des drogues et son cadre légal. Il y va de l’efficacité de nos interventions en particulier de la prévention, pour diminuer les consommations et leurs dommages. Il en va aussi de l’implication de la société face aux problèmes qu’elle génère pour libérer ses capacités à gagner en maîtrise collective et individuelle.
Il en va tout simplement de la vie de nombreuses personnes. Plus qu’une question de mesures techniques, il s’agit d’un problème de sens, c’est-à-dire d’une politique globale. En clair, faire de la régulation démocratique l’instrument d’un contrôle social modernisé *(Couteron, 2017)*.
#Limiter l’accès au produit : les paradoxes de l’alcool, culture et économie
Si l’on excepte les nombreuses et diverses réglementations qui précédèrent la Révolution française et supprimées en 1791 par la loi d’Allarde, la réglementation sur l’alcool s’inaugure en 1816 sur une visée essentiellement fiscale : l’obligation d’une déclaration d’ouverture.
En 1851, Napoléon III affiche la volonté d’un contrôle administratif avec l’obligation d’une autorisation préalable du préfet pour l’ouverture d’un débit de boissons. La défaite de 1870, attribuée en partie à l’affaiblissement des combattants par l’alcoolisme assimilé à un fléau social, justifie une limitation du nombre des débits de boissons dont le temps se chargera d’atténuer l’application, leur nombre repassant de 280 000 en 1830 à 482 704 en 1913.
##La « défense sociale » contre « le fléau » et les expériences de prohibition
Au-delà des nationalismes et des guerres, les modifications des schémas de lecture de la délinquance fondent les évolutions dans la seconde moitié du XIXe. Grâce aux premières statistiques criminelles, pouvoirs publics et scientifiques pointent la forte proportion d’alcooliques parmi les délinquants.
L’époque voit naître la théorie de la dégénérescence, les enfants d’alcooliques sont prédestinés à devenir alcooliques, *« dégénérés »* et/ou délinquants. En parallèle, l’eugénisme renforce la peur de la multiplication des désordres sociaux, de la dépopulation nationale et de l’altération de la race.
À la fin du XIXe, les positivistes italiens, comme l’école française dite du *« milieu social »*, sont persuadés que l’hygiène publique et privée apporteront l’indispensable assainissement physique et moral de la société. L’orientation sanitaire, philanthropique s’estompe, les médecins développant une lecture médicale de la criminalité, basée sur la notion de dangerosité sociale, qui entraîne la logique de défense sociale et la promotion par les sociétés savantes d’asiles spéciaux pour enfermer *(plus que soigner même si cet objectif est bien présent)* les alcooliques.
Les défaites du début de la guerre de 1914 seront en partie attribuées aux méfaits du *« fléau de l’alcoolisme »*. La loi de 1915 cherchera à *« élever une barrière contre le flot montant de l’alcool et des débits »* par de nouvelles mesures techniques *(classification des débits, péremption des licences, limitation du droit de transport…)*.
Le même lien avec la délinquance légitime le discours de défense de la société et de sa cellule de base, la famille. En Scandinavie et en Amérique du Nord, elle conduira aux lois de prohibition de l’alcool. Ce seront des échecs et elles seront progressivement abrogées. En revanche, des prohibitions ciblées, comme celle de l’absinthe en France, ayant un certain succès, seront maintenues. Les lois de 1915, 1941, 1955 et 1960 jouent ainsi sur l’accès au produit *(notamment par la limitation du nombre des débits et la création de « zones protégées »)* avec un objectif de santé de plus en plus affirmé.
Après la seconde guerre mondiale, le mouvement de *« la défense sociale »* semble s’humaniser, mais les arguments restent similaires : montée et importance du nombre d’alcooliques évalué à 20 % de la population, dégénérescences induites, impact délétère sur les familles et la criminalité conduisent à une proposition de loi visant à créer des asiles de buveurs, débattue en 1948 à l’Assemblée Nationale et aboutissant à la loi sur *« les alcooliques dangereux »* de 1954, pratiquement jamais appliquée et abrogée depuis.
##La loi Évin
En 1991, la loi Évin sera la première vraie loi de santé dans le champ de l’alcool en particulier. Elle met en avant des objectifs de santé, individuels et collectifs. Ses objectifs sont diversifiés.
Le premier sera d’améliorer l’information du consommateur sur le risque alcool ; elle va pour cela imposer l’obligation de faire figurer sur les publicités en faveur des boissons alcooliques un message à caractère sanitaire : *« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. »*
Elle veut aussi réduire l’incitation à la consommation de boissons alcooliques par une stricte limitation des supports autorisés pour la publicité, un encadrement de ses contenus et une limitation du mécénat à des opérations culturelles ou humanitaires.
Enfin, l’objectif de renforcer la réduction de l’offre s’adaptera à la modernité en visant l’interdiction des boissons alcoolisées dans distributeurs automatiques et celle de la vente à emporter, entre 22 heures et 6 heures dans les stations-service. Des limites d’âge vont garantir la protection des mineurs : interdiction de vendre des boissons alcoolisées aux moins de 16 ans et autres interdictions. Ces *« interdits protecteurs »* sont paradoxalement ceux dont l’application est le plus souvent négligée par les autorités.
La loi Évin sera rapidement attaquée : dès 1993, elle est amputée d’une part de son volet alcool sous la pression des lobbies alcooliers. En 2007, l’interdiction de la publicité sur internet ne pourra être obtenue. En 2016, malgré la forte mobilisation des acteurs de santé, un article de loi assouplit les contraintes liées à la publicité pour l’alcool, mettant en avant la mise en valeur de la notion de « savoir-faire, de terroir », de l’histoire ou du patrimoine culturel, de la gastronomie ou des paysages liés à une boisson alcoolique. L’enjeu économique est régulièrement mis en avant, notamment pour réintroduire la vente d’alcool dans les enceintes sportives.
##Les lois de santé publique
La loi relative à la politique de santé publique 2004 a été la première à donner un cadre à cette approche. Elle vise à promouvoir une meilleure application des règles relatives à la publicité en élargissant le nombre d’agents de l’administration chargés de veiller à leur bonne application et en donnant à plus d’associations les moyens d’exercer une vigilance judiciaire. Héritière de la ligue antialcoolique née à la fin du xixe siècle, l’ANPAA*[Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie]* dispose des moyens financiers pour ester en justice, ce qu’elle fait régulièrement, souvent avec succès *(ANPAA, 2013)*, mais sans pouvoir endiguer la communication pro-alcool.
La loi identifie deux populations à protéger particulièrement : les femmes enceintes et les jeunes. Une information sur les effets de la consommation d’alcool lors de la grossesse est apportée par un pictogramme dont la taille et la localisation ne garantissent pas une visibilité suffisante.
La protection des plus jeunes s’appuie sur la taxation des nouvelles boissons alcoolisées aromatisées, dites *« alcopops »*, dans le prolongement du dispositif de 1997 surtaxant les boissons dites *« premix »*. Ce texte a entraîné le doublement du prix de ces boissons et permis de stopper leur émergence. Mais, par ailleurs, les bières à haut dosage d’alcool pénètrent le marché européen sans aucun frein.
D’autres mesures suivront dans le cadre de la loi *« Hôpital Patient Santé Territoire »* de 2009, notamment l’interdiction absolue de la vente d’alcool aux mineurs, ainsi que celle des open bars.
En 2016, la loi de modernisation du système de santé veut renforcer les contrôles et les sanctions liés à la consommation d’alcool par des mineurs, en introduisant un délit d’initiation des jeunes et de provocation directe d’un mineur à la consommation excessive d’alcool. Une enquête conduite en juin 2019 indique que dans près de 60 % des cas, des jeunes sont parvenus à se procurer de l’alcool sans la moindre difficulté*[Sources enquête 66 millions de consommateurs, juin 2019 Alcool : « Pour les mineurs, c’est open bar ! »]*. Veiller à l’application de ces mesures de protection des mineurs semble bien peu mobiliser les forces de l’ordre jusqu’à aujourd’hui.
#Dénormaliser un produit : le cas du tabac
La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi *« Veil »* du 9 juillet 1976. Elle limite la publicité en faveur du tabac à la seule presse écrite et interdit le parrainage des manifestations sportives. Elle introduit un message sanitaire sur les emballages et des interdictions de fumer dans tous les lieux à usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé.
La loi Évin va poursuivre cette dé-normalisation d’un usage de tabac pourtant très banalisé *(Dautzenberg, 2009)*. Fumer est interdit dans des lieux affectés à un usage collectif, mais reste autorisé dans des endroits *« réservés »*.
Cette restriction de lieux va s’accroître : en 2005 fumer est interdit dans les avions et les trains, puis, en 2006 et 2008, la notion de lieux à usage collectif englobe les lieux de travail, cafés, restaurants, casinos, etc.
Les limites posées à la communication vont aussi être renforcées : toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac et des produits dérivés est interdite.
Ces mesures, accompagnées de grandes campagnes médiatiques, de nombreuses actions de terrain et d’un développement d’une offre de soin rénovée *(Lagrue, 2004)* vont produire des premiers résultats, mais avec des limites : cette politique fonctionne mieux avec les consommateurs qui ont le moins de problèmes psychosociaux et elle doit être régulièrement renouvelée pour en conserver l’impact.
En 2014, en s’appuyant sur la convention cadre de lutte antitabac de l’Organisation Mondiale de la Santé et après des résultats encourageants obtenus par plusieurs pays voisins européens, un programme d’actions coordonnées est annoncé par le Président de la République.
Pour obtenir une génération d’adultes sans tabac dans 20 ans, il décline 3 axes : protéger les mineurs, aider les fumeurs à arrêter avec des actions d’information et d’accompagnement et agir sur l’économie du tabac pour la rendre plus transparente et qu’elle contribue à la lutte contre le tabac.
Différentes mesures seront adoptées : l’interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans, une augmentation progressive du prix du tabac, la mise en place d’un paquet neutre, la création d’un fonds de lutte contre le tabac abondée par 64,7 % du prix d’un paquet et 16,38 % de TVA et enfin une grande campagne de mobilisation, le *« Mois sans tabac »* lancée en 2016.
Cette campagne basée sur des messages positifs et mobilisateurs, s’appuie sur le marketing social et mobilise un réseau d’acteurs et de proximité pour les personnes souhaitant bénéficier d’un accompagnement. Cette posture évite l’accentuation de la réprobation sociale à l’encontre des usagers et une excessive judiciarisation de la vie privée, elle facilite l’aide à l’arrêt.
L’arrivée du vapotage va accentuer fortement les bons résultats : la vitesse avec laquelle cette nouvelle pratique s’est installée montre qu’une partie du message sur le risque tabac est bien passé dans l’opinion publique, et que l’accès à des moyens différents et complémentaires pour réduire ou arrêter son usage reste gage de succès *(cf. chapitres 13, « Tabac et addiction » et 43, « L’auto-support »)*.
#Prohiber une substance : le cas des stupéfiants
Les drogues illicites ne l’ont pas toujours été. La consommation d’opium et de cocaïne apparaît marginale dans les débats de la fin XIXe, début du XXe, à l’exception d’une *« épidémie »* de cocaïne observée au début du 1900 à Paris, rapidement enrayée. Les premières mesures législatives d’interdictions et de contrôle, visent classiquement à limiter l’exposition au produit afin de limiter l’abus, sans punir le consommateur *(Yvorel, 1993)*.
Ces mesures sont prises en pleine vague de *« passion des toxiques »*, dans une société, à l’entrée du XXe, partagée entre une romantique fascination pour l’exploration de soi et l’angoisse d’une dégradation morale mettant en danger *« la civilisation »*, et, en France, dans un contexte d’exaltation nationaliste qui va conduire à la première guerre mondiale.
##La naissance de « la guerre à la drogue »
La cassure de la première guerre mondiale provoque le basculement : *« la drogue »* devient cause de dégénérescence, les *« drogués »* en sont des complices prosélytes et des éléments défaillants prêts à trahir à cause de leur asservissement.
Le vin, en revanche, est consacré boisson nationale et est largement distribué dans les tranchées en même temps que le tabac. C’est dans cette période que s’instaure dans les pays occidentaux la dichotomie entre une politique internationale de contrôle des *« stupéfiants »* de plus en plus sévère et dont l’objectif est clairement *« la guerre à la drogue »*, et un soutien *(notamment économique)* au développement de l’usage *« culturel »* d’alcool et de tabac. Le recours au vocable *« stupéfiant »* participe de cette opération : rien ne dit précisément en quoi certaines substances peuvent être qualifiées de stupéfiants et d’autres non, le terme n’étant pas clairement défini, mais il permet de les opposer : il y a l’alcool et le tabac d’une part, les stupéfiants d’autre part.
##La loi de 1970
Le second virage date des années soixante : la toxicomanie va concerner un nouveau public, les jeunes, et s’inscrit dans un contexte de remise en cause des cadres et des valeurs traditionnelles.
Cela renforce la crainte que l’usage de substance contribue à la destruction de la société : la réponse va de nouveau être celle de la défense sociale plus que de la santé.
La pénalisation de l’usage s’explique par la volonté de reprise en main de la jeunesse après 1968, avec un consommateur assimilé à un *« gauchiste »*, et la pression des États-Unis où l’important niveau de consommation et attribué aux activités de la French Connection.
La loi dite *« de 70 »* va être conçue pour ériger les protections jugées nécessaires : pénalisation de l’usage privé *« de stupéfiant »* et droit d’exception tant envers le trafic que la consommation.
Aux yeux de la loi et de la société, l’usager de stupéfiant est l’auteur d’une faute très grave, la police devient un acteur central de la *« lutte contre la drogue »* et les *« drogués »*, et la justice applique les sanctions pénales à la mesure de la faute : les prisons se remplissent d’« ILS »[Infractions à la Loi sur les Stupéfiants]*. L’usager n’a le choix qu’entre un statut de malade ou de délinquant.
##Judiciarisation et médicalisation de l’usage ou régulation et réduction des risques ?
C’est une maladie, le sida, qui, dans les années 1980-1990, fera apparaître un nouveau paradigme : celui du risque et de sa réduction. La mise en place de la réduction des risques s’effectuera sans changer le statut légal des drogues ni la pénalisation de l’usage, ce qui va en limiter la portée *(cf. chapitre 3, « La réduction des risques, fondement d’une nouvelle addictologie »)*.
Le virage *« addiction »* des années 1990-2000 va préciser les conséquences sanitaires des usages, notamment ceux des drogues licites, en lien avec les différents cancers *(Plan cancer de 2006)*. Il en découlera de nouveaux impératifs de santé publique, peu contestables, et une extension du processus de contrôle légal à l’alcool et au tabac.
Des circulaires successives du ministère de la Justice vont préconiser une réponse pénale graduée en fonction de la consommation de la personne interpellée *(classement avec rappel à la loi, classement avec orientation sanitaire ou sociale, injonction thérapeutique et poursuites pénales pour ceux qui ne veulent pas se soumettre aux alternatives)*.
La loi du 5 mars 2007 veut développer la sanction systématique de tout fait d’usage, notamment par des stages payants de *« sensibilisation sur l’usage du cannabis et des autres drogues illicites » (Gautron, Raphalen, 2013)*, et en instaurant les médecins-relais entre les professionnels de santé et l’autorité judiciaire en cas d’injonction thérapeutique ou de soins sous obligation, y compris pour des problèmes d’alcool.
Malgré une évaluation critique, ces dispositifs seront maintenus, participant à l’épaississement du mille-feuille de mesures. Le Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 reconnaît que la *« réponse pénale actuelle à l’usage des stupéfiants n’apparaît plus efficace »*.
Et cela alors que *« l’activité des services répressifs a fortement progressé en ce domaine depuis la loi de 1970 ». « Elle a été multipliée par 50 entre 1970 et 2013 (avec un quasi-doublement depuis 2000) pour atteindre 180 000 personnes en 2016 »*. Le document note que la *« procédure relative au traitement de ces infractions consomme, pour les forces de l’ordre, environ 1,2 million d’heures par an »*.
Dans bien d’autres domaines, ce constat inviterait à changer de politique. Ici, les orientations politiques ne cessent de poursuivre et renforcer la logique répressive. En 2018, malgré une mobilisation importante de la société civile, le législateur décide d’instaurer une amende forfaitaire délictuelle dans l’objectif d’offrir une systématisation des peines et plus grande lisibilité de l’interdit pénal.
La mesure ne remet pas en cause le cadre légal en vigueur, la peine de prison étant maintenue en cas de récidive et ne constitue donc en rien une *« dépénalisation »[Livre blanc inter-associatif sur l’article 37 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, novembre 2018]*. Cette relance régulière de l’approche principalement policière et répressive fait craindre un renforcement des stigmatisations, discriminations sociales et raciales.
Loin des pratiques professionnelles et des réalités de terrain, le déséquilibre entre l’approche pénale de l’usage comme transgression et l’approche thérapeutique (médico-psycho-sociale) de la prise de risques n’est pas modifié. Les responsables politiques français restent craintifs vis-à-vis de toute tentative de rééquilibrage, vite considérée comme « un aveu de faiblesse » dans la « lutte contre » les drogues et leurs usages. De même, la notion de « stupéfiant » amalgamant des substances n’ayant rien de commun - pas même une dangerosité supérieure aux autres -, n’est pas remise en cause et continue de fonder la loi, y compris pour des nouvelles substances apparues depuis les années 70.
Je peux éventuellement poster la suite.
Loi, contrôle social et régulation [1/3]
**Ce texte est issu de l'ouvrage d'Alain Morel et de Jean-Pierre Couteron : Addictologie, et plus précisément de son chapitre 47, intitulé "Loi, contrôle social et régulation", écrit par Jean-Pierre Couteron, Nathalie Latour et Alain Morel.**
Le contrôle social a de tout temps existé, dans toutes les civilisations. Il fait partie des conditions d’existence d’une société. Historiquement, dans le domaine des drogues et des *« passions »*, les religions servirent à délimiter bons et mauvais usages, en lien avec les pratiques thérapeutiques traditionnelles. Progressivement, avec sa place grandissante dans l’expertise sociale, la découverte des alcaloïdes et l’invention du médicament, la médecine moderne se substitua aux religions pour jouer un rôle croissant dans la définition des bons et mauvais produits, des règles d’usage et des prescriptions médicales *(Courtwright, 2008)*.
En même temps que se dessinaient la responsabilité individuelle et la *« faute »* définie par les interdits, la loi pénale devint l’arme principale du contrôle social des substances. Cette logique de la désignation de la faute sociale et de la sanction pénale comme réponse apparemment adaptée pose aujourd’hui questions *(cf. chapitre 2, « Les sociétés et les drogues »)*, à la fois dans son efficacité *(sa légitimité, sa crédibilité et son équité)* mais aussi dans sa cohérence, avec des mesures qui s’empilent, selon les options retenues par les responsables politiques qui se succèdent *(Morel, Couteron, 2011)*.
Le contrôle social *« formel » (Assailly, Biecheler, 2006)* repose sur des mesures prises par voie réglementaire et législative, visant d’une part l’offre de substances et leur accès, et d’autre part l’usage lui-même. Depuis la fin du XXe siècle, l’application de ces mesures de contrôle de l’offre et de l’accès aux produits qu’elles soient pénales, administratives ou réglementaires, vise une *« régulation »* des usages : limitation des lieux de consommation, contrôle de la distribution, interdiction totale, augmentation des taxes, limitation de la publicité et de la communication, règles de prescription et de délivrance pour les médicaments.
Elles aboutissent à la coexistence entre des substances dont on cherche à limiter l’usage sans totalement les interdire, d’autres qui sont interdites quel que soit le type d’usage et des comportements comme les jeux d’argent dont on essaye de limiter l’abus tout en incitant l’usage.
Nos connaissances d’aujourd’hui imposent de repenser profondément la politique des drogues et son cadre légal. Il y va de l’efficacité de nos interventions en particulier de la prévention, pour diminuer les consommations et leurs dommages. Il en va aussi de l’implication de la société face aux problèmes qu’elle génère pour libérer ses capacités à gagner en maîtrise collective et individuelle.
Il en va tout simplement de la vie de nombreuses personnes. Plus qu’une question de mesures techniques, il s’agit d’un problème de sens, c’est-à-dire d’une politique globale. En clair, faire de la régulation démocratique l’instrument d’un contrôle social modernisé *(Couteron, 2017)*.
#Limiter l’accès au produit : les paradoxes de l’alcool, culture et économie
Si l’on excepte les nombreuses et diverses réglementations qui précédèrent la Révolution française et supprimées en 1791 par la loi d’Allarde, la réglementation sur l’alcool s’inaugure en 1816 sur une visée essentiellement fiscale : l’obligation d’une déclaration d’ouverture.
En 1851, Napoléon III affiche la volonté d’un contrôle administratif avec l’obligation d’une autorisation préalable du préfet pour l’ouverture d’un débit de boissons. La défaite de 1870, attribuée en partie à l’affaiblissement des combattants par l’alcoolisme assimilé à un fléau social, justifie une limitation du nombre des débits de boissons dont le temps se chargera d’atténuer l’application, leur nombre repassant de 280 000 en 1830 à 482 704 en 1913.
##La « défense sociale » contre « le fléau » et les expériences de prohibition
Au-delà des nationalismes et des guerres, les modifications des schémas de lecture de la délinquance fondent les évolutions dans la seconde moitié du XIXe. Grâce aux premières statistiques criminelles, pouvoirs publics et scientifiques pointent la forte proportion d’alcooliques parmi les délinquants.
L’époque voit naître la théorie de la dégénérescence, les enfants d’alcooliques sont prédestinés à devenir alcooliques, *« dégénérés »* et/ou délinquants. En parallèle, l’eugénisme renforce la peur de la multiplication des désordres sociaux, de la dépopulation nationale et de l’altération de la race.
À la fin du XIXe, les positivistes italiens, comme l’école française dite du *« milieu social »*, sont persuadés que l’hygiène publique et privée apporteront l’indispensable assainissement physique et moral de la société. L’orientation sanitaire, philanthropique s’estompe, les médecins développant une lecture médicale de la criminalité, basée sur la notion de dangerosité sociale, qui entraîne la logique de défense sociale et la promotion par les sociétés savantes d’asiles spéciaux pour enfermer *(plus que soigner même si cet objectif est bien présent)* les alcooliques.
Les défaites du début de la guerre de 1914 seront en partie attribuées aux méfaits du *« fléau de l’alcoolisme »*. La loi de 1915 cherchera à *« élever une barrière contre le flot montant de l’alcool et des débits »* par de nouvelles mesures techniques *(classification des débits, péremption des licences, limitation du droit de transport…)*.
Le même lien avec la délinquance légitime le discours de défense de la société et de sa cellule de base, la famille. En Scandinavie et en Amérique du Nord, elle conduira aux lois de prohibition de l’alcool. Ce seront des échecs et elles seront progressivement abrogées. En revanche, des prohibitions ciblées, comme celle de l’absinthe en France, ayant un certain succès, seront maintenues. Les lois de 1915, 1941, 1955 et 1960 jouent ainsi sur l’accès au produit *(notamment par la limitation du nombre des débits et la création de « zones protégées »)* avec un objectif de santé de plus en plus affirmé.
Après la seconde guerre mondiale, le mouvement de *« la défense sociale »* semble s’humaniser, mais les arguments restent similaires : montée et importance du nombre d’alcooliques évalué à 20 % de la population, dégénérescences induites, impact délétère sur les familles et la criminalité conduisent à une proposition de loi visant à créer des asiles de buveurs, débattue en 1948 à l’Assemblée Nationale et aboutissant à la loi sur *« les alcooliques dangereux »* de 1954, pratiquement jamais appliquée et abrogée depuis.
##La loi Évin
En 1991, la loi Évin sera la première vraie loi de santé dans le champ de l’alcool en particulier. Elle met en avant des objectifs de santé, individuels et collectifs. Ses objectifs sont diversifiés.
Le premier sera d’améliorer l’information du consommateur sur le risque alcool ; elle va pour cela imposer l’obligation de faire figurer sur les publicités en faveur des boissons alcooliques un message à caractère sanitaire : *« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. »*
Elle veut aussi réduire l’incitation à la consommation de boissons alcooliques par une stricte limitation des supports autorisés pour la publicité, un encadrement de ses contenus et une limitation du mécénat à des opérations culturelles ou humanitaires.
Enfin, l’objectif de renforcer la réduction de l’offre s’adaptera à la modernité en visant l’interdiction des boissons alcoolisées dans distributeurs automatiques et celle de la vente à emporter, entre 22 heures et 6 heures dans les stations-service. Des limites d’âge vont garantir la protection des mineurs : interdiction de vendre des boissons alcoolisées aux moins de 16 ans et autres interdictions. Ces *« interdits protecteurs »* sont paradoxalement ceux dont l’application est le plus souvent négligée par les autorités.
La loi Évin sera rapidement attaquée : dès 1993, elle est amputée d’une part de son volet alcool sous la pression des lobbies alcooliers. En 2007, l’interdiction de la publicité sur internet ne pourra être obtenue. En 2016, malgré la forte mobilisation des acteurs de santé, un article de loi assouplit les contraintes liées à la publicité pour l’alcool, mettant en avant la mise en valeur de la notion de « savoir-faire, de terroir », de l’histoire ou du patrimoine culturel, de la gastronomie ou des paysages liés à une boisson alcoolique. L’enjeu économique est régulièrement mis en avant, notamment pour réintroduire la vente d’alcool dans les enceintes sportives.
##Les lois de santé publique
La loi relative à la politique de santé publique 2004 a été la première à donner un cadre à cette approche. Elle vise à promouvoir une meilleure application des règles relatives à la publicité en élargissant le nombre d’agents de l’administration chargés de veiller à leur bonne application et en donnant à plus d’associations les moyens d’exercer une vigilance judiciaire. Héritière de la ligue antialcoolique née à la fin du xixe siècle, l’ANPAA*[Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie]* dispose des moyens financiers pour ester en justice, ce qu’elle fait régulièrement, souvent avec succès *(ANPAA, 2013)*, mais sans pouvoir endiguer la communication pro-alcool.
La loi identifie deux populations à protéger particulièrement : les femmes enceintes et les jeunes. Une information sur les effets de la consommation d’alcool lors de la grossesse est apportée par un pictogramme dont la taille et la localisation ne garantissent pas une visibilité suffisante.
La protection des plus jeunes s’appuie sur la taxation des nouvelles boissons alcoolisées aromatisées, dites *« alcopops »*, dans le prolongement du dispositif de 1997 surtaxant les boissons dites *« premix »*. Ce texte a entraîné le doublement du prix de ces boissons et permis de stopper leur émergence. Mais, par ailleurs, les bières à haut dosage d’alcool pénètrent le marché européen sans aucun frein.
D’autres mesures suivront dans le cadre de la loi *« Hôpital Patient Santé Territoire »* de 2009, notamment l’interdiction absolue de la vente d’alcool aux mineurs, ainsi que celle des open bars.
En 2016, la loi de modernisation du système de santé veut renforcer les contrôles et les sanctions liés à la consommation d’alcool par des mineurs, en introduisant un délit d’initiation des jeunes et de provocation directe d’un mineur à la consommation excessive d’alcool. Une enquête conduite en juin 2019 indique que dans près de 60 % des cas, des jeunes sont parvenus à se procurer de l’alcool sans la moindre difficulté*[Sources enquête 66 millions de consommateurs, juin 2019 Alcool : « Pour les mineurs, c’est open bar ! »]*. Veiller à l’application de ces mesures de protection des mineurs semble bien peu mobiliser les forces de l’ordre jusqu’à aujourd’hui.
#Dénormaliser un produit : le cas du tabac
La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi *« Veil »* du 9 juillet 1976. Elle limite la publicité en faveur du tabac à la seule presse écrite et interdit le parrainage des manifestations sportives. Elle introduit un message sanitaire sur les emballages et des interdictions de fumer dans tous les lieux à usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé.
La loi Évin va poursuivre cette dé-normalisation d’un usage de tabac pourtant très banalisé *(Dautzenberg, 2009)*. Fumer est interdit dans des lieux affectés à un usage collectif, mais reste autorisé dans des endroits *« réservés »*.
Cette restriction de lieux va s’accroître : en 2005 fumer est interdit dans les avions et les trains, puis, en 2006 et 2008, la notion de lieux à usage collectif englobe les lieux de travail, cafés, restaurants, casinos, etc.
Les limites posées à la communication vont aussi être renforcées : toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac et des produits dérivés est interdite.
Ces mesures, accompagnées de grandes campagnes médiatiques, de nombreuses actions de terrain et d’un développement d’une offre de soin rénovée *(Lagrue, 2004)* vont produire des premiers résultats, mais avec des limites : cette politique fonctionne mieux avec les consommateurs qui ont le moins de problèmes psychosociaux et elle doit être régulièrement renouvelée pour en conserver l’impact.
En 2014, en s’appuyant sur la convention cadre de lutte antitabac de l’Organisation Mondiale de la Santé et après des résultats encourageants obtenus par plusieurs pays voisins européens, un programme d’actions coordonnées est annoncé par le Président de la République.
Pour obtenir une génération d’adultes sans tabac dans 20 ans, il décline 3 axes : protéger les mineurs, aider les fumeurs à arrêter avec des actions d’information et d’accompagnement et agir sur l’économie du tabac pour la rendre plus transparente et qu’elle contribue à la lutte contre le tabac.
Différentes mesures seront adoptées : l’interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans, une augmentation progressive du prix du tabac, la mise en place d’un paquet neutre, la création d’un fonds de lutte contre le tabac abondée par 64,7 % du prix d’un paquet et 16,38 % de TVA et enfin une grande campagne de mobilisation, le *« Mois sans tabac »* lancée en 2016.
Cette campagne basée sur des messages positifs et mobilisateurs, s’appuie sur le marketing social et mobilise un réseau d’acteurs et de proximité pour les personnes souhaitant bénéficier d’un accompagnement. Cette posture évite l’accentuation de la réprobation sociale à l’encontre des usagers et une excessive judiciarisation de la vie privée, elle facilite l’aide à l’arrêt.
L’arrivée du vapotage va accentuer fortement les bons résultats : la vitesse avec laquelle cette nouvelle pratique s’est installée montre qu’une partie du message sur le risque tabac est bien passé dans l’opinion publique, et que l’accès à des moyens différents et complémentaires pour réduire ou arrêter son usage reste gage de succès *(cf. chapitres 13, « Tabac et addiction » et 43, « L’auto-support »)*.
#Prohiber une substance : le cas des stupéfiants
Les drogues illicites ne l’ont pas toujours été. La consommation d’opium et de cocaïne apparaît marginale dans les débats de la fin XIXe, début du XXe, à l’exception d’une *« épidémie »* de cocaïne observée au début du 1900 à Paris, rapidement enrayée. Les premières mesures législatives d’interdictions et de contrôle, visent classiquement à limiter l’exposition au produit afin de limiter l’abus, sans punir le consommateur *(Yvorel, 1993)*.
Ces mesures sont prises en pleine vague de *« passion des toxiques »*, dans une société, à l’entrée du XXe, partagée entre une romantique fascination pour l’exploration de soi et l’angoisse d’une dégradation morale mettant en danger *« la civilisation »*, et, en France, dans un contexte d’exaltation nationaliste qui va conduire à la première guerre mondiale.
##La naissance de « la guerre à la drogue »
La cassure de la première guerre mondiale provoque le basculement : *« la drogue »* devient cause de dégénérescence, les *« drogués »* en sont des complices prosélytes et des éléments défaillants prêts à trahir à cause de leur asservissement.
Le vin, en revanche, est consacré boisson nationale et est largement distribué dans les tranchées en même temps que le tabac. C’est dans cette période que s’instaure dans les pays occidentaux la dichotomie entre une politique internationale de contrôle des *« stupéfiants »* de plus en plus sévère et dont l’objectif est clairement *« la guerre à la drogue »*, et un soutien *(notamment économique)* au développement de l’usage *« culturel »* d’alcool et de tabac. Le recours au vocable *« stupéfiant »* participe de cette opération : rien ne dit précisément en quoi certaines substances peuvent être qualifiées de stupéfiants et d’autres non, le terme n’étant pas clairement défini, mais il permet de les opposer : il y a l’alcool et le tabac d’une part, les stupéfiants d’autre part.
##La loi de 1970
Le second virage date des années soixante : la toxicomanie va concerner un nouveau public, les jeunes, et s’inscrit dans un contexte de remise en cause des cadres et des valeurs traditionnelles.
Cela renforce la crainte que l’usage de substance contribue à la destruction de la société : la réponse va de nouveau être celle de la défense sociale plus que de la santé.
La pénalisation de l’usage s’explique par la volonté de reprise en main de la jeunesse après 1968, avec un consommateur assimilé à un *« gauchiste »*, et la pression des États-Unis où l’important niveau de consommation et attribué aux activités de la French Connection.
La loi dite *« de 70 »* va être conçue pour ériger les protections jugées nécessaires : pénalisation de l’usage privé *« de stupéfiant »* et droit d’exception tant envers le trafic que la consommation.
Aux yeux de la loi et de la société, l’usager de stupéfiant est l’auteur d’une faute très grave, la police devient un acteur central de la *« lutte contre la drogue »* et les *« drogués »*, et la justice applique les sanctions pénales à la mesure de la faute : les prisons se remplissent d’« ILS »[Infractions à la Loi sur les Stupéfiants]*. L’usager n’a le choix qu’entre un statut de malade ou de délinquant.
##Judiciarisation et médicalisation de l’usage ou régulation et réduction des risques ?
C’est une maladie, le sida, qui, dans les années 1980-1990, fera apparaître un nouveau paradigme : celui du risque et de sa réduction. La mise en place de la réduction des risques s’effectuera sans changer le statut légal des drogues ni la pénalisation de l’usage, ce qui va en limiter la portée *(cf. chapitre 3, « La réduction des risques, fondement d’une nouvelle addictologie »)*.
Le virage *« addiction »* des années 1990-2000 va préciser les conséquences sanitaires des usages, notamment ceux des drogues licites, en lien avec les différents cancers *(Plan cancer de 2006)*. Il en découlera de nouveaux impératifs de santé publique, peu contestables, et une extension du processus de contrôle légal à l’alcool et au tabac.
Des circulaires successives du ministère de la Justice vont préconiser une réponse pénale graduée en fonction de la consommation de la personne interpellée *(classement avec rappel à la loi, classement avec orientation sanitaire ou sociale, injonction thérapeutique et poursuites pénales pour ceux qui ne veulent pas se soumettre aux alternatives)*.
La loi du 5 mars 2007 veut développer la sanction systématique de tout fait d’usage, notamment par des stages payants de *« sensibilisation sur l’usage du cannabis et des autres drogues illicites » (Gautron, Raphalen, 2013)*, et en instaurant les médecins-relais entre les professionnels de santé et l’autorité judiciaire en cas d’injonction thérapeutique ou de soins sous obligation, y compris pour des problèmes d’alcool.
Malgré une évaluation critique, ces dispositifs seront maintenus, participant à l’épaississement du mille-feuille de mesures. Le Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 reconnaît que la *« réponse pénale actuelle à l’usage des stupéfiants n’apparaît plus efficace »*.
Et cela alors que *« l’activité des services répressifs a fortement progressé en ce domaine depuis la loi de 1970 ». « Elle a été multipliée par 50 entre 1970 et 2013 (avec un quasi-doublement depuis 2000) pour atteindre 180 000 personnes en 2016 »*. Le document note que la *« procédure relative au traitement de ces infractions consomme, pour les forces de l’ordre, environ 1,2 million d’heures par an »*.
Dans bien d’autres domaines, ce constat inviterait à changer de politique. Ici, les orientations politiques ne cessent de poursuivre et renforcer la logique répressive. En 2018, malgré une mobilisation importante de la société civile, le législateur décide d’instaurer une amende forfaitaire délictuelle dans l’objectif d’offrir une systématisation des peines et plus grande lisibilité de l’interdit pénal.
La mesure ne remet pas en cause le cadre légal en vigueur, la peine de prison étant maintenue en cas de récidive et ne constitue donc en rien une *« dépénalisation »[Livre blanc inter-associatif sur l’article 37 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, novembre 2018]*. Cette relance régulière de l’approche principalement policière et répressive fait craindre un renforcement des stigmatisations, discriminations sociales et raciales.
Loin des pratiques professionnelles et des réalités de terrain, le déséquilibre entre l’approche pénale de l’usage comme transgression et l’approche thérapeutique (médico-psycho-sociale) de la prise de risques n’est pas modifié. Les responsables politiques français restent craintifs vis-à-vis de toute tentative de rééquilibrage, vite considérée comme « un aveu de faiblesse » dans la « lutte contre » les drogues et leurs usages. De même, la notion de « stupéfiant » amalgamant des substances n’ayant rien de commun - pas même une dangerosité supérieure aux autres -, n’est pas remise en cause et continue de fonder la loi, y compris pour des nouvelles substances apparues depuis les années 70.
Hors ligne
- Échec Scolaire

- Nouveau Psycho
- Inscrit le 13 Feb 2022
- 112 messages
Finalement, voici au moins la deuxième partie car c'est intéressant.
Loi, contrôle social et régulation [2/3] : mesures envers les consommateurs et la régulation comme convergence des priorités et cohérence des actions
**Ce texte est issu de l'ouvrage d'Alain Morel et de Jean-Pierre Couteron : Addictologie, et plus précisément de son chapitre 47, intitulé "Loi, contrôle social et régulation", écrit par Jean-Pierre Couteron, Nathalie Latour et Alain Morel.**
#Mesures envers les consommateurs
Une partie des mesures de contrôle concernent les producteurs ou les vendeurs. D’autres s’intéressent à l’usager, fixant des limites d’âge, de lieu, d’horaire, de circonstances d’usage, jouant sur les tarifs pour restreindre plus ou moins l’accès.
##La conduite automobile
Conduire sous l’empire d’un état alcoolique est un délit réprimé depuis 1965 en France. Un décret de 1995 fixe le taux limite de l’alcoolémie légalement tolérée à 0,5 g/litre de sang et de ≥ 0,2 g d’alcool par litre de sang pour les nouveaux conducteurs et les conducteurs de transport en commun. En cas d’accident ayant entraîné des blessures ou un décès, les peines sont aggravées et peuvent atteindre sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende pour homicide involontaire.
La détection massive de l’alcoolémie au volant *(8 millions de dépistages par an sur les routes ces dernières années)* fait l’essentiel de la politique de prévention de l’accidentalité routière liée à l’alcool, beaucoup restant à faire pour développer d’autres types d’actions *(Assailly, Biechler, 2006)*. La même démarche a été adoptée en 2003 envers l’usage de stupéfiants au volant et a conduit à un certain nombre de sanctions pénales y compris la prison.
Et s’il n’est pas l’objet d’une détection, l’usage du téléphone portable est lui aussi maintenant réglementé en voiture. Un nouveau dispositif veut aussi associer une part de responsabilisation à la sanction : en cas d’infraction routière liée à l’alcool, le droit de conduire est limité à un véhicule équipé d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage *(EAD)*. Selon les cas, il s’agit d’une décision du préfet, du juge ou après avis médical. L’obligation de conduire un véhicule équipé d’un EAD s’accompagne d’un programme éducatif spécifique.
##Consommation sur les lieux d’activité
En milieu de travail, le Code du travail ainsi que les réglementations internes des entreprises ont évolué vers une interdiction totale de la consommation de tabac, la quasi-disparition des *« pots »* alcoolisés *(voire le décret de juillet 2014 qui autorise l’employeur à les interdire « lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale »)* et un accroissement du recours à des dépistages biologiques qui a nécessité différentes tentatives d’encadrement éthiques et réglementaires.
Dans plusieurs établissements scolaires français, outre l’interdiction de consommation du tabac et des autres drogues, des conventions avec des consultations jeunes consommateurs *(CJC)* prévoient parfois l’instauration d’obligations de rencontre des élèves usagers de cannabis avec un intervenant spécialisé. D’autres privilégient des actions *« coup de poing »*, souvent médiatisées *(interventions policières avec chiens détecteurs, etc.)*.
Malgré une expertise collective de l’INSERM en 2014 sur les conduites addictives des jeunes, donnant des indications claires sur les actions probantes et non probantes, ce type d’intervention perdure en lien avec des séances d’information, là où les programmes multidimensionnels et basés sur les compétences psycho-sociales implantés dans un environnement favorable (cohérence des mesures mises en place dans un établissement) reste encore au stade des balbutiements.
C’est dans le monde du travail que l’évolution semble la plus manifeste : les usages de substances psychoactives deviennent un enjeu et intègrent les plans de prévention des risques psycho-sociaux, même si tous les tabous ne sont pas levés. La prévention des conduites addictives, introduite dans le 3e plan santé au travail 2016-2020, a fait l’objet d’un chapitre important du plan de mobilisation contre les addictions de la MILDECA *(2019)*.
S’agissant de l’éventuelle révision de la réglementation sur la consommation d’alcool au travail en vue d’une interdiction clairement posée, le plan indique que « le renforcement de l’interdit n’est pas ressorti comme le levier à privilégier » pour répondre à cette préoccupation des entreprises, l’accent devrait plutôt être mis sur des actions de prévention auprès des salariés, ainsi que sur la clarification de la responsabilité de l’employeur. Reste encore à dépasser une conception limitée au seul « repérage » dans une logique médicale de dépistage, pour intégrer la prise en compte des liens entre organisation du travail et usage *(cf. chapitre 27, « Travail et addictions »)*.
##L’usage public
En matière d’usage public, outre la restriction progressive de la consommation de tabac dans les lieux recevant du public, les nuisances dues aux mégots justifient certaines des mesures de limitation et de pénalisation de l’usage.
Après *« les plages sans tabac »*, et de plus en plus des parcs ou espace verts sans tabac, des municipalités sont de plus en plus nombreuses à prendre des arrêtés restreignant les lieux de consommation d’alcool pour des raisons d’ordre public et de nuisances. L’ivresse publique et manifeste (IPM) est une infraction depuis 1873.
Elle est régie par le Code de la santé publique et donne lieu à près de 80 000 interpellations par an, accompagnées d’une rétention en cellule *« de dégrisement »*. L’usage de stupéfiants reste l’objet d’interdiction et de pénalisation selon un régime de prohibition totale fixé par la loi de 1970.
Avec le même objectif d’un meilleur contrôle de l’usage, de récentes expériences internationales de légalisation du cannabis proposent différents modèles, entre grande liberté et interdit de consommer dans l’espace public.
#Informer pour dissuader
Dans les années soixante-dix, avec l’interdit pénal *(drogues illicites)* et une limitation de l’accès à l’alcool, l’information sur les dangers devint quasi synonyme de prévention. Il s’agissait de délivrer des messages forts, montrant les conséquences négatives, suscitant peur et opprobre afin de déclencher des réflexes d’autoprotection pour faire adopter des comportements d’abstinence pour les drogues illicites et un usage contrôlé pour l’alcool, tandis que le tabac restait oublié.
Cette prévention repose sur *« une politique de l’ignorance »*, les personnes devant adhérer aux messages qui leur sont délivrés sans s’interroger. Adaptée pour assurer la reproduction de normes et de comportements, suffisante pour gérer des modèles de comportement simples, nécessitant le recours à l’expérience acquise par les générations précédentes, elle fonctionne mal face à des problèmes complexes, en lien avec l’avancée de la société, nécessitant de nouveaux modèles de comportement et leur appropriation *(Low, 1994)*.
C’est le cas de l’usage de substances psychoactives, l’adoption de comportements adaptés pour y faire face ne peut se résumer à la simple reproduction d’une norme de refus de ce qui serait dangereux ou interdit. La culture de la performance, la banalisation de la solution chimique dans la vie quotidienne, la montée de l’hédonisme viennent largement brouiller les repères.
Une information tout à la fois moins complaisante et plus pertinente s’est peu à peu mise en place. Ainsi, pour l’alcool et le tabac, un gros travail de dévoilement des conséquences négatives de l’usage s’est révélé nécessaire.
Succédant à l’INPES, Santé Publique France conduit des campagnes sur l’alcool basées sur la RdR *(par exemple la campagne de 2013 pour « dire non au verre de trop »)*. D’autres campagnes comme *« mois sans tabac »* associent la logique motivationnelle à des actions de proximité, et encore récemment, une campagne pour diffuser les nouveaux repères de consommation de l’alcool.
La campagne s’est dotée d’un volet dit *« grand public »*, et d’un volet plus centré sur les médecins généralistes, acteurs du premier recours. Le lien entre tabagisme et cancer, le contenu exact d’une cigarette, le rôle de la combustion, sont venus casser l’image trompeuse installée par la publicité, tout en permettant des issues nouvelles *(vapotage par exemple, n’utilisant ni tabac ni combustion)*.
Pour l’alcool, de la même façon, le lien avec les cancers et d’autres maladies a pu être documenté. Mais aussi l’impact du binge-driking, des *« trous noirs »* et autres *« black-out »*, des usages précoces, etc. C’est toute une banalisation de l’alcool organisée par le marketing industriel qui est ainsi déstabilisée, malgré le peu de moyen disponible pour ces informations. De même, sur le cannabis, son impact est à la fois mieux décrit et plus précisément expliqué : rôle sur le cerveau, responsabilité des différents cannabinoides, précocité et intensité des usages. Ces données plus précises démodent une vision « diabolisant » le produit au profit d’informations adaptées.
En janvier 2019, des associations de professionnels, dont la Fédération Addiction, ont relayé en France l’initiative associative anglaise du Dry January qui consiste à passer un mois de janvier *« sobre »*, afin de récupérer des excès de la fin d’année et d’apprendre à moins consommer de l’alcool.
Contrairement au StopOctober qui invite à stopper l’usage du tabac pour en devenir abstinent, Dry January est une façon d’expérimenter les bienfaits d’une moindre consommation d’alcool. Face au début de frémissement dans une partie de l’opinion, les pouvoirs publics ont annoncé le reprendre officiellement pour 2020 avec son pilotage confié à Santé Publique France.
Beaucoup d’espoirs d’un changement de niveau de ces politiques reposent sur les crédits apportés par le nouveau *« Fond Addiction »* s’il permet de soutenir le développement et la cohérence des actions d’information, programmes de prévention et actions de proximité, portées par différents acteurs.
#Réguler : convergence des priorités et cohérence des actions
##Interdire et soigner, une réponse incomplète
La nécessité de poser des limites ne fait pas question, au regard des effets spécifiques de ces substances. Mais quelles limites et s’appliquant à qui et à quoi ? Il y a un réel besoin d’interroger où et comment se construisent les limites qui peuvent réguler l’usage, d’autant que notre société du sans-limite et de l’accès permanent, ne cesse techniquement de les estomper ou de les transformer *(cf. chapitre 11, « Modernité et addictions : la société addictogène »)*.
En confier l’établissement à la seule loi pénale, en espérer la correction des excès de la seule alternative soin/sanction ne peut qu’interroger sur l’incohérence d’une évolution où, *« en abandonnant son rôle régulateur pour inciter à l’usage, notre société pousse à l’extrême le paradoxe de promouvoir ce que dans le même temps elle réprime » (Couteron, 2009)*.
Le binôme médicalisation/pénalisation ne doit-il pas accepter de se compléter, comme il a commencé à le faire, même a minima, avec la réduction des risques et l’intervention précoce ? Réguler l’usage peut-il se faire sans oser aller jusqu’à une régulation des marchés des substances ? Organiser un marché limité et contrôlé ne serait-il pas plus adapté aux valeurs et enjeux de notre société, que l’actuelle juxtaposition prohibition/libre accès ?
Actuellement, les différents produits sont sur des marchés séparés, situation répondant plus à des logiques historiques qu’à des critères d’efficacité en santé publique : le marché du tabac illustre une possible régulation à l’inverse de celui de l’alcool caractérisé par sa faible régulation, tandis que le marché du cannabis est dominé par les incohérences et injustices de la prohibition de l’usage et les effets limités de la lutte contre le trafic.
Sur ce fond d’incohérence des marchés, les limites, majoritairement pénales, sont assurées par le binôme loi/soins. L’impact insuffisant d’une telle approche, a été démontré par l’incessante progression des usages. Il s’est aussi vérifié par sa capacité à freiner l’émergence de nouveaux outils pour aller à la rencontre du public en besoin d’accompagnement, comme à l’automne 2013 avec l’avis du conseil d’État repoussant l’expérimentation des salles de consommation à moindre risque au nom de la pénalisation de l’usage.
Il nuit à la nécessaire diversification des réponses, ne laissant que peu de place à celles qui s’organisent autour du lien social, de la coopération *(cf. chapitres 30, « Soins coopératifs, accompagnements et thérapies de gestion de l’addiction » et 45 « l’intervention précoce »)*, qu’ils s’agissent de réponses éducatives, préventives et ou de réduction des risques.
Elles sont pourtant encore plus nécessaires face aux mutations technologiques et culturelles, pour apprendre par l’éducation à poser des limites aux objets *« sans limite »* et à l’influence croissante de l’incitation du marketing et des médias sur les *« consommateurs » (Gallopel-Morvan, 2006)*. En articulation avec le rôle régulateur de l’État, ces réponses d’éducation préventive développées en complémentarité en renforceraient l’impact.
Aujourd’hui, tel qu’il est pensé, l’ensemble du dispositif continue d’être aveugle aux besoins de la période, souvent longue, qui précède l’addiction pathologique *(Morel, 2007)*. Les usagers et les familles, ceux qui prennent des risques sans être en réelle difficulté ou dépendants, les consommateurs *« excessifs »* mais non addicts sont laissés pour compte, tout en étant sous le coup de mesures de contrôle et de sanctions.
Ils vivent l’absurdité de devoir attendre l’accident, le passage aux urgences, la maladie ou la commission d’un acte délictueux pour que se déclenche un début de réponse sociale, aujourd’hui pénale ou médicale, qui arrive souvent tard.
La loi de modernisation du système de santé de 2016 a bien essayé de redéfinir la RdR, arrêtant de la limiter à la prévention des maladies infectieuses. Elle a aussi levé certains des blocages la concernant *(analyse de drogues, prévention des overdoses, salles de consommation à moindre risque et extension de la RdR en prison)*. Mais sans oser aller plus loin, comme l’a montré la mise en place d’une amende forfaitaire pour usage qui, du fait du maintien de la sanction par la prison, ressemble plus à une double peine qu’à un changement réel de logique.
La *« Priorité Prévention »*, instaurée en 2018 et pilotée par le Comité Interministériel de la Santé qui témoignait d’une prise de conscience en se focalisant préférentiellement sur les seuls risques sanitaires se révèle réductrice au regard des enjeux multidimensionnels des addictions. Il en est de même pour le service sanitaire de santé imposé aux étudiants des métiers de la santé en début de cursus, outil de la politique de prévention du ministère de la santé, qui reste cantonné au *« médical »*, oubliant les champs de l’éducation et l’expertise des acteurs non médicaux qui contribuent pourtant aussi à la santé.
Une politique reste donc à construire qui équilibre les différents types de régulations individuelles et collectives du point de vue de l’accompagnement (réduction des risques, intervention précoce, soins), et une régulation des marchés, n’oubliant ni les dimensions culturelles et sociales de l’addiction, ni les enjeux économiques, les intérêts privés et les profits ne devant pas conduire à la perte de contrôle entre offre et demande. C’est ce que devrait permettre, en particulier, le débat suscité par les appels de plus en plus nombreux à la légalisation du cannabis en France.
##Logique pénale
Pour établir des limites aux libertés des personnes *(ici celle de consommer des drogues)* l’État dispose de l’arme juridique et pénale. Interdire ce qui est *« mal », « dangereux », « fautif »*, semble logique. Mais l’ubiquité des drogues nous invite à nous méfier de cet apparent « mal » ou de cette *« dangerosité »* qui, utilisée de façon excessive et partiale, n’aboutit qu’à diaboliser un produit, à l’exemple du cannabis, longtemps exclu de toute utilisation médicale, et, par ricochet, en banalise d’autres, l’alcool notamment.
Sur le plan de la sanction, la tradition du harm principle issue des écrits de J.S. Mill a produit une doctrine invitant à ne pas pénaliser ce qui ne fait pas de tort à autrui. Elle a permis de mettre fin à la pénalisation de l’avortement, de l’homosexualité, de la pornographie. Elle repose sur l’idée que le domaine privé n’est pas affaire de loi pénale.
De plus, la loi devant proportionner ses sanctions, il est nécessaire d’expliciter les menaces auxquelles elles répondent. S’il est logique de pénaliser la violence, le trouble sur la voie publique, la conduite automobile sous l’effet de substances, que dire d’une consommation qui ne nuit pas à autrui ?
La sanctionner peut découler d’un paternalisme juridique qui cherche à protéger la personne d’elle-même, reprenant l’idée que la chimie des drogues *« modernes »* représente un trop fort danger pour être laissée à la seule gestion du sujet *(Danet, Gautron, 2009)*. La Commission nationale consultative des droits de l’Homme *(CNCDH)* constate que c’est la première fois, en droit français, qu’un comportement, ayant son auteur pour seule victime directe, est traité comme un acte attentatoire à l’ordre public.
La loi peut vouloir empêcher la violation des valeurs communes que partagent les citoyens d’un même État, voulant ainsi défendre l’appartenance à la collectivité *(Carrier, 2008)*. La punition ne sanctionne plus alors un tort causé à autrui, elle défend les valeurs promues par la société.
Mais quelles sont les *« valeurs communes »* de nos sociétés en matière de consommation de substances psychoactives ? Ne sont-elles pas aussi celles de l’hyperconsommation, de la performance, de l’individualisme, d’un toujours plus et sans limite qui s’associe quasi naturellement à l’usage de substance psychoactives ?
Dans l’usage de stupéfiant, le droit s’est donc écarté de la doctrine libérale du respect du style de vie de chacun, au profit de l’arbitraire d’une raison d’État, arguant d’une défense des valeurs communes et de la protection des personnes *« faibles »*. Les résultats sont ceux que l’on connaît, avec des niveaux de consommation particulièrement élevés en France.
A contrario, la dépénalisation de l’ensemble des usages instaurée par le Portugal a produit des effets positifs qui méritent d’être pris en compte. Ne serait-il pas plus efficient de construire des encadrements pour une mise sur le marché de produits pas comme les autres, au regard de leurs risques, et de ne conserver la logique pénale que pour garantir l’application de certains interdits protecteurs (interdiction du trafic, de la vente aux mineurs, de la publicité de marketing selon les endroits, etc.) ?
##Logique médicale et thérapeutique
La logique de la maladie, du *« trouble de l’usage »* et de la médicalisation est l’autre logique majoritairement mobilisée. Sous cet angle, le comportement d’usage constitue l’expression d’un mal à corriger, logé dans le corps, la psyché, la société ou partout à la fois. Il est donc légitime de traiter le dysfonctionnement à l’origine du comportement inadapté.
Les découvertes sur les effets neurobiologiques des drogues et des addictions ont apporté une certaine objectivation des processus addictifs et de leurs conséquences sur l’individu. La médicalisation en est une interprétation réductrice laissant entendre que ce qui est biologique ne se comprend et ne se soigne que par la médecine et la pharmacologie. Elle se répand à travers les médias, dans les hôpitaux et avec l’apparition de termes comme alcoologie, tabacologie, médecine des addictions, addictologie.
Les retombées positives peuvent apparaître évidentes, car plus l’addiction est conçue comme une maladie *« comme une autre »* moins les usagers sont culpabilisés et stigmatisés. Mais cette médicalisation se concilie très bien avec le contrôle juridique : puisqu’elle ne peut intervenir avant, elle lui laisse le champ de la régulation des comportements. Des objectifs de santé publique peuvent ainsi être utilisés pour justifier la multiplication des interdits.
Elle a largement participé à réduire la prévention à celle des conséquences médicales, oubliant les autres dimensions plus sociales et culturelles des comportements d’usage. Cette conception restrictive a créé un autre biais : elle freine le recours des personnes à leurs ressources personnelles et communautaires, à leur pouvoir d’auto-changement et à des modalités de soins plus intégratives, plus bio-psycho-sociales.
Loin de se priver des apports de la médecine des addictions, l’objectif d’une bonne régulation serait de ne pas faire intervenir cette dimension en première ligne, la notion de l’addiction maladie ne devant pas définir seule les réponses à apporter aux millions d’usages et d’usagers.
Sur ce même plan, comme nous savons que la distinction entre drogues dures et douces masque la question du mode d’usage, nous savons que la notion de dangerosité d’une drogue est difficile à définir dans l’absolu, tant les effets sont à classer sur des axes différents et soumis à de nombreuses variables *(cf. chapitre 6, « Drogues, dangers et complications »)*.
Cette meilleure compréhension des effets, à travers les facteurs de risques plutôt que par les dangers des drogues, permet d’appréhender l’apparition de nouvelles substances ou de nouvelles pratiques posant sans cesse des problèmes nouveaux et invite à accentuer une approche de réduction des risques.
##La logique de réduction des risques
Depuis les années quatre-vingt, une troisième logique s’impose peu à peu, initiant un nouveau mode de contrôle que s’approprient facilement les usagers : la réduction des risques *(RdR)*. Elle revendique deux principes : pragmatisme et humanisme. Au nom du pragmatisme, l’intervention doit être réaliste, praticable et mesurable. Au nom de l’humanisme, elle doit viser l’épanouissement de la personne et son respect.
Pour s’imposer et faire la preuve de son intérêt, la réduction des risques a privilégié dans un premier temps des risques quantifiables, de nature physique et souvent regroupés sur les deux axes de la santé et de la sécurité publique. Mais sa technologie de préservation des corps et de gestion des usages, permet que les personnes s’inscrivent dans un prendre soin de soi par une volonté de faire *« évoluer l’usage »* vers des pratiques à moindre risque. Elle se centre sur les pratiques d’usage et s’oriente vers le développement d’ *« habiletés sociales »*, nécessaires à une vie autonome et responsable.
Les avancées de la RdR sont nombreuses et incontestables, pourtant, la logique pénale du contrôle qui reste dominante continue de l’enfermer dans une définition minimaliste : réservée aux *« urgences sanitaires »*, parfois tolérée au nom de la *« sécurité publique ». « Le coup de force symbolique de la réduction des risques, c’est d’avoir suspendu le jugement moral et médical sur la consommation de drogues et d’avoir considéré que l’usager était en capacité de faire des choix rationnels face à certaines dimensions de son usage »*, écrivaient Marie Jauffret-Roustide et Jean-Maxence Granier.
Or la RdR ne trouve sa pleine efficacité, dans le soin comme dans l’Intervention Précoce que si elle sort de ces limites pour occuper une partie de cet espace central, celui des comportements d’usage, entre sanction et traitement, pour y déployer son accompagnement et une autre vision de l’usager *(cf. chapitre 3, « La réduction des risques, fondement d’une nouvelle addictologie »)*. On le voit avec la naissante réduction des risques alcool.
##La logique du marché
Les trois logiques judiciaire, thérapeutique et réduction des risques en matière de drogues et d’addictions s’intègrent aux préoccupations en « gestion des risques » de nos sociétés pour neutraliser les effets dommageables sur le corps social, parfois même dans une absolue anticipation *(Beck, 2001)*.
Mais on est en droit de se demander si les intérêts des marchés et de l’économie n’ont pas pris le pas sur la réhabilitation des personnes et la protection des plus vulnérables (Courtwight, 2019), oubliant d’agir sur le quatrième axe, celui du marché et des profits qu’il génère.
Agir sur le marché est une contribution indispensable à la régulation. Elle interroge la capacité de l’État à tenir un rôle *« régulateur »* et celle de l’entreprise à jouer un rôle *« responsable »*. Actuellement, des lois sanctionnent l’usager, participant d’une forme de déresponsabilisation *(ils/elles ne sont pas capables de …)* et de sur-responsabilisation *(ils/elles sont responsables, coupables…)*.
Mais au nom d’autres logiques, plus économiques, ces mêmes usagers sont exposés à un accès non régulé à l’alcool, par exemple. Changer de paradigme exige de sortir de ces discordances entre faible gestion de l’offre et fort système de sanction de l’usager, inefficace et couteux, débouchant sur un contentieux de masse *(dans le cas du cannabis)* ou sur une multiplication des problèmes de santé *(dans le cas de l’alcool)*. Assumer une régulation des accès, et donc des marchés, associée à une pragmatique gestion des risques et des usages, compléterait le binôme pénalisation/médicalisation.
Différents travaux d’analyse des expériences de régulation du marché du cannabis et le lien qu’il est possible de faire avec celle de l’alcool ou du tabac montrent que la régulation n’est pas une opération magique *(Obradovic, 2019 ; Geoffard, Auriol, 2019)*. Comme la réduction des risques, elle nécessite d’identifier la substance impliquée, ses spécificités d’usage, pour déterminer une ou des priorités.
À propos de celle du cannabis aux USA, Ivana Obradovic *(2019)* cite la sécurisation des conditions de production, vente et achat ; la limitation de l’accessibilité dans une vision de protection des mineurs ; la garantie de recettes fiscales. Le rapport du Conseil d’Analyse Économique évoque deux objectifs : la protection des mineurs et la réduction du marché illicite. La régulation est donc une *« légalisation sous condition » (Obradovic, 2019)*. Ses difficultés naissent de ne pas en avoir suffisamment identifié les objectifs pour pouvoir légitimer la régulation spécifique des profits.
La régulation du marché invite aussi à s’appuyer sur les approches dites du *« gouvernement des conduites »*, mobilisant la responsabilisation, la rationalisation et l’ *« économicisation »* des comportements individuels.
Il s’articule avec des interventions usant d’instruments contractuels, incitatifs et de labellisation, par lesquelles l’État entreprend de gouverner le marché par le marché, *« en douceur »*, en s’appuyant sur les dynamiques de concurrence, de réputation, de valorisation, de singularisation et d’imitation qui caractérisent les fonctionnements marchands.
Une des pratiques est l’engagement contractuel par des chartes qui visent à prévenir et réduire les consommations à risque. C’est le cas de la charte pour faire appliquer les modalités d’happy hour prévues dans le Code de santé publique. Ou encore de la charte *« Terrasses sans tabac »* ou de celle signée en 2019 dans le cadre du plan de mobilisation nationale de lutte contre des addictions, entre la MILDECA et des fédérations et groupements du commerce et de la distribution. Elle vise à assurer une offre d’alcool plus *« responsable »* en s’articulant autour de 4 axes : des actions de formation des salariés, de sensibilisation des clients, de modernisation de l’affichage et de renforcement du contrôle en caisse pour l’interdiction de vente aux mineurs.
De nombreuses questions se posent sur l’intérêt et les limites de cette approche. Ne témoigne-t-elle pas d’une coupable hésitation de la puissance publique à appliquer la logique pénale dès lors qu’elle concernerait les acteurs économiques ? Et son *« individualisation des risques »* ne se fait-elle pas aux détriments de politiques publiques fondées sur la solidarité.
Un autre aspect concerne la responsabilité sociétale de l’entreprise. La question de la compatibilité entre la production de substances psychoactives et les principes de la responsabilité sociétale se pose. Un récent rapporta pu identifier 14 mesures *(d’information, sensibilisation, formation, réglementation)* faisant consensus pour encourager des démarches volontaires de prévention et réduction des consommations d’alcool, de tabac et de stupéfiants. Un point de désaccord est l’association des acteurs économiques à l’élaboration des politiques de prévention : conformément à la convention cadre de l’OMS cela est interdit pour la lutte anti-tabac.
Pour l’alcool, les acteurs de santé publique sont quasi unanimes à considérer que les intérêts économiques des industriels ne sont pas compatibles avec ceux de la prévention qui prône notamment une réduction de l’offre. Car cette association ouvre à tous les paradoxes et jeux de dupe : l’industriel ambitionnant légitimement de former un bon consommateur plus qu’un citoyen autonome, le financier ayant comme mission de servir des intérêts financiers conséquents aux actionnaires, et non d’agir en santé publique. La seule expérience d’autorégulation tentée est celle des jeux d’argent, la loi de libéralisation prévoyant que *« celui qui a intérêt à ce que l’on joue plus doit simultanément établir un dispositif pour que l’on joue moins » (Fortis, 2009)*.
Toutefois, des acteurs économiques commencent à évoluer au regard de ces enjeux : des entreprises du tabac sont mises au ban par des fonds de pension afin de *« dénormaliser »* l’investissement tabac, un mouvement de responsabilisation par des liens directs entre petits producteurs et usagers, dans le domaine de l’alcool *(mais empêché par les grands groupes)*, des perspectives du même type qui tentent de s’organiser en vue d’une future légalisation du cannabis par exemple.
Loi, contrôle social et régulation [2/3] : mesures envers les consommateurs et la régulation comme convergence des priorités et cohérence des actions
**Ce texte est issu de l'ouvrage d'Alain Morel et de Jean-Pierre Couteron : Addictologie, et plus précisément de son chapitre 47, intitulé "Loi, contrôle social et régulation", écrit par Jean-Pierre Couteron, Nathalie Latour et Alain Morel.**
#Mesures envers les consommateurs
Une partie des mesures de contrôle concernent les producteurs ou les vendeurs. D’autres s’intéressent à l’usager, fixant des limites d’âge, de lieu, d’horaire, de circonstances d’usage, jouant sur les tarifs pour restreindre plus ou moins l’accès.
##La conduite automobile
Conduire sous l’empire d’un état alcoolique est un délit réprimé depuis 1965 en France. Un décret de 1995 fixe le taux limite de l’alcoolémie légalement tolérée à 0,5 g/litre de sang et de ≥ 0,2 g d’alcool par litre de sang pour les nouveaux conducteurs et les conducteurs de transport en commun. En cas d’accident ayant entraîné des blessures ou un décès, les peines sont aggravées et peuvent atteindre sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende pour homicide involontaire.
La détection massive de l’alcoolémie au volant *(8 millions de dépistages par an sur les routes ces dernières années)* fait l’essentiel de la politique de prévention de l’accidentalité routière liée à l’alcool, beaucoup restant à faire pour développer d’autres types d’actions *(Assailly, Biechler, 2006)*. La même démarche a été adoptée en 2003 envers l’usage de stupéfiants au volant et a conduit à un certain nombre de sanctions pénales y compris la prison.
Et s’il n’est pas l’objet d’une détection, l’usage du téléphone portable est lui aussi maintenant réglementé en voiture. Un nouveau dispositif veut aussi associer une part de responsabilisation à la sanction : en cas d’infraction routière liée à l’alcool, le droit de conduire est limité à un véhicule équipé d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage *(EAD)*. Selon les cas, il s’agit d’une décision du préfet, du juge ou après avis médical. L’obligation de conduire un véhicule équipé d’un EAD s’accompagne d’un programme éducatif spécifique.
##Consommation sur les lieux d’activité
En milieu de travail, le Code du travail ainsi que les réglementations internes des entreprises ont évolué vers une interdiction totale de la consommation de tabac, la quasi-disparition des *« pots »* alcoolisés *(voire le décret de juillet 2014 qui autorise l’employeur à les interdire « lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale »)* et un accroissement du recours à des dépistages biologiques qui a nécessité différentes tentatives d’encadrement éthiques et réglementaires.
Dans plusieurs établissements scolaires français, outre l’interdiction de consommation du tabac et des autres drogues, des conventions avec des consultations jeunes consommateurs *(CJC)* prévoient parfois l’instauration d’obligations de rencontre des élèves usagers de cannabis avec un intervenant spécialisé. D’autres privilégient des actions *« coup de poing »*, souvent médiatisées *(interventions policières avec chiens détecteurs, etc.)*.
Malgré une expertise collective de l’INSERM en 2014 sur les conduites addictives des jeunes, donnant des indications claires sur les actions probantes et non probantes, ce type d’intervention perdure en lien avec des séances d’information, là où les programmes multidimensionnels et basés sur les compétences psycho-sociales implantés dans un environnement favorable (cohérence des mesures mises en place dans un établissement) reste encore au stade des balbutiements.
C’est dans le monde du travail que l’évolution semble la plus manifeste : les usages de substances psychoactives deviennent un enjeu et intègrent les plans de prévention des risques psycho-sociaux, même si tous les tabous ne sont pas levés. La prévention des conduites addictives, introduite dans le 3e plan santé au travail 2016-2020, a fait l’objet d’un chapitre important du plan de mobilisation contre les addictions de la MILDECA *(2019)*.
S’agissant de l’éventuelle révision de la réglementation sur la consommation d’alcool au travail en vue d’une interdiction clairement posée, le plan indique que « le renforcement de l’interdit n’est pas ressorti comme le levier à privilégier » pour répondre à cette préoccupation des entreprises, l’accent devrait plutôt être mis sur des actions de prévention auprès des salariés, ainsi que sur la clarification de la responsabilité de l’employeur. Reste encore à dépasser une conception limitée au seul « repérage » dans une logique médicale de dépistage, pour intégrer la prise en compte des liens entre organisation du travail et usage *(cf. chapitre 27, « Travail et addictions »)*.
##L’usage public
En matière d’usage public, outre la restriction progressive de la consommation de tabac dans les lieux recevant du public, les nuisances dues aux mégots justifient certaines des mesures de limitation et de pénalisation de l’usage.
Après *« les plages sans tabac »*, et de plus en plus des parcs ou espace verts sans tabac, des municipalités sont de plus en plus nombreuses à prendre des arrêtés restreignant les lieux de consommation d’alcool pour des raisons d’ordre public et de nuisances. L’ivresse publique et manifeste (IPM) est une infraction depuis 1873.
Elle est régie par le Code de la santé publique et donne lieu à près de 80 000 interpellations par an, accompagnées d’une rétention en cellule *« de dégrisement »*. L’usage de stupéfiants reste l’objet d’interdiction et de pénalisation selon un régime de prohibition totale fixé par la loi de 1970.
Avec le même objectif d’un meilleur contrôle de l’usage, de récentes expériences internationales de légalisation du cannabis proposent différents modèles, entre grande liberté et interdit de consommer dans l’espace public.
#Informer pour dissuader
Dans les années soixante-dix, avec l’interdit pénal *(drogues illicites)* et une limitation de l’accès à l’alcool, l’information sur les dangers devint quasi synonyme de prévention. Il s’agissait de délivrer des messages forts, montrant les conséquences négatives, suscitant peur et opprobre afin de déclencher des réflexes d’autoprotection pour faire adopter des comportements d’abstinence pour les drogues illicites et un usage contrôlé pour l’alcool, tandis que le tabac restait oublié.
Cette prévention repose sur *« une politique de l’ignorance »*, les personnes devant adhérer aux messages qui leur sont délivrés sans s’interroger. Adaptée pour assurer la reproduction de normes et de comportements, suffisante pour gérer des modèles de comportement simples, nécessitant le recours à l’expérience acquise par les générations précédentes, elle fonctionne mal face à des problèmes complexes, en lien avec l’avancée de la société, nécessitant de nouveaux modèles de comportement et leur appropriation *(Low, 1994)*.
C’est le cas de l’usage de substances psychoactives, l’adoption de comportements adaptés pour y faire face ne peut se résumer à la simple reproduction d’une norme de refus de ce qui serait dangereux ou interdit. La culture de la performance, la banalisation de la solution chimique dans la vie quotidienne, la montée de l’hédonisme viennent largement brouiller les repères.
Une information tout à la fois moins complaisante et plus pertinente s’est peu à peu mise en place. Ainsi, pour l’alcool et le tabac, un gros travail de dévoilement des conséquences négatives de l’usage s’est révélé nécessaire.
Succédant à l’INPES, Santé Publique France conduit des campagnes sur l’alcool basées sur la RdR *(par exemple la campagne de 2013 pour « dire non au verre de trop »)*. D’autres campagnes comme *« mois sans tabac »* associent la logique motivationnelle à des actions de proximité, et encore récemment, une campagne pour diffuser les nouveaux repères de consommation de l’alcool.
La campagne s’est dotée d’un volet dit *« grand public »*, et d’un volet plus centré sur les médecins généralistes, acteurs du premier recours. Le lien entre tabagisme et cancer, le contenu exact d’une cigarette, le rôle de la combustion, sont venus casser l’image trompeuse installée par la publicité, tout en permettant des issues nouvelles *(vapotage par exemple, n’utilisant ni tabac ni combustion)*.
Pour l’alcool, de la même façon, le lien avec les cancers et d’autres maladies a pu être documenté. Mais aussi l’impact du binge-driking, des *« trous noirs »* et autres *« black-out »*, des usages précoces, etc. C’est toute une banalisation de l’alcool organisée par le marketing industriel qui est ainsi déstabilisée, malgré le peu de moyen disponible pour ces informations. De même, sur le cannabis, son impact est à la fois mieux décrit et plus précisément expliqué : rôle sur le cerveau, responsabilité des différents cannabinoides, précocité et intensité des usages. Ces données plus précises démodent une vision « diabolisant » le produit au profit d’informations adaptées.
En janvier 2019, des associations de professionnels, dont la Fédération Addiction, ont relayé en France l’initiative associative anglaise du Dry January qui consiste à passer un mois de janvier *« sobre »*, afin de récupérer des excès de la fin d’année et d’apprendre à moins consommer de l’alcool.
Contrairement au StopOctober qui invite à stopper l’usage du tabac pour en devenir abstinent, Dry January est une façon d’expérimenter les bienfaits d’une moindre consommation d’alcool. Face au début de frémissement dans une partie de l’opinion, les pouvoirs publics ont annoncé le reprendre officiellement pour 2020 avec son pilotage confié à Santé Publique France.
Beaucoup d’espoirs d’un changement de niveau de ces politiques reposent sur les crédits apportés par le nouveau *« Fond Addiction »* s’il permet de soutenir le développement et la cohérence des actions d’information, programmes de prévention et actions de proximité, portées par différents acteurs.
#Réguler : convergence des priorités et cohérence des actions
##Interdire et soigner, une réponse incomplète
La nécessité de poser des limites ne fait pas question, au regard des effets spécifiques de ces substances. Mais quelles limites et s’appliquant à qui et à quoi ? Il y a un réel besoin d’interroger où et comment se construisent les limites qui peuvent réguler l’usage, d’autant que notre société du sans-limite et de l’accès permanent, ne cesse techniquement de les estomper ou de les transformer *(cf. chapitre 11, « Modernité et addictions : la société addictogène »)*.
En confier l’établissement à la seule loi pénale, en espérer la correction des excès de la seule alternative soin/sanction ne peut qu’interroger sur l’incohérence d’une évolution où, *« en abandonnant son rôle régulateur pour inciter à l’usage, notre société pousse à l’extrême le paradoxe de promouvoir ce que dans le même temps elle réprime » (Couteron, 2009)*.
Le binôme médicalisation/pénalisation ne doit-il pas accepter de se compléter, comme il a commencé à le faire, même a minima, avec la réduction des risques et l’intervention précoce ? Réguler l’usage peut-il se faire sans oser aller jusqu’à une régulation des marchés des substances ? Organiser un marché limité et contrôlé ne serait-il pas plus adapté aux valeurs et enjeux de notre société, que l’actuelle juxtaposition prohibition/libre accès ?
Actuellement, les différents produits sont sur des marchés séparés, situation répondant plus à des logiques historiques qu’à des critères d’efficacité en santé publique : le marché du tabac illustre une possible régulation à l’inverse de celui de l’alcool caractérisé par sa faible régulation, tandis que le marché du cannabis est dominé par les incohérences et injustices de la prohibition de l’usage et les effets limités de la lutte contre le trafic.
Sur ce fond d’incohérence des marchés, les limites, majoritairement pénales, sont assurées par le binôme loi/soins. L’impact insuffisant d’une telle approche, a été démontré par l’incessante progression des usages. Il s’est aussi vérifié par sa capacité à freiner l’émergence de nouveaux outils pour aller à la rencontre du public en besoin d’accompagnement, comme à l’automne 2013 avec l’avis du conseil d’État repoussant l’expérimentation des salles de consommation à moindre risque au nom de la pénalisation de l’usage.
Il nuit à la nécessaire diversification des réponses, ne laissant que peu de place à celles qui s’organisent autour du lien social, de la coopération *(cf. chapitres 30, « Soins coopératifs, accompagnements et thérapies de gestion de l’addiction » et 45 « l’intervention précoce »)*, qu’ils s’agissent de réponses éducatives, préventives et ou de réduction des risques.
Elles sont pourtant encore plus nécessaires face aux mutations technologiques et culturelles, pour apprendre par l’éducation à poser des limites aux objets *« sans limite »* et à l’influence croissante de l’incitation du marketing et des médias sur les *« consommateurs » (Gallopel-Morvan, 2006)*. En articulation avec le rôle régulateur de l’État, ces réponses d’éducation préventive développées en complémentarité en renforceraient l’impact.
Aujourd’hui, tel qu’il est pensé, l’ensemble du dispositif continue d’être aveugle aux besoins de la période, souvent longue, qui précède l’addiction pathologique *(Morel, 2007)*. Les usagers et les familles, ceux qui prennent des risques sans être en réelle difficulté ou dépendants, les consommateurs *« excessifs »* mais non addicts sont laissés pour compte, tout en étant sous le coup de mesures de contrôle et de sanctions.
Ils vivent l’absurdité de devoir attendre l’accident, le passage aux urgences, la maladie ou la commission d’un acte délictueux pour que se déclenche un début de réponse sociale, aujourd’hui pénale ou médicale, qui arrive souvent tard.
La loi de modernisation du système de santé de 2016 a bien essayé de redéfinir la RdR, arrêtant de la limiter à la prévention des maladies infectieuses. Elle a aussi levé certains des blocages la concernant *(analyse de drogues, prévention des overdoses, salles de consommation à moindre risque et extension de la RdR en prison)*. Mais sans oser aller plus loin, comme l’a montré la mise en place d’une amende forfaitaire pour usage qui, du fait du maintien de la sanction par la prison, ressemble plus à une double peine qu’à un changement réel de logique.
La *« Priorité Prévention »*, instaurée en 2018 et pilotée par le Comité Interministériel de la Santé qui témoignait d’une prise de conscience en se focalisant préférentiellement sur les seuls risques sanitaires se révèle réductrice au regard des enjeux multidimensionnels des addictions. Il en est de même pour le service sanitaire de santé imposé aux étudiants des métiers de la santé en début de cursus, outil de la politique de prévention du ministère de la santé, qui reste cantonné au *« médical »*, oubliant les champs de l’éducation et l’expertise des acteurs non médicaux qui contribuent pourtant aussi à la santé.
Une politique reste donc à construire qui équilibre les différents types de régulations individuelles et collectives du point de vue de l’accompagnement (réduction des risques, intervention précoce, soins), et une régulation des marchés, n’oubliant ni les dimensions culturelles et sociales de l’addiction, ni les enjeux économiques, les intérêts privés et les profits ne devant pas conduire à la perte de contrôle entre offre et demande. C’est ce que devrait permettre, en particulier, le débat suscité par les appels de plus en plus nombreux à la légalisation du cannabis en France.
##Logique pénale
Pour établir des limites aux libertés des personnes *(ici celle de consommer des drogues)* l’État dispose de l’arme juridique et pénale. Interdire ce qui est *« mal », « dangereux », « fautif »*, semble logique. Mais l’ubiquité des drogues nous invite à nous méfier de cet apparent « mal » ou de cette *« dangerosité »* qui, utilisée de façon excessive et partiale, n’aboutit qu’à diaboliser un produit, à l’exemple du cannabis, longtemps exclu de toute utilisation médicale, et, par ricochet, en banalise d’autres, l’alcool notamment.
Sur le plan de la sanction, la tradition du harm principle issue des écrits de J.S. Mill a produit une doctrine invitant à ne pas pénaliser ce qui ne fait pas de tort à autrui. Elle a permis de mettre fin à la pénalisation de l’avortement, de l’homosexualité, de la pornographie. Elle repose sur l’idée que le domaine privé n’est pas affaire de loi pénale.
De plus, la loi devant proportionner ses sanctions, il est nécessaire d’expliciter les menaces auxquelles elles répondent. S’il est logique de pénaliser la violence, le trouble sur la voie publique, la conduite automobile sous l’effet de substances, que dire d’une consommation qui ne nuit pas à autrui ?
La sanctionner peut découler d’un paternalisme juridique qui cherche à protéger la personne d’elle-même, reprenant l’idée que la chimie des drogues *« modernes »* représente un trop fort danger pour être laissée à la seule gestion du sujet *(Danet, Gautron, 2009)*. La Commission nationale consultative des droits de l’Homme *(CNCDH)* constate que c’est la première fois, en droit français, qu’un comportement, ayant son auteur pour seule victime directe, est traité comme un acte attentatoire à l’ordre public.
La loi peut vouloir empêcher la violation des valeurs communes que partagent les citoyens d’un même État, voulant ainsi défendre l’appartenance à la collectivité *(Carrier, 2008)*. La punition ne sanctionne plus alors un tort causé à autrui, elle défend les valeurs promues par la société.
Mais quelles sont les *« valeurs communes »* de nos sociétés en matière de consommation de substances psychoactives ? Ne sont-elles pas aussi celles de l’hyperconsommation, de la performance, de l’individualisme, d’un toujours plus et sans limite qui s’associe quasi naturellement à l’usage de substance psychoactives ?
Dans l’usage de stupéfiant, le droit s’est donc écarté de la doctrine libérale du respect du style de vie de chacun, au profit de l’arbitraire d’une raison d’État, arguant d’une défense des valeurs communes et de la protection des personnes *« faibles »*. Les résultats sont ceux que l’on connaît, avec des niveaux de consommation particulièrement élevés en France.
A contrario, la dépénalisation de l’ensemble des usages instaurée par le Portugal a produit des effets positifs qui méritent d’être pris en compte. Ne serait-il pas plus efficient de construire des encadrements pour une mise sur le marché de produits pas comme les autres, au regard de leurs risques, et de ne conserver la logique pénale que pour garantir l’application de certains interdits protecteurs (interdiction du trafic, de la vente aux mineurs, de la publicité de marketing selon les endroits, etc.) ?
##Logique médicale et thérapeutique
La logique de la maladie, du *« trouble de l’usage »* et de la médicalisation est l’autre logique majoritairement mobilisée. Sous cet angle, le comportement d’usage constitue l’expression d’un mal à corriger, logé dans le corps, la psyché, la société ou partout à la fois. Il est donc légitime de traiter le dysfonctionnement à l’origine du comportement inadapté.
Les découvertes sur les effets neurobiologiques des drogues et des addictions ont apporté une certaine objectivation des processus addictifs et de leurs conséquences sur l’individu. La médicalisation en est une interprétation réductrice laissant entendre que ce qui est biologique ne se comprend et ne se soigne que par la médecine et la pharmacologie. Elle se répand à travers les médias, dans les hôpitaux et avec l’apparition de termes comme alcoologie, tabacologie, médecine des addictions, addictologie.
Les retombées positives peuvent apparaître évidentes, car plus l’addiction est conçue comme une maladie *« comme une autre »* moins les usagers sont culpabilisés et stigmatisés. Mais cette médicalisation se concilie très bien avec le contrôle juridique : puisqu’elle ne peut intervenir avant, elle lui laisse le champ de la régulation des comportements. Des objectifs de santé publique peuvent ainsi être utilisés pour justifier la multiplication des interdits.
Elle a largement participé à réduire la prévention à celle des conséquences médicales, oubliant les autres dimensions plus sociales et culturelles des comportements d’usage. Cette conception restrictive a créé un autre biais : elle freine le recours des personnes à leurs ressources personnelles et communautaires, à leur pouvoir d’auto-changement et à des modalités de soins plus intégratives, plus bio-psycho-sociales.
Loin de se priver des apports de la médecine des addictions, l’objectif d’une bonne régulation serait de ne pas faire intervenir cette dimension en première ligne, la notion de l’addiction maladie ne devant pas définir seule les réponses à apporter aux millions d’usages et d’usagers.
Sur ce même plan, comme nous savons que la distinction entre drogues dures et douces masque la question du mode d’usage, nous savons que la notion de dangerosité d’une drogue est difficile à définir dans l’absolu, tant les effets sont à classer sur des axes différents et soumis à de nombreuses variables *(cf. chapitre 6, « Drogues, dangers et complications »)*.
Cette meilleure compréhension des effets, à travers les facteurs de risques plutôt que par les dangers des drogues, permet d’appréhender l’apparition de nouvelles substances ou de nouvelles pratiques posant sans cesse des problèmes nouveaux et invite à accentuer une approche de réduction des risques.
##La logique de réduction des risques
Depuis les années quatre-vingt, une troisième logique s’impose peu à peu, initiant un nouveau mode de contrôle que s’approprient facilement les usagers : la réduction des risques *(RdR)*. Elle revendique deux principes : pragmatisme et humanisme. Au nom du pragmatisme, l’intervention doit être réaliste, praticable et mesurable. Au nom de l’humanisme, elle doit viser l’épanouissement de la personne et son respect.
Pour s’imposer et faire la preuve de son intérêt, la réduction des risques a privilégié dans un premier temps des risques quantifiables, de nature physique et souvent regroupés sur les deux axes de la santé et de la sécurité publique. Mais sa technologie de préservation des corps et de gestion des usages, permet que les personnes s’inscrivent dans un prendre soin de soi par une volonté de faire *« évoluer l’usage »* vers des pratiques à moindre risque. Elle se centre sur les pratiques d’usage et s’oriente vers le développement d’ *« habiletés sociales »*, nécessaires à une vie autonome et responsable.
Les avancées de la RdR sont nombreuses et incontestables, pourtant, la logique pénale du contrôle qui reste dominante continue de l’enfermer dans une définition minimaliste : réservée aux *« urgences sanitaires »*, parfois tolérée au nom de la *« sécurité publique ». « Le coup de force symbolique de la réduction des risques, c’est d’avoir suspendu le jugement moral et médical sur la consommation de drogues et d’avoir considéré que l’usager était en capacité de faire des choix rationnels face à certaines dimensions de son usage »*, écrivaient Marie Jauffret-Roustide et Jean-Maxence Granier.
Or la RdR ne trouve sa pleine efficacité, dans le soin comme dans l’Intervention Précoce que si elle sort de ces limites pour occuper une partie de cet espace central, celui des comportements d’usage, entre sanction et traitement, pour y déployer son accompagnement et une autre vision de l’usager *(cf. chapitre 3, « La réduction des risques, fondement d’une nouvelle addictologie »)*. On le voit avec la naissante réduction des risques alcool.
##La logique du marché
Les trois logiques judiciaire, thérapeutique et réduction des risques en matière de drogues et d’addictions s’intègrent aux préoccupations en « gestion des risques » de nos sociétés pour neutraliser les effets dommageables sur le corps social, parfois même dans une absolue anticipation *(Beck, 2001)*.
Mais on est en droit de se demander si les intérêts des marchés et de l’économie n’ont pas pris le pas sur la réhabilitation des personnes et la protection des plus vulnérables (Courtwight, 2019), oubliant d’agir sur le quatrième axe, celui du marché et des profits qu’il génère.
Agir sur le marché est une contribution indispensable à la régulation. Elle interroge la capacité de l’État à tenir un rôle *« régulateur »* et celle de l’entreprise à jouer un rôle *« responsable »*. Actuellement, des lois sanctionnent l’usager, participant d’une forme de déresponsabilisation *(ils/elles ne sont pas capables de …)* et de sur-responsabilisation *(ils/elles sont responsables, coupables…)*.
Mais au nom d’autres logiques, plus économiques, ces mêmes usagers sont exposés à un accès non régulé à l’alcool, par exemple. Changer de paradigme exige de sortir de ces discordances entre faible gestion de l’offre et fort système de sanction de l’usager, inefficace et couteux, débouchant sur un contentieux de masse *(dans le cas du cannabis)* ou sur une multiplication des problèmes de santé *(dans le cas de l’alcool)*. Assumer une régulation des accès, et donc des marchés, associée à une pragmatique gestion des risques et des usages, compléterait le binôme pénalisation/médicalisation.
Différents travaux d’analyse des expériences de régulation du marché du cannabis et le lien qu’il est possible de faire avec celle de l’alcool ou du tabac montrent que la régulation n’est pas une opération magique *(Obradovic, 2019 ; Geoffard, Auriol, 2019)*. Comme la réduction des risques, elle nécessite d’identifier la substance impliquée, ses spécificités d’usage, pour déterminer une ou des priorités.
À propos de celle du cannabis aux USA, Ivana Obradovic *(2019)* cite la sécurisation des conditions de production, vente et achat ; la limitation de l’accessibilité dans une vision de protection des mineurs ; la garantie de recettes fiscales. Le rapport du Conseil d’Analyse Économique évoque deux objectifs : la protection des mineurs et la réduction du marché illicite. La régulation est donc une *« légalisation sous condition » (Obradovic, 2019)*. Ses difficultés naissent de ne pas en avoir suffisamment identifié les objectifs pour pouvoir légitimer la régulation spécifique des profits.
La régulation du marché invite aussi à s’appuyer sur les approches dites du *« gouvernement des conduites »*, mobilisant la responsabilisation, la rationalisation et l’ *« économicisation »* des comportements individuels.
Il s’articule avec des interventions usant d’instruments contractuels, incitatifs et de labellisation, par lesquelles l’État entreprend de gouverner le marché par le marché, *« en douceur »*, en s’appuyant sur les dynamiques de concurrence, de réputation, de valorisation, de singularisation et d’imitation qui caractérisent les fonctionnements marchands.
Une des pratiques est l’engagement contractuel par des chartes qui visent à prévenir et réduire les consommations à risque. C’est le cas de la charte pour faire appliquer les modalités d’happy hour prévues dans le Code de santé publique. Ou encore de la charte *« Terrasses sans tabac »* ou de celle signée en 2019 dans le cadre du plan de mobilisation nationale de lutte contre des addictions, entre la MILDECA et des fédérations et groupements du commerce et de la distribution. Elle vise à assurer une offre d’alcool plus *« responsable »* en s’articulant autour de 4 axes : des actions de formation des salariés, de sensibilisation des clients, de modernisation de l’affichage et de renforcement du contrôle en caisse pour l’interdiction de vente aux mineurs.
De nombreuses questions se posent sur l’intérêt et les limites de cette approche. Ne témoigne-t-elle pas d’une coupable hésitation de la puissance publique à appliquer la logique pénale dès lors qu’elle concernerait les acteurs économiques ? Et son *« individualisation des risques »* ne se fait-elle pas aux détriments de politiques publiques fondées sur la solidarité.
Un autre aspect concerne la responsabilité sociétale de l’entreprise. La question de la compatibilité entre la production de substances psychoactives et les principes de la responsabilité sociétale se pose. Un récent rapporta pu identifier 14 mesures *(d’information, sensibilisation, formation, réglementation)* faisant consensus pour encourager des démarches volontaires de prévention et réduction des consommations d’alcool, de tabac et de stupéfiants. Un point de désaccord est l’association des acteurs économiques à l’élaboration des politiques de prévention : conformément à la convention cadre de l’OMS cela est interdit pour la lutte anti-tabac.
Pour l’alcool, les acteurs de santé publique sont quasi unanimes à considérer que les intérêts économiques des industriels ne sont pas compatibles avec ceux de la prévention qui prône notamment une réduction de l’offre. Car cette association ouvre à tous les paradoxes et jeux de dupe : l’industriel ambitionnant légitimement de former un bon consommateur plus qu’un citoyen autonome, le financier ayant comme mission de servir des intérêts financiers conséquents aux actionnaires, et non d’agir en santé publique. La seule expérience d’autorégulation tentée est celle des jeux d’argent, la loi de libéralisation prévoyant que *« celui qui a intérêt à ce que l’on joue plus doit simultanément établir un dispositif pour que l’on joue moins » (Fortis, 2009)*.
Toutefois, des acteurs économiques commencent à évoluer au regard de ces enjeux : des entreprises du tabac sont mises au ban par des fonds de pension afin de *« dénormaliser »* l’investissement tabac, un mouvement de responsabilisation par des liens directs entre petits producteurs et usagers, dans le domaine de l’alcool *(mais empêché par les grands groupes)*, des perspectives du même type qui tentent de s’organiser en vue d’une future légalisation du cannabis par exemple.
Hors ligne
- Échec Scolaire

- Nouveau Psycho
- Inscrit le 13 Feb 2022
- 112 messages
Et la troisième car je m’ennuie ce matin.
Loi, contrôle social et régulation [3/3] : le cas du cannabis, le plaisir et l’expérience globale et conclusion
#Le cas du cannabis : légaliser pour quelle régulation ?
Au regard de leurs effets et conséquences, de leur statut de pharmakon, les substances psychoactives méritent de quitter l’économie de marché libérale qui renvoie à l’usager l’entièreté du contrôle, ou le marché noir né de la prohibition qui s’arroge l’entièreté des bénéfices, laissant à l’État la charge d’une répression sans issue et les coûts de santé.
Selon les substances, la construction d’un possible marché *« réservé », « contesté », « protégé »* interroge la capacité de l’État à en fixer des règles spécifiques, limitant le profit en échange de moindres dépenses de santé et de police/justice. Le cannabis et l’alcool sont au cœur de ce débat.
La question du cannabis thérapeutique avance enfin en France. L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé *(ANSM)* a validé en juillet 2019 les propositions d’un groupe d’experts *(CSST)* en vue d’une expérimentation de l’accès au cannabis à visée thérapeutique. Ce comité d’experts avait fin 2018 analysé la littérature scientifique et les expériences des pays ayant mis en place l’accès au cannabis thérapeutique.
Il a auditionné des patients et des professionnels de santé. Début 2019, il a précisé les modalités d’une expérimentation dont l’objectif serait d’évaluer, en situation réelle, le circuit de prescription et délivrance ainsi que l’adhésion des professionnels de santé et des patients, et de recueillir les premières données françaises d’efficacité et de sécurité.
Pour le cannabis *« récréatif », « bien-être », « adulte »*, suite à une série d’initiatives prises dans différents pays, nous disposons d’une palette de régimes d’encadrement différents des marchés légaux, entre les 8 États américains, l’Uruguay et les 10 provinces et 3 territoires fédéraux du Canada.
Aux USA, le modèle commercial de certains États, reposant sur des opérateurs et des intérêts privés, renforce la crainte d’une concentration industrielle à coup de fusions-acquisitions. La « régulation » n’aurait été qu’un slogan, le développement du marché, mal contenu, se révèle contre-productif et pose certains problèmes : baisse des prix, hausse de la concentration moyenne des produits, hausse de la consommation, contournement des règles de publicité, etc.
Mais d’autres expériences montrent qu’il existe des pistes pour un paradigme de régulation efficace, alternatif à la prohibition. Ainsi, l’État de Washington a interdit l’intégration verticale des acteurs économiques du marché du cannabis, afin d’éviter la constitution de filières difficilement contrôlables. Le même souci de *« réglementer »* le marché du cannabis guide les propositions de Decorte (2018), privilégiant une autoproduction sous forme de *« Cannabis Social Club »*.
Le Cannabis Social Club est une association réservée à des usagers adultes qui organise la production en circuit court et dans un cadre non-lucratif. Il constitue à la fois une coopérative réunissant producteurs et usagers, et un groupe d’auto-support tourné vers de bonnes pratiques, depuis la culture et la production biologique jusqu’à la consommation responsable.
Issus des clubs compassionnels aux USA, créés pour garantir un approvisionnement de qualité dans un cercle fermé, ils deviennent, notamment en Espagne et en Belgique, des clubs de consommation et de production restreintes, traçables et transparentes.
De même, la limitation des quantités par personne et pour une période donnée, ou l’établissement d’un dosage moyen de principes actifs participe de la réduction des risques et permet d’anticiper le problème des grands consommateurs, tel qu’il se retrouve sur le marché de l’alcool, en activant une aide adaptée aux vulnérabilités que cachent ces surconsommations.
Les difficultés rencontrées par la naissante régulation du cannabis n’ont rien d’étonnant : un profit exponentiel va de pair avec un usage exponentiel et des conséquences sanitaires et sociales exponentielles. Pour réguler l’usage, il faut donc réguler le profit, soit sous forme d’un monopole d’État, soit par des modèles d’autoproduction non-lucrative, soit par des mécanismes de régies contrôlées, soit par une autorité administrative indépendante *(AAI)* type ARJEL pour les jeux d’argent.
En France, la régulation du marché des armes, ou, sur un autre versant, celle des produits pharmaceutiques, ont fait la preuve de leur intérêt. Dans d’autres pays, l’alcool est distribué sous contrôle de l’État.
Repenser l’ensemble des étapes, faire émerger de nouvelles compétences professionnelles, favoriserait une régulation qui ne laisserait pas aux grands groupes financiers *(responsables des abus d’alcool et de tabac, rappelons-le)* le contrôle des substances autrefois illégales, comme cela se dessine dans certains pays avec la légalisation du commerce du cannabis *(Deleu-Loridon, 2019)*.
Cela convergerait avec les recommandations de la Cour des comptes sur la nécessité de mieux réguler le marché de l’alcool *(fiscalité, réglementation distribution, publicité et lobbying)*.
Pour l’État, tenir son rôle régulateur lui impose de contenir les puissantes tendances dé-régulatrices de l’économie du profit maximum, et de moins s’attaquer aux usagers qu’à contenir certains gros appétits financiers.
#Un point aveugle, le plaisir et l’expérience globale
Les difficultés à concevoir et instaurer des politiques de régulation réalistes et efficaces sont accentuées par la non prise en compte de l’expérience que procure l’usage, du plaisir qui peut en résulter… et qui bien souvent le motive. Cette question reste le principal tabou dans les politiques des drogues.
Pourtant, les études indiquent que la première motivation des adolescents pour consommer des drogues reste la recherche de plaisir, le *« trip »*, le *« fun »*, la convivialité, la fête, la curiosité, le défi. Cela est d’autant moins surprenant que notre société en fait une valeur centrale.
La réponse habituelle consiste à communiquer sur les conséquences négatives : la dépendance, l’argent dépensé, la santé mentale, la mémoire, la concentration, etc. Intervention utile, mais qui fait l’impasse sur la part centrale du problème de l’adolescent : comment accéder au plaisir, à la fête, à l’intensité du moment, au lien avec les autres, etc. Pouvons-nous prétendre faire de la prévention et continuer d’être incapables d’accompagner la recherche du bien-être et l’expérience du plaisir ?
Résultat : chacun reste seul avec son expérience, ses questions et ses prises de risque. La vie a pourtant besoin de moments d’exception qui apportent un plaisir lié à la possibilité d’être hors des cadres habituels. Ce *« hors cadre »* ne devrait pas être systématiquement confondu avec l’excès, d’autant que celui-ci est presque devenu la norme de nos sociétés d’hyper-consumérisme *(Ardenne, 2006)*. Rendre moins dangereux, pour soi et pour autrui, ce besoin d’intensité et d’excès repose sur la convergence entre une politique de régulation et un travail en amont d’éducation préventive *(cf. chapitre 44, « Éducation préventive et promotion de la santé »)*.
Ce besoin n’est pas le même pour tous et à tous les âges : certains ne supportent pas l’ivresse ni toute perte de contrôle de soi, d’autres au contraire n’ont l’impression de ne vivre que dans ces moments, beaucoup se trouvent plus ou moins entre les deux. Mais chacun recherche un compromis entre vivre sa vie et ne pas la perdre à *« la brûler »* ou en *« passant à côté »*.
Chacun essaie de *« gérer »* son expérience globale pour trouver les satisfactions qu’il recherche sans devoir en payer un prix trop lourd. Cette exigence d’un regard sur soi traverse l’ensemble du champ de l’action sociale, marquant pour certains le passage d’un État social à un État néolibéral et donc d’un sujet du devoir disciplinaire *(Foucault)*, obéissant à des prescriptions et proscription de santé publique, d’éducation sanitaire, de prohibition à un sujet devant réduire sa vulnérabilité résultant de la désaffiliation des mutations du rapport salarial *(Castel)* agissant *« sur le rapport à lui-même et aux autres »*. Rien, en fait, qui ne puisse se faire seul, sans les autres, reconnaissant et partageant ses vulnérabilités.
#Conclure ?…
Le recours à l’expérience addictive ne peut être conçu comme une simple *« faute »* ou comme un *« dysfonctionnement »*. Les drogues sont capables d’ubiquité, et le sujet ne se réduit pas à ses comportements, le sens de l’expérience dans le contexte où il vit est essentiel.
À trop faire reposer la régulation des comportements sur le contrôle social par la loi et la judiciarisation, c’est la personne qui est oubliée, dépossédée de ses choix et de ses capacités d’autocontrôle *(Macquet, 2010)*, de ses besoins d’extrême. À l’opposé, le marché et ses acteurs sont exemptés de leurs responsabilités sociales, au nom du seul profit financier.
Sans se passer de la loi et de la médicalisation, le modèle *« régulationniste »* permet de densifier les réponses, notamment dans les secteurs où elles ont été les plus affaiblies *(Couteron, Morel, 2011)*, ajoutant un contrôle du marché des substances et une logique d’intervention précoce.
Il est en cela plus à même de répondre aux besoins des individus et des populations face aux risques de la modernité *(Morel, Couteron, 2011 ; Suissa, 2007)*. Évitant de fonctionner comme une simple injonction à la personne, mobilisant la prise de responsabilité de l’État, la régulation rejoint les propositions du CESE *(2019)* dont un récent rapport invitait à déployer une politique permettant autant de défendre la liberté de ne pas consommer que de réduire les risques du plaisir de le faire.
Loi, contrôle social et régulation [3/3] : le cas du cannabis, le plaisir et l’expérience globale et conclusion
#Le cas du cannabis : légaliser pour quelle régulation ?
Au regard de leurs effets et conséquences, de leur statut de pharmakon, les substances psychoactives méritent de quitter l’économie de marché libérale qui renvoie à l’usager l’entièreté du contrôle, ou le marché noir né de la prohibition qui s’arroge l’entièreté des bénéfices, laissant à l’État la charge d’une répression sans issue et les coûts de santé.
Selon les substances, la construction d’un possible marché *« réservé », « contesté », « protégé »* interroge la capacité de l’État à en fixer des règles spécifiques, limitant le profit en échange de moindres dépenses de santé et de police/justice. Le cannabis et l’alcool sont au cœur de ce débat.
La question du cannabis thérapeutique avance enfin en France. L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé *(ANSM)* a validé en juillet 2019 les propositions d’un groupe d’experts *(CSST)* en vue d’une expérimentation de l’accès au cannabis à visée thérapeutique. Ce comité d’experts avait fin 2018 analysé la littérature scientifique et les expériences des pays ayant mis en place l’accès au cannabis thérapeutique.
Il a auditionné des patients et des professionnels de santé. Début 2019, il a précisé les modalités d’une expérimentation dont l’objectif serait d’évaluer, en situation réelle, le circuit de prescription et délivrance ainsi que l’adhésion des professionnels de santé et des patients, et de recueillir les premières données françaises d’efficacité et de sécurité.
Pour le cannabis *« récréatif », « bien-être », « adulte »*, suite à une série d’initiatives prises dans différents pays, nous disposons d’une palette de régimes d’encadrement différents des marchés légaux, entre les 8 États américains, l’Uruguay et les 10 provinces et 3 territoires fédéraux du Canada.
Aux USA, le modèle commercial de certains États, reposant sur des opérateurs et des intérêts privés, renforce la crainte d’une concentration industrielle à coup de fusions-acquisitions. La « régulation » n’aurait été qu’un slogan, le développement du marché, mal contenu, se révèle contre-productif et pose certains problèmes : baisse des prix, hausse de la concentration moyenne des produits, hausse de la consommation, contournement des règles de publicité, etc.
Mais d’autres expériences montrent qu’il existe des pistes pour un paradigme de régulation efficace, alternatif à la prohibition. Ainsi, l’État de Washington a interdit l’intégration verticale des acteurs économiques du marché du cannabis, afin d’éviter la constitution de filières difficilement contrôlables. Le même souci de *« réglementer »* le marché du cannabis guide les propositions de Decorte (2018), privilégiant une autoproduction sous forme de *« Cannabis Social Club »*.
Le Cannabis Social Club est une association réservée à des usagers adultes qui organise la production en circuit court et dans un cadre non-lucratif. Il constitue à la fois une coopérative réunissant producteurs et usagers, et un groupe d’auto-support tourné vers de bonnes pratiques, depuis la culture et la production biologique jusqu’à la consommation responsable.
Issus des clubs compassionnels aux USA, créés pour garantir un approvisionnement de qualité dans un cercle fermé, ils deviennent, notamment en Espagne et en Belgique, des clubs de consommation et de production restreintes, traçables et transparentes.
De même, la limitation des quantités par personne et pour une période donnée, ou l’établissement d’un dosage moyen de principes actifs participe de la réduction des risques et permet d’anticiper le problème des grands consommateurs, tel qu’il se retrouve sur le marché de l’alcool, en activant une aide adaptée aux vulnérabilités que cachent ces surconsommations.
Les difficultés rencontrées par la naissante régulation du cannabis n’ont rien d’étonnant : un profit exponentiel va de pair avec un usage exponentiel et des conséquences sanitaires et sociales exponentielles. Pour réguler l’usage, il faut donc réguler le profit, soit sous forme d’un monopole d’État, soit par des modèles d’autoproduction non-lucrative, soit par des mécanismes de régies contrôlées, soit par une autorité administrative indépendante *(AAI)* type ARJEL pour les jeux d’argent.
En France, la régulation du marché des armes, ou, sur un autre versant, celle des produits pharmaceutiques, ont fait la preuve de leur intérêt. Dans d’autres pays, l’alcool est distribué sous contrôle de l’État.
Repenser l’ensemble des étapes, faire émerger de nouvelles compétences professionnelles, favoriserait une régulation qui ne laisserait pas aux grands groupes financiers *(responsables des abus d’alcool et de tabac, rappelons-le)* le contrôle des substances autrefois illégales, comme cela se dessine dans certains pays avec la légalisation du commerce du cannabis *(Deleu-Loridon, 2019)*.
Cela convergerait avec les recommandations de la Cour des comptes sur la nécessité de mieux réguler le marché de l’alcool *(fiscalité, réglementation distribution, publicité et lobbying)*.
Pour l’État, tenir son rôle régulateur lui impose de contenir les puissantes tendances dé-régulatrices de l’économie du profit maximum, et de moins s’attaquer aux usagers qu’à contenir certains gros appétits financiers.
#Un point aveugle, le plaisir et l’expérience globale
Les difficultés à concevoir et instaurer des politiques de régulation réalistes et efficaces sont accentuées par la non prise en compte de l’expérience que procure l’usage, du plaisir qui peut en résulter… et qui bien souvent le motive. Cette question reste le principal tabou dans les politiques des drogues.
Pourtant, les études indiquent que la première motivation des adolescents pour consommer des drogues reste la recherche de plaisir, le *« trip »*, le *« fun »*, la convivialité, la fête, la curiosité, le défi. Cela est d’autant moins surprenant que notre société en fait une valeur centrale.
La réponse habituelle consiste à communiquer sur les conséquences négatives : la dépendance, l’argent dépensé, la santé mentale, la mémoire, la concentration, etc. Intervention utile, mais qui fait l’impasse sur la part centrale du problème de l’adolescent : comment accéder au plaisir, à la fête, à l’intensité du moment, au lien avec les autres, etc. Pouvons-nous prétendre faire de la prévention et continuer d’être incapables d’accompagner la recherche du bien-être et l’expérience du plaisir ?
Résultat : chacun reste seul avec son expérience, ses questions et ses prises de risque. La vie a pourtant besoin de moments d’exception qui apportent un plaisir lié à la possibilité d’être hors des cadres habituels. Ce *« hors cadre »* ne devrait pas être systématiquement confondu avec l’excès, d’autant que celui-ci est presque devenu la norme de nos sociétés d’hyper-consumérisme *(Ardenne, 2006)*. Rendre moins dangereux, pour soi et pour autrui, ce besoin d’intensité et d’excès repose sur la convergence entre une politique de régulation et un travail en amont d’éducation préventive *(cf. chapitre 44, « Éducation préventive et promotion de la santé »)*.
Ce besoin n’est pas le même pour tous et à tous les âges : certains ne supportent pas l’ivresse ni toute perte de contrôle de soi, d’autres au contraire n’ont l’impression de ne vivre que dans ces moments, beaucoup se trouvent plus ou moins entre les deux. Mais chacun recherche un compromis entre vivre sa vie et ne pas la perdre à *« la brûler »* ou en *« passant à côté »*.
Chacun essaie de *« gérer »* son expérience globale pour trouver les satisfactions qu’il recherche sans devoir en payer un prix trop lourd. Cette exigence d’un regard sur soi traverse l’ensemble du champ de l’action sociale, marquant pour certains le passage d’un État social à un État néolibéral et donc d’un sujet du devoir disciplinaire *(Foucault)*, obéissant à des prescriptions et proscription de santé publique, d’éducation sanitaire, de prohibition à un sujet devant réduire sa vulnérabilité résultant de la désaffiliation des mutations du rapport salarial *(Castel)* agissant *« sur le rapport à lui-même et aux autres »*. Rien, en fait, qui ne puisse se faire seul, sans les autres, reconnaissant et partageant ses vulnérabilités.
#Conclure ?…
Le recours à l’expérience addictive ne peut être conçu comme une simple *« faute »* ou comme un *« dysfonctionnement »*. Les drogues sont capables d’ubiquité, et le sujet ne se réduit pas à ses comportements, le sens de l’expérience dans le contexte où il vit est essentiel.
À trop faire reposer la régulation des comportements sur le contrôle social par la loi et la judiciarisation, c’est la personne qui est oubliée, dépossédée de ses choix et de ses capacités d’autocontrôle *(Macquet, 2010)*, de ses besoins d’extrême. À l’opposé, le marché et ses acteurs sont exemptés de leurs responsabilités sociales, au nom du seul profit financier.
Sans se passer de la loi et de la médicalisation, le modèle *« régulationniste »* permet de densifier les réponses, notamment dans les secteurs où elles ont été les plus affaiblies *(Couteron, Morel, 2011)*, ajoutant un contrôle du marché des substances et une logique d’intervention précoce.
Il est en cela plus à même de répondre aux besoins des individus et des populations face aux risques de la modernité *(Morel, Couteron, 2011 ; Suissa, 2007)*. Évitant de fonctionner comme une simple injonction à la personne, mobilisant la prise de responsabilité de l’État, la régulation rejoint les propositions du CESE *(2019)* dont un récent rapport invitait à déployer une politique permettant autant de défendre la liberté de ne pas consommer que de réduire les risques du plaisir de le faire.
Hors ligne
Sujets similaires dans les forums, psychowiki et QuizzZ
 |
10 | |
 |
[ Forum ] Actualité - Quelle POURRAIT etre la regulation du cannabis en Suisse
|
1 |
 |
[ Forum ] Opinions - La vie de la drogue vs social
|
3 |
 1
1 0
0 0
0
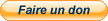 Soutenez PsychoACTIF
Soutenez PsychoACTIF