Vivre avec une addiction en prison (article presse)
Publié par Échec Scolaire,
5343 vues, 0 réponses
5343 vues, 0 réponses
1
- Échec Scolaire

- Nouveau Psycho
- Inscrit le 13 Feb 2022
- 112 messages
Vivre avec une addiction en prison: source Prison Insider
Les personnes souffrant d’addictions sont nombreuses en détention. Elles font face à des difficultés particulières. Les stupéfiants font partie intégrante de l’univers carcéral. Ils sont un moyen de supporter la peine. La prison, souvent surpeuplée et insalubre, multiplie les risques inhérents à la consommation. Les personnes dépendantes se heurtent aux préjugés et aux impératifs sécuritaires propres à l’environnement carcéral. Les soins peinent à se frayer un chemin.
Comment se vit l’addiction derrière les barreaux?
Prison Insider s’interroge sur les enjeux liés aux troubles addictifs en prison, et sur les soins dont peuvent bénéficier les détenus. La parole des personnes dépendantes, de celles qui les accompagnent et de celles qui défendent leurs droits est au cœur de ce dossier. Regards croisés sur les pratiques en Belgique, au Canada, en France, en Irlande et en Moldavie.
Nombreux sont les pays à avoir fait le choix d'un cadre légal répressif en matière de stupéfiants.
Punir la maladie
Près de 30 % des hommes et 51 % des femmes en détention à travers le monde souffriraient d’un trouble lié à l’usage de drogues. Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances estime que 48 % des personnes détenues dans les prisons fédérales sont, ou ont été concernées, par une problématique d’addiction. En Irlande, environ 70 % des personnes entrent en prison avec une addiction.
Les infractions commises par les personnes souffrant d’addictions sont multiformes. Certaines d’entre elles peuvent être commises sous l’emprise de stupéfiants (violences, tapages, etc.), ou dans le but de supporter le coût de la consommation (vols, cambriolages, proxénétisme, etc.). C’est aussi la pénalisation du triptyque trafic-possession-consommation qui contribue à faire entrer les usagers en prison : plus de deux des onze millions de personnes détenues le sont pour des infractions liées à la drogue.
Nombreux sont les pays à avoir fait le choix d’un cadre légal répressif en matière de stupéfiants. En France, l’usage de stupéfiants est un délit passible d’une amende de 200 euros. L’usager risque, en cas de non paiement, jusqu’à un an de prison et 3 750 € d’amende. En Irlande, une personne qui se trouve en possession de stupéfiants, même sans intention de revente, encourt jusqu’à sept ans de prison et une amende d’un montant illimité. En Belgique, elle s’expose à un mois d’emprisonnement et à une amende pouvant aller jusqu’à 800 €.
Certains pays adoptent une démarche moins prohibitionniste. Au Canada, il est autorisé de posséder jusqu’à 30 grammes de cannabis. L’usage de toutes les autres substances est considéré comme une infraction pénale, passible de trois ans d’incarcération. En Moldavie, la possession d’une dose dite “individuelle” d’un produit stupéfiant, quel qu’il soit, n’est pas légalement répréhensible. Au-delà de ce seuil, cela est considéré comme du trafic et une peine d’emprisonnement de 15 ans peut s’appliquer.
Les peines restent lourdes, en dépit des appels à la décriminalisation de la société civile, des organisations internationales, et des experts à travers le monde. Les personnes ayant commis une infraction liée à la drogue représentent une part importante de la population carcérale. Près de 18 % des personnes détenues en Europe étaient, en 2019, incarcérées pour possession, usage ou trafic de stupéfiants. Ce chiffre s’élève à 22,5 % en Belgique, 16 % en France, 10,3 % en Irlande et 7,4 % en Moldavie. Au Canada, entre 2015 et 2016 18 % des personnes incarcérées dans les prisons fédérales1 l’étaient pour des faits liés aux stupéfiants.
Les établissements pénitentiaires fédéraux incarcèrent les personnes ayant été condamnées à des peines de privation de liberté supérieures à deux ans. ↩
70%, c'est la proportion de personnes qui entrent dans les prisons irlandaises en souffrant d’une addiction en 2020
La prison, souvent surpeuplée et insalubre, entame durablement la santé physique et mentale des personnes détenues.
Drogue et prison, mauvais ménage
La prison isole, fragilise, angoisse. Les produits stupéfiants sont souvent appréhendés comme “la seule manière de se détendre, de se calmer, de s’échapper, de se contenir”1 pour supporter la peine et les conditions de détention. Plus de la moitié des personnes détenues en Belgique consommatrices de stupéfiants expliquaient le faire pour supporter le stress lié à la détention. Baptiste*2, anciennement incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis (France), témoigne “Je prends du stup pour me changer les idées et penser à autre chose. On est triste donc on essaie de se donner un sourire. Les règles de la prison sont vraiment différentes de celles à l’extérieur, c’est un autre monde, et je ne le souhaite à personne”.
Les produits semblent particulièrement accessibles : la drogue est jugée omniprésente en détention. Des sources affirment qu’en France, les surveillants seraient “parfaitement au courant”. Cette présence serait tolérée car il s’agit pour les détenus “d’un moyen de se canaliser”.“La pénitentiaire y trouve un intérêt” affirme Solenn Lebret-Dallaserra, doctorante en sociologie carcérale, à l’Université de Grenoble.
Si la consommation est un moyen de supporter la peine, l’environnement carcéral représente pourtant un contexte de consommation particulièrement dangereux. La prison est souvent le théâtre de l’aggravation des schémas de consommation.
“Il arrive qu’une personne entre en prison sans souffrir d’addiction et qu’elle commence à consommer en détention”. Jérome*, anciennement incarcéré à la prison de Fresnes (France), témoigne: “Le soir avant de dormir, tu prends du shit, deux joints. Je ne prenais pas de shit pour dormir à l’extérieur”. Pour Baptiste*, l’incarcération a aussi rimé avec augmentation de la consommation: “Je fumais 4 à 5 joints par jour en détention. À l’extérieur, c’était moins”.
Un suivi psychologique et social est essentiel pour éviter des effets délétères sur la santé mentale des personnes dépendantes. Les dispositifs d’accompagnement peinent pourtant à s’implanter, faute de moyens. Sophie* est travailleuse sociale à Dublin (Irlande). Elle accompagne les détenus souffrant d’addictions et témoigne du manque de ressources humaines: “Ils n’ont pas accès à des conseils précis de façon régulière. Tout ça, c’est lié aux problèmes de sous-effectif. Si je demande à un client s’il a pu voir son conseiller addictions, il va me répondre: “oui, de l’autre côté de la grille, pendant 15minutes”. Je sais que les conseillers font pourtant du mieux qu’ils peuvent. Ils bossent à plein temps. Mais pour, par exemple, 700prisonniers, il y a 4conseillers.” En Moldavie, Svetlana Doltu, ancienne directrice du département de santé de l’administration pénitentiaire, considère qu’il n’y a pas assez de de médecins et d’infirmiers en psychiatrie dans les prisons. Au Canada, le constat est le même: Sandra Ka Hon Chu, co-directrice du réseau juridique VIH, explique qu’il est très difficile d’affecter du personnel de santé spécialisé en psychologie en prison.
La prison, souvent surpeuplée et insalubre, entame durablement la santé physique et mentale des personnes détenues. Elle est un terrain de propagation fertile pour les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). La part des personnes souffrant d’ITSS est bien plus importante en prison qu’à l’extérieur. Les personnes incarcérées sont cinq à 25 fois plus atteintes du VIH dans les prisons canadiennes que dans la population générale. Elles sont presque sept fois plus touchées par l’hépatite C dans les établissements pénitentiaires belges. En France, elles sont entre trois et cinq fois plus affectées par le VIH et quatre à cinq fois plus par l’hépatite C.
Le risque de transmission et de contraction des ITSS est particulièrement accru chez les personnes qui s’injectent ou inhalent des stupéfiants. Anne-Claire Bréchet Bachmann, médecin pénitentiaire en Suisse, explique comment circulent ces maladies : “Il y a bien entendu les contacts sexuels sans protection. Les usages et les comportements des personnes qui souffrent d’addiction sont également d’importants facteurs de risque. Pour accéder à leur produit, elles sont nombreuses à utiliser et à échanger des seringues ou des pailles. Les personnes détenues peuvent également se prêter des rasoirs pour s’épiler, se raser la barbe ou se tondre les cheveux. Cet usage est propice à la transmission de maladies dès lors que des gouttelettes de sang peuvent rester sur les lames.”
Steve Simons, détenu 13 ans dans une prison fédérale canadienne, raconte: “Je n’ai jamais partagé mon matériel d’injection car je connaissais les risques. Mais un jour, un codétenu a pris ma trousse dans ma cellule et a utilisé mon matériel à mon insu. Quelques mois plus tard, j’ai reçu un résultat positif à un dépistage de l’hépatite C”.
TISSOT Nina, “Prise et déprise : faire usage de drogue en prison”, Rhizome, 2016/4 (N° 62), p. 13-15. ↩
L’argument sécuritaire est largement invoqué pour justifier le refus de mettre en place des interventions de réduction des risques.
Place aux soins : des solutions...
De nombreuses mesures existent pour protéger la santé des personnes souffrant d’addictions. Opérations de sensibilisation et d’information sur les ITSS, dépistages, campagnes de vaccination, traitements de substitution, fourniture de moyens de consommation sécurisés (kit d’injections, seringues, pailles) : l’éventail des dispositifs est large. Celui-ci s’inscrit dans une politique globale de réduction des risques: une approche se concentrant sur la prévention plutôt que sur le sevrage. Elle vise à “prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse et les dommages sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie par des substances classées comme stupéfiants1”. La réduction des risques est née du constat que la drogue ne cessera pas de circuler dans la société et qu’il est urgent de faire priorité aux soins.
Certains pays mettent en place des dispositifs de réduction des risques au sein des prisons, à l’échelle nationale. En Moldavie, un programme d’échange de seringues existe depuis plus de 20 ans. Les personnes détenues s’injectant des produits stupéfiants peuvent accéder, sans que les membres de l’administration pénitentiaire en soient informés, à du matériel d’injection stérile. Elles ont le choix de récupérer le matériel par le biais d’autres détenus - des “pairs” formés par une association - , ou lors de visite d’associations et de leurs proches. Le programme est gratuit et des collecteurs de seringues et d’aiguilles sont installés dans les espaces communs.
ONUSIDA observe une chute des taux de prévalence des hépatites B et C dans les prisons moldaves. La proportion de personnes atteintes d’hépatite C passe de 8,6 % en 2012 à 3,6 % en 2021. Entre 2012 et 2021, le taux de prévalence de l’hépatite B en détention passe de 13,1 % à 1,6 %.
Les dispositifs de traitement de substitution aux opiacés (TSO) sont plus largement acceptés. Ceux-ci sont mis en œuvre dans les prisons belges, canadiennes, françaises, irlandaises et moldaves. Les TSO permettent de prescrire des médicaments aux personnes dépendantes aux opiacés pour atténuer les symptômes du manque ressenti lors de la diminution ou de l’arrêt de la consommation2.
En France, Olivier Bagnis, ancien responsable du centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) de la prison des Baumettes explique: “Globalement, il n’y a pas d’ostracisme envers les personnes qui prennent les traitements de substitution, le personnel comprend que c’est simplement un traitement que les détenus doivent prendre tous les jours”.
Des obstacles relatifs à la confidentialité subsistent toutefois. Sophie*, travailleuse sociale à Dublin (Irlande), remarque: “Il y a beaucoup de honte autour du fait de prendre un traitement de substitution. La prise n’est pas confidentielle, les détenus doivent se rendre dans l’unité sanitaire, et tout le monde sait ce qu’ils y font”. En Moldavie, Svetlana Doltu explique: “La disponibilité est assurée mais peu de détenus demandent à y accéder, notamment car ils doivent prendre leur traitement devant le personnel médical”.
Ministère de la Santé et de la Prévention: “La réduction des risques et des dommages chez les usagers de drogues”. ↩
Les opiacés sont les substances contenant de l’opium, dont la codéine, l’héroïne ou le fentanyl. ↩
...et autant d'obstacles
La réduction des risques peine pourtant à s’implanter durablement. Sujettes à de vives oppositions dans la société, ces mesures sont encore plus difficiles à (faire) accepter en détention. La prison est confrontée à un dilemme: Comment faire entrer, au sein d’un lieu si restrictif, ce type d’interventions?
Irène Aboudaram et Marie Hornsperger ont travaillé pour Médecins du Monde à la mise en œuvre d’actions de promotion de la santé à la prison de Nantes-Carquefou (France). Pour elles, “les surveillants pénitentiaires font face à un problème éthique. Il leur est difficile de se dire qu’ils vont accompagner une consommation de produit qui est illicite et qui, en plus, n’aurait jamais dû pénétrer les murs de la prison”.
L’argument sécuritaire est largement invoqué pour justifier le refus de mettre en place des interventions de réduction des risques. Cela est particulièrement le cas s’agissant des programmes d’échange de seringues. La France, la Belgique et l’Irlande ne prévoient pas de tels programmes en détention. L’échange de seringues questionne, inquiète. Sandra Ka Hon Chu, du réseau juridique VIH, explique que les surveillants ont peur que les seringues soient utilisées comme des armes. Les constats des professionnels de santé ne vont pourtant pas dans ce sens. Svetlana Doltu expliquequ’“en 20 ans d’échange de seringues dans les prisons moldaves, nous n’avons recensé aucune agression avec les seringues“
Au Canada, un programme d’échange de seringues existe depuis 2018. Il voit le jour à la suite d’une longue bataille judiciaire menée par des organisations de la société civile. Celles-ci estimaient que l’absence de mise à disposition de matériel stérile nuisait à la santé des personnes incarcérées. Dans les faits, le dispositif reste très peu utilisé. “Pour avoir accès au programme d’échange de seringues, les personnes détenues doivent franchir énormément d’obstacles”, explique Sandra Ka Hon Chu. Les personnes détenues doivent d’abord prévenir les infirmières, qui avertissent à leur tour le surveillant en chef. Elles peuvent donc librement accéder au programme, mais à condition de renoncer à leur anonymat. “Le modèle d’échange de seringues dans les prisons canadiennes ne correspond à aucun de ceux recommandés par les Nations unies. Si les gardiens savent qui est dans le programme, ils vont surveiller le détenu plus intensivement. Ils seront plus susceptibles de fouiller sa cellule et de punir le détenu, car la drogue est toujours interdite.”, regrette Sandra Ka Hon Chu. Ces modalités dissuadent les personnes qui en auraient besoin d’intégrer le programme. Le réseau juridique VIH considère que l’existence du programme est une bonne nouvelle “mais que ce n’est pas le bon. Le résultat, c’est que des gens continuent à partager leurs seringues”.
Des produits désinfectants sont parfois distribués en lieu et en place de matériel stérile. En France, le guide du détenu arrivant indique que l’administration fournit, tous les 15 jours, un flacon d’eau de Javel à 12° pour décontaminer tous les objets qui peuvent être en contact avec le sang (rasoir, aiguille, tondeuse).
La distribution est, dans les faits, laborieuse. Olivier Bagnis en témoigne: “La javel c’est des allers-retours sans arrêt. Depuis 12 ans que je suis en détention, c’est à n’en plus finir. On en est arrivé à un point où c’est nous [les équipes médicales] qui la distribuons. Elle devrait normalement être distribuée par l’administration pénitentiaire, mais ce n’est pas systématiquement le cas”. Son efficacité est également mise en cause, y compris par Médecins du Monde : “La javel est diluée à 12° pour limiter les risques d’intoxication et les suicides par ingestion. Rien ne prouve qu’un taux de concentration si faible permette une désinfection correcte de quoi que ce soit.”
Éviter les incidents et les agressions, prévenir les suicides: autant de justifications pour expliquer que certains dispositifs de réduction des risques peinent à entrer en prison. L’argument sécuritaire montre ses limites, tandis que l’administration peine parfois à expliquer ses réticences. C’est le cas pour la distribution de préservatifs. En France, le guide arrivant précise que des préservatifs sont mis gratuitement à disposition par l’administration pénitentiaire et par le personnel sanitaire. Olivier Bagnis explique néanmoins que, de façon générale, “c’est très difficile de donner des préservatifs, il y a toujours une réticence. De la part de l’administration pénitentiaire mais aussi des détenus. L’administration dit qu’il n’y a pas de sexualité en prison, c’est un discours qui est faux, mais auquel elle tient. C’est un non-dit général, il n’y a pas d’argument. L’homosexualité masculine en détention est très mal assumée et acceptée.” Les préservatifs, quand ils peuvent être distribués, ne le sont souvent, en pratique, qu’à l’unité sanitaire, comme l’explique Mélanie Kinné, responsable des unités sanitaires en milieu pénitentiaire pour le CHU de Nîmes.
En Irlande, l’accès au préservatif est également jugé difficile. Sophie*, travailleuse sociale en détention, explique : “Je connais un prisonnier qui a demandé un préservatif à la prison de Wheatfield. On le lui a donné, mais ça avait fait sensation (2014). On est extrêmement rétrogrades dès que quelque chose concerne de près ou de loin le sexe.” Au Canada, Sandra Ka Hon Chu rapporte qu’il est prévu que des préservatifs, du lubrifiant et des digues dentaires1 soient mis à disposition. Elle précise que les situations varient d’une prison à l’autre, et qu’en pratique, les prisonniers font état de difficultés d’accès.
Certains personnels de santé, en l’absence de dispositifs officiels, prennent des initiatives personnelles. Ces personnels prodiguent, au sein de l’unité sanitaire, les soins nécessaires avec ou sans l’assentiment de l’administration pénitentiaire. Pour Médecins du Monde, “c’est encourageant de voir que des personnes mettent en place de tels dispositifs. En revanche, il n’y a aucune harmonisation. Le jour où le médecin qui distribue des seringues part à la retraite, tout le dispositif cesse. Cela pose vraiment la question de la pérennité de ces initiatives.”
La digue dentaire est un carré ou un rectangle de latex ou de polyuréthane qui permet de se protéger lors de rapports sexuels oraux. ↩
Survivre à la sortie
Les personnes souffrant d’addictions ayant bénéficié d’un suivi médical et psychosocial en prison voient souvent leurs soins s’interrompre brutalement à la sortie. L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations unies (aussi appelées “Règles Nelson Mandela”) exigent que les services de santé soient organisés “de manière à faciliter la continuité du traitement et des soins, notamment pour le VIH, la tuberculose et d’autres maladies infectieuses, ainsi que pour la toxicomanie1”.
Le respect du principe de continuité des soins implique notamment que les personnes ayant poursuivi ou commencé un traitement en détention continuent d’y avoir accès une fois en liberté. En Irlande, l’association FusionCPL met en lien les personnes sortantes de prison avec des médecins à l’extérieur. L’objectif est qu’elles puissent bénéficier de leur traitement de substitution dès le jour de leur sortie. Dans le cas contraire, la sortie est repoussée.
En France, les médecins n’ont parfois pas l’occasion de voir leurs patients avant leur sortie. Ces derniers risquent de voir leur traitement interrompu et de rechuter. Des initiatives personnelles sont observées dans certaines prisons. Mélanie Kinné explique qu’à Nîmes “lorsqu’il y a des sorties programmées, nous recevons la personne, pour lui donner des ordonnances sécurisées, et nous lui avançons trois jours de traitement, pour qu’il n’y ait pas de rupture de soins”. En Belgique, la continuité des soins à la sortie est jugée encore moins satisfaisante. L’Ambulatoire Forest constate que “dans la plupart des cas, les personnes sortent sans le traitement de substitution qu’elles suivaient en détention. Elles doivent attendre de voir un médecin à l’extérieur”.
Tolérance à la substance diminuée, risque de rechute, interruption des soins: la semaine suivant la sortie, les anciens détenus sont 37 fois plus à risque de décéder des suites d’une overdose que le reste de la population consommatrice. Certains produits permettent, en cas d’overdose, d’éviter une issue fatale. La Naloxone peut, dans le cas d’une overdose aux opiacés, être prescrite en tant qu’antidote. Dans les prisons fédérales canadiennes, ce médicament peut être donné à la sortie. En France, la situation varie selon l’établissement.
“La rechute fait souvent partie du parcours, et malheureusement pour les personnes sous main de justice, elle est susceptible de correspondre à un retour à l’incarcération”, rappelle l’Ambulatoire Forest.
Contributions
Prison Insider promeut une approche collaborative de l’information : ce dossier recueille les regards d’experts et de personnes concernées par les problématiques d’addictions aux drogues en détention, sans prétendre à l’exhaustivité. Elles ont contribué à ce travail :
Irène Aboudaram (Médecins du Monde, France), Olivier Bagnis (ancien responsable du centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie de la prison des Baumettes, France), Baptiste* (ancien détenu à la prison de Fleury-Mérogis, France), Saoirse Brady (Irish Penal Reform Trust, Irlande), Anne-Claire Bréchet Bachmann (unité mobile de médecine pénitentiaire des établissements de la Brenaz, Clairière, Favra, Vallon et Villars, Suisse), Svetlana Doltu (Act For Involvement, Moldavie), Ganna Dovbakh (Eurasian Harm Reduction Association, Lituanie), Pamela Drumgoole (Irish Penal Reform Trust, Irlande), Christophe Henrion (Ambulatoire Forest, Belgique), Marie Hornsperger (ancienne coordinatrice du programme de promotion de la santé à la prison de Nantes Carquefou, Médecin du Monde), Jérome* (ancien détenu à la prison de Fresnes, France) Sandra Ka Hon Chu (Réseau juridique VIH, Canada), Mélanie Kinné (service de l’unité de soins en milieu pénitentiaire du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes, France) Solenn Lebret-Dallaserra (doctorante en sociologie carcérale, France), Kris Meurant (ASBL Transit, Belgique), Violeta Mejia (Ambulatoire Forest, Belgique), Ridha Nouiouat (Sidaction, France), Sophie* (travailleuse sociale)
Les personnes souffrant d’addictions sont nombreuses en détention. Elles font face à des difficultés particulières. Les stupéfiants font partie intégrante de l’univers carcéral. Ils sont un moyen de supporter la peine. La prison, souvent surpeuplée et insalubre, multiplie les risques inhérents à la consommation. Les personnes dépendantes se heurtent aux préjugés et aux impératifs sécuritaires propres à l’environnement carcéral. Les soins peinent à se frayer un chemin.
Comment se vit l’addiction derrière les barreaux?
Prison Insider s’interroge sur les enjeux liés aux troubles addictifs en prison, et sur les soins dont peuvent bénéficier les détenus. La parole des personnes dépendantes, de celles qui les accompagnent et de celles qui défendent leurs droits est au cœur de ce dossier. Regards croisés sur les pratiques en Belgique, au Canada, en France, en Irlande et en Moldavie.
Nombreux sont les pays à avoir fait le choix d'un cadre légal répressif en matière de stupéfiants.
Punir la maladie
Près de 30 % des hommes et 51 % des femmes en détention à travers le monde souffriraient d’un trouble lié à l’usage de drogues. Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances estime que 48 % des personnes détenues dans les prisons fédérales sont, ou ont été concernées, par une problématique d’addiction. En Irlande, environ 70 % des personnes entrent en prison avec une addiction.
Les infractions commises par les personnes souffrant d’addictions sont multiformes. Certaines d’entre elles peuvent être commises sous l’emprise de stupéfiants (violences, tapages, etc.), ou dans le but de supporter le coût de la consommation (vols, cambriolages, proxénétisme, etc.). C’est aussi la pénalisation du triptyque trafic-possession-consommation qui contribue à faire entrer les usagers en prison : plus de deux des onze millions de personnes détenues le sont pour des infractions liées à la drogue.
Nombreux sont les pays à avoir fait le choix d’un cadre légal répressif en matière de stupéfiants. En France, l’usage de stupéfiants est un délit passible d’une amende de 200 euros. L’usager risque, en cas de non paiement, jusqu’à un an de prison et 3 750 € d’amende. En Irlande, une personne qui se trouve en possession de stupéfiants, même sans intention de revente, encourt jusqu’à sept ans de prison et une amende d’un montant illimité. En Belgique, elle s’expose à un mois d’emprisonnement et à une amende pouvant aller jusqu’à 800 €.
Certains pays adoptent une démarche moins prohibitionniste. Au Canada, il est autorisé de posséder jusqu’à 30 grammes de cannabis. L’usage de toutes les autres substances est considéré comme une infraction pénale, passible de trois ans d’incarcération. En Moldavie, la possession d’une dose dite “individuelle” d’un produit stupéfiant, quel qu’il soit, n’est pas légalement répréhensible. Au-delà de ce seuil, cela est considéré comme du trafic et une peine d’emprisonnement de 15 ans peut s’appliquer.
Les peines restent lourdes, en dépit des appels à la décriminalisation de la société civile, des organisations internationales, et des experts à travers le monde. Les personnes ayant commis une infraction liée à la drogue représentent une part importante de la population carcérale. Près de 18 % des personnes détenues en Europe étaient, en 2019, incarcérées pour possession, usage ou trafic de stupéfiants. Ce chiffre s’élève à 22,5 % en Belgique, 16 % en France, 10,3 % en Irlande et 7,4 % en Moldavie. Au Canada, entre 2015 et 2016 18 % des personnes incarcérées dans les prisons fédérales1 l’étaient pour des faits liés aux stupéfiants.
Les établissements pénitentiaires fédéraux incarcèrent les personnes ayant été condamnées à des peines de privation de liberté supérieures à deux ans. ↩
70%, c'est la proportion de personnes qui entrent dans les prisons irlandaises en souffrant d’une addiction en 2020
La prison, souvent surpeuplée et insalubre, entame durablement la santé physique et mentale des personnes détenues.
Drogue et prison, mauvais ménage
La prison isole, fragilise, angoisse. Les produits stupéfiants sont souvent appréhendés comme “la seule manière de se détendre, de se calmer, de s’échapper, de se contenir”1 pour supporter la peine et les conditions de détention. Plus de la moitié des personnes détenues en Belgique consommatrices de stupéfiants expliquaient le faire pour supporter le stress lié à la détention. Baptiste*2, anciennement incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis (France), témoigne “Je prends du stup pour me changer les idées et penser à autre chose. On est triste donc on essaie de se donner un sourire. Les règles de la prison sont vraiment différentes de celles à l’extérieur, c’est un autre monde, et je ne le souhaite à personne”.
Les produits semblent particulièrement accessibles : la drogue est jugée omniprésente en détention. Des sources affirment qu’en France, les surveillants seraient “parfaitement au courant”. Cette présence serait tolérée car il s’agit pour les détenus “d’un moyen de se canaliser”.“La pénitentiaire y trouve un intérêt” affirme Solenn Lebret-Dallaserra, doctorante en sociologie carcérale, à l’Université de Grenoble.
Si la consommation est un moyen de supporter la peine, l’environnement carcéral représente pourtant un contexte de consommation particulièrement dangereux. La prison est souvent le théâtre de l’aggravation des schémas de consommation.
“Il arrive qu’une personne entre en prison sans souffrir d’addiction et qu’elle commence à consommer en détention”. Jérome*, anciennement incarcéré à la prison de Fresnes (France), témoigne: “Le soir avant de dormir, tu prends du shit, deux joints. Je ne prenais pas de shit pour dormir à l’extérieur”. Pour Baptiste*, l’incarcération a aussi rimé avec augmentation de la consommation: “Je fumais 4 à 5 joints par jour en détention. À l’extérieur, c’était moins”.
Un suivi psychologique et social est essentiel pour éviter des effets délétères sur la santé mentale des personnes dépendantes. Les dispositifs d’accompagnement peinent pourtant à s’implanter, faute de moyens. Sophie* est travailleuse sociale à Dublin (Irlande). Elle accompagne les détenus souffrant d’addictions et témoigne du manque de ressources humaines: “Ils n’ont pas accès à des conseils précis de façon régulière. Tout ça, c’est lié aux problèmes de sous-effectif. Si je demande à un client s’il a pu voir son conseiller addictions, il va me répondre: “oui, de l’autre côté de la grille, pendant 15minutes”. Je sais que les conseillers font pourtant du mieux qu’ils peuvent. Ils bossent à plein temps. Mais pour, par exemple, 700prisonniers, il y a 4conseillers.” En Moldavie, Svetlana Doltu, ancienne directrice du département de santé de l’administration pénitentiaire, considère qu’il n’y a pas assez de de médecins et d’infirmiers en psychiatrie dans les prisons. Au Canada, le constat est le même: Sandra Ka Hon Chu, co-directrice du réseau juridique VIH, explique qu’il est très difficile d’affecter du personnel de santé spécialisé en psychologie en prison.
La prison, souvent surpeuplée et insalubre, entame durablement la santé physique et mentale des personnes détenues. Elle est un terrain de propagation fertile pour les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). La part des personnes souffrant d’ITSS est bien plus importante en prison qu’à l’extérieur. Les personnes incarcérées sont cinq à 25 fois plus atteintes du VIH dans les prisons canadiennes que dans la population générale. Elles sont presque sept fois plus touchées par l’hépatite C dans les établissements pénitentiaires belges. En France, elles sont entre trois et cinq fois plus affectées par le VIH et quatre à cinq fois plus par l’hépatite C.
Le risque de transmission et de contraction des ITSS est particulièrement accru chez les personnes qui s’injectent ou inhalent des stupéfiants. Anne-Claire Bréchet Bachmann, médecin pénitentiaire en Suisse, explique comment circulent ces maladies : “Il y a bien entendu les contacts sexuels sans protection. Les usages et les comportements des personnes qui souffrent d’addiction sont également d’importants facteurs de risque. Pour accéder à leur produit, elles sont nombreuses à utiliser et à échanger des seringues ou des pailles. Les personnes détenues peuvent également se prêter des rasoirs pour s’épiler, se raser la barbe ou se tondre les cheveux. Cet usage est propice à la transmission de maladies dès lors que des gouttelettes de sang peuvent rester sur les lames.”
Steve Simons, détenu 13 ans dans une prison fédérale canadienne, raconte: “Je n’ai jamais partagé mon matériel d’injection car je connaissais les risques. Mais un jour, un codétenu a pris ma trousse dans ma cellule et a utilisé mon matériel à mon insu. Quelques mois plus tard, j’ai reçu un résultat positif à un dépistage de l’hépatite C”.
TISSOT Nina, “Prise et déprise : faire usage de drogue en prison”, Rhizome, 2016/4 (N° 62), p. 13-15. ↩
L’argument sécuritaire est largement invoqué pour justifier le refus de mettre en place des interventions de réduction des risques.
Place aux soins : des solutions...
De nombreuses mesures existent pour protéger la santé des personnes souffrant d’addictions. Opérations de sensibilisation et d’information sur les ITSS, dépistages, campagnes de vaccination, traitements de substitution, fourniture de moyens de consommation sécurisés (kit d’injections, seringues, pailles) : l’éventail des dispositifs est large. Celui-ci s’inscrit dans une politique globale de réduction des risques: une approche se concentrant sur la prévention plutôt que sur le sevrage. Elle vise à “prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse et les dommages sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie par des substances classées comme stupéfiants1”. La réduction des risques est née du constat que la drogue ne cessera pas de circuler dans la société et qu’il est urgent de faire priorité aux soins.
Certains pays mettent en place des dispositifs de réduction des risques au sein des prisons, à l’échelle nationale. En Moldavie, un programme d’échange de seringues existe depuis plus de 20 ans. Les personnes détenues s’injectant des produits stupéfiants peuvent accéder, sans que les membres de l’administration pénitentiaire en soient informés, à du matériel d’injection stérile. Elles ont le choix de récupérer le matériel par le biais d’autres détenus - des “pairs” formés par une association - , ou lors de visite d’associations et de leurs proches. Le programme est gratuit et des collecteurs de seringues et d’aiguilles sont installés dans les espaces communs.
ONUSIDA observe une chute des taux de prévalence des hépatites B et C dans les prisons moldaves. La proportion de personnes atteintes d’hépatite C passe de 8,6 % en 2012 à 3,6 % en 2021. Entre 2012 et 2021, le taux de prévalence de l’hépatite B en détention passe de 13,1 % à 1,6 %.
Les dispositifs de traitement de substitution aux opiacés (TSO) sont plus largement acceptés. Ceux-ci sont mis en œuvre dans les prisons belges, canadiennes, françaises, irlandaises et moldaves. Les TSO permettent de prescrire des médicaments aux personnes dépendantes aux opiacés pour atténuer les symptômes du manque ressenti lors de la diminution ou de l’arrêt de la consommation2.
En France, Olivier Bagnis, ancien responsable du centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) de la prison des Baumettes explique: “Globalement, il n’y a pas d’ostracisme envers les personnes qui prennent les traitements de substitution, le personnel comprend que c’est simplement un traitement que les détenus doivent prendre tous les jours”.
Des obstacles relatifs à la confidentialité subsistent toutefois. Sophie*, travailleuse sociale à Dublin (Irlande), remarque: “Il y a beaucoup de honte autour du fait de prendre un traitement de substitution. La prise n’est pas confidentielle, les détenus doivent se rendre dans l’unité sanitaire, et tout le monde sait ce qu’ils y font”. En Moldavie, Svetlana Doltu explique: “La disponibilité est assurée mais peu de détenus demandent à y accéder, notamment car ils doivent prendre leur traitement devant le personnel médical”.
Ministère de la Santé et de la Prévention: “La réduction des risques et des dommages chez les usagers de drogues”. ↩
Les opiacés sont les substances contenant de l’opium, dont la codéine, l’héroïne ou le fentanyl. ↩
...et autant d'obstacles
La réduction des risques peine pourtant à s’implanter durablement. Sujettes à de vives oppositions dans la société, ces mesures sont encore plus difficiles à (faire) accepter en détention. La prison est confrontée à un dilemme: Comment faire entrer, au sein d’un lieu si restrictif, ce type d’interventions?
Irène Aboudaram et Marie Hornsperger ont travaillé pour Médecins du Monde à la mise en œuvre d’actions de promotion de la santé à la prison de Nantes-Carquefou (France). Pour elles, “les surveillants pénitentiaires font face à un problème éthique. Il leur est difficile de se dire qu’ils vont accompagner une consommation de produit qui est illicite et qui, en plus, n’aurait jamais dû pénétrer les murs de la prison”.
L’argument sécuritaire est largement invoqué pour justifier le refus de mettre en place des interventions de réduction des risques. Cela est particulièrement le cas s’agissant des programmes d’échange de seringues. La France, la Belgique et l’Irlande ne prévoient pas de tels programmes en détention. L’échange de seringues questionne, inquiète. Sandra Ka Hon Chu, du réseau juridique VIH, explique que les surveillants ont peur que les seringues soient utilisées comme des armes. Les constats des professionnels de santé ne vont pourtant pas dans ce sens. Svetlana Doltu expliquequ’“en 20 ans d’échange de seringues dans les prisons moldaves, nous n’avons recensé aucune agression avec les seringues“
Au Canada, un programme d’échange de seringues existe depuis 2018. Il voit le jour à la suite d’une longue bataille judiciaire menée par des organisations de la société civile. Celles-ci estimaient que l’absence de mise à disposition de matériel stérile nuisait à la santé des personnes incarcérées. Dans les faits, le dispositif reste très peu utilisé. “Pour avoir accès au programme d’échange de seringues, les personnes détenues doivent franchir énormément d’obstacles”, explique Sandra Ka Hon Chu. Les personnes détenues doivent d’abord prévenir les infirmières, qui avertissent à leur tour le surveillant en chef. Elles peuvent donc librement accéder au programme, mais à condition de renoncer à leur anonymat. “Le modèle d’échange de seringues dans les prisons canadiennes ne correspond à aucun de ceux recommandés par les Nations unies. Si les gardiens savent qui est dans le programme, ils vont surveiller le détenu plus intensivement. Ils seront plus susceptibles de fouiller sa cellule et de punir le détenu, car la drogue est toujours interdite.”, regrette Sandra Ka Hon Chu. Ces modalités dissuadent les personnes qui en auraient besoin d’intégrer le programme. Le réseau juridique VIH considère que l’existence du programme est une bonne nouvelle “mais que ce n’est pas le bon. Le résultat, c’est que des gens continuent à partager leurs seringues”.
Des produits désinfectants sont parfois distribués en lieu et en place de matériel stérile. En France, le guide du détenu arrivant indique que l’administration fournit, tous les 15 jours, un flacon d’eau de Javel à 12° pour décontaminer tous les objets qui peuvent être en contact avec le sang (rasoir, aiguille, tondeuse).
La distribution est, dans les faits, laborieuse. Olivier Bagnis en témoigne: “La javel c’est des allers-retours sans arrêt. Depuis 12 ans que je suis en détention, c’est à n’en plus finir. On en est arrivé à un point où c’est nous [les équipes médicales] qui la distribuons. Elle devrait normalement être distribuée par l’administration pénitentiaire, mais ce n’est pas systématiquement le cas”. Son efficacité est également mise en cause, y compris par Médecins du Monde : “La javel est diluée à 12° pour limiter les risques d’intoxication et les suicides par ingestion. Rien ne prouve qu’un taux de concentration si faible permette une désinfection correcte de quoi que ce soit.”
Éviter les incidents et les agressions, prévenir les suicides: autant de justifications pour expliquer que certains dispositifs de réduction des risques peinent à entrer en prison. L’argument sécuritaire montre ses limites, tandis que l’administration peine parfois à expliquer ses réticences. C’est le cas pour la distribution de préservatifs. En France, le guide arrivant précise que des préservatifs sont mis gratuitement à disposition par l’administration pénitentiaire et par le personnel sanitaire. Olivier Bagnis explique néanmoins que, de façon générale, “c’est très difficile de donner des préservatifs, il y a toujours une réticence. De la part de l’administration pénitentiaire mais aussi des détenus. L’administration dit qu’il n’y a pas de sexualité en prison, c’est un discours qui est faux, mais auquel elle tient. C’est un non-dit général, il n’y a pas d’argument. L’homosexualité masculine en détention est très mal assumée et acceptée.” Les préservatifs, quand ils peuvent être distribués, ne le sont souvent, en pratique, qu’à l’unité sanitaire, comme l’explique Mélanie Kinné, responsable des unités sanitaires en milieu pénitentiaire pour le CHU de Nîmes.
En Irlande, l’accès au préservatif est également jugé difficile. Sophie*, travailleuse sociale en détention, explique : “Je connais un prisonnier qui a demandé un préservatif à la prison de Wheatfield. On le lui a donné, mais ça avait fait sensation (2014). On est extrêmement rétrogrades dès que quelque chose concerne de près ou de loin le sexe.” Au Canada, Sandra Ka Hon Chu rapporte qu’il est prévu que des préservatifs, du lubrifiant et des digues dentaires1 soient mis à disposition. Elle précise que les situations varient d’une prison à l’autre, et qu’en pratique, les prisonniers font état de difficultés d’accès.
Certains personnels de santé, en l’absence de dispositifs officiels, prennent des initiatives personnelles. Ces personnels prodiguent, au sein de l’unité sanitaire, les soins nécessaires avec ou sans l’assentiment de l’administration pénitentiaire. Pour Médecins du Monde, “c’est encourageant de voir que des personnes mettent en place de tels dispositifs. En revanche, il n’y a aucune harmonisation. Le jour où le médecin qui distribue des seringues part à la retraite, tout le dispositif cesse. Cela pose vraiment la question de la pérennité de ces initiatives.”
La digue dentaire est un carré ou un rectangle de latex ou de polyuréthane qui permet de se protéger lors de rapports sexuels oraux. ↩
Survivre à la sortie
Les personnes souffrant d’addictions ayant bénéficié d’un suivi médical et psychosocial en prison voient souvent leurs soins s’interrompre brutalement à la sortie. L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations unies (aussi appelées “Règles Nelson Mandela”) exigent que les services de santé soient organisés “de manière à faciliter la continuité du traitement et des soins, notamment pour le VIH, la tuberculose et d’autres maladies infectieuses, ainsi que pour la toxicomanie1”.
Le respect du principe de continuité des soins implique notamment que les personnes ayant poursuivi ou commencé un traitement en détention continuent d’y avoir accès une fois en liberté. En Irlande, l’association FusionCPL met en lien les personnes sortantes de prison avec des médecins à l’extérieur. L’objectif est qu’elles puissent bénéficier de leur traitement de substitution dès le jour de leur sortie. Dans le cas contraire, la sortie est repoussée.
En France, les médecins n’ont parfois pas l’occasion de voir leurs patients avant leur sortie. Ces derniers risquent de voir leur traitement interrompu et de rechuter. Des initiatives personnelles sont observées dans certaines prisons. Mélanie Kinné explique qu’à Nîmes “lorsqu’il y a des sorties programmées, nous recevons la personne, pour lui donner des ordonnances sécurisées, et nous lui avançons trois jours de traitement, pour qu’il n’y ait pas de rupture de soins”. En Belgique, la continuité des soins à la sortie est jugée encore moins satisfaisante. L’Ambulatoire Forest constate que “dans la plupart des cas, les personnes sortent sans le traitement de substitution qu’elles suivaient en détention. Elles doivent attendre de voir un médecin à l’extérieur”.
Tolérance à la substance diminuée, risque de rechute, interruption des soins: la semaine suivant la sortie, les anciens détenus sont 37 fois plus à risque de décéder des suites d’une overdose que le reste de la population consommatrice. Certains produits permettent, en cas d’overdose, d’éviter une issue fatale. La Naloxone peut, dans le cas d’une overdose aux opiacés, être prescrite en tant qu’antidote. Dans les prisons fédérales canadiennes, ce médicament peut être donné à la sortie. En France, la situation varie selon l’établissement.
“La rechute fait souvent partie du parcours, et malheureusement pour les personnes sous main de justice, elle est susceptible de correspondre à un retour à l’incarcération”, rappelle l’Ambulatoire Forest.
Contributions
Prison Insider promeut une approche collaborative de l’information : ce dossier recueille les regards d’experts et de personnes concernées par les problématiques d’addictions aux drogues en détention, sans prétendre à l’exhaustivité. Elles ont contribué à ce travail :
Irène Aboudaram (Médecins du Monde, France), Olivier Bagnis (ancien responsable du centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie de la prison des Baumettes, France), Baptiste* (ancien détenu à la prison de Fleury-Mérogis, France), Saoirse Brady (Irish Penal Reform Trust, Irlande), Anne-Claire Bréchet Bachmann (unité mobile de médecine pénitentiaire des établissements de la Brenaz, Clairière, Favra, Vallon et Villars, Suisse), Svetlana Doltu (Act For Involvement, Moldavie), Ganna Dovbakh (Eurasian Harm Reduction Association, Lituanie), Pamela Drumgoole (Irish Penal Reform Trust, Irlande), Christophe Henrion (Ambulatoire Forest, Belgique), Marie Hornsperger (ancienne coordinatrice du programme de promotion de la santé à la prison de Nantes Carquefou, Médecin du Monde), Jérome* (ancien détenu à la prison de Fresnes, France) Sandra Ka Hon Chu (Réseau juridique VIH, Canada), Mélanie Kinné (service de l’unité de soins en milieu pénitentiaire du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes, France) Solenn Lebret-Dallaserra (doctorante en sociologie carcérale, France), Kris Meurant (ASBL Transit, Belgique), Violeta Mejia (Ambulatoire Forest, Belgique), Ridha Nouiouat (Sidaction, France), Sophie* (travailleuse sociale)
Hors ligne
Sujets similaires dans les forums, psychowiki et QuizzZ
 |
[ Forum ] Addiction - Documentaire: Addiction Vivre Sans [émission Infrarouge, F2, 01/10/2019]
|
1 |
 |
[ Forum ] Article sur les causes de l'addiction
|
15 |
 |
13 |
 1
1 0
0 0
0
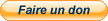 Soutenez PsychoACTIF
Soutenez PsychoACTIF