Du trafic de drogue au « narcotrafic », une bascule sémantique et politique
2278 vues, 3 réponses
1
A l’automne, le terme a été utilisé par le ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau, au moment où était lancée une vaste offensive contre le trafic de stupéfiants. En important en France un imaginaire latino-américain de cartels et de gangs, il accompagne une politique du tout-répressif.
Histoire d’une notion. Actuellement discutée au Sénat, la proposition de loi pour « sortir la France du piège du narcotrafic » apporte déjà une certitude : en appelant « narcotrafic » ce que le code pénal qualifie officiellement de « trafic de stupéfiants », elle ancre un terme dont l’irruption est à la fois récente et fulgurante. Les recherches du mot sur Google France, quasiment nulles depuis vingt ans, sont montées en flèche depuis début 2024. D’une occurrence proche de zéro dans les médias, l’emploi de ce mot a explosé parallèlement dans les trois bases de données de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) – journaux, radios, chaînes d’information en continu. Ces données rendent compte d’une offensive lexicale impulsée il y a un peu plus d’un an par Bruno Retailleau.
A l’automne 2023, le président du groupe Les Républicains au Sénat dépose une proposition de résolution créant une commission d’enquête sur l’impact du « narcotrafic » en France. Le mot est lancé, et contesté par une partie de la gauche. Le rapport du Sénat, lui, débouche, en mai 2024, sur des conclusions alarmantes : le narcotrafic pose une « menace existentielle pour les institutions et pour la démocratie ». Ces conclusions nourrissent la proposition de loi soumise au vote mardi 4 février au Sénat, axée sur le renseignement et la répression, mais aussi le discours de Bruno Retailleau, qui, entre-temps, est devenu ministre de l’intérieur.
A partir d’une interview à BFM-TV, le 1er novembre 2024, son compte X atteste de l’emploi récurrent, non plus des termes « trafic de stupéfiants », qui était jusque-là employés par les ministres de l’intérieur quel que soit leur bord politique, mais du mot « narcotrafic ». « Les narcoracailles n’ont plus de limites, déclare-t-il, ce jour-là, à BFM-TV. Aujourd’hui, c’est un choix entre une mobilisation générale, ou alors la mexicanisation du pays. »
Du terme « narcotrafic » à la mention du Mexique, le ministre multiplie les allusions péjoratives à une Amérique latine que le chargé de recherche au CNRS Romain Busnel connaît bien. Ce « cadrage sensationnaliste » joue, selon lui, sur « une série de puissants imaginaires sociaux » : ils sont marqués par des productions culturelles comme la série Narcos, avec ses gangs armés et ses Etats – Mexique et Colombie – représentés comme faibles et corrompus.
« Altérité irréductible »
Cet imaginaire militaire est géographique, mais aussi temporel : il renvoie à la « guerre contre la drogue » lancée par Richard Nixon entre 1969 et 1974. Le président américain fait alors du sujet un « important thème de sa campagne pour le retour de la loi et de l’ordre », relate l’historien Alexandre Marchant dans la revue Swaps, en 2014. Dans ces années-là « émerge un nouveau paradigme, celui de la lutte contre l’offre, qui va justifier une répression et une militarisation destructrices », ajoute Romain Busnel. En proposant de créer une « DEA à la française », du nom de l’agence antidrogue lancée par Nixon en 1973, la proposition de loi actuellement discutée au Sénat puise dans cette matrice.
La décennie 1970 marque ensuite la montée en puissance du narcotrafic et la cristallisation de son imaginaire sud-américain avec l’essor de la production au Mexique (cannabis et héroïne) et en Colombie (cannabis puis cocaïne), puis l’apparition de cartels, comme celui de Medellin en 1976, dirigé par Pablo Escobar. Dans les années 1980, Ronald Reagan remet le sujet au cœur de son agenda, mêlant politique sécuritaire et discours moral : si les résultats de cette guerre antidrogue sont contestés, ce moment marque le début de l’exportation du « consensus répressif » en France, souligne Alexandre Marchant.
Selon l’historien, ce modèle a « brillé par son inefficacité » tout en engendrant de « déplorables effets pervers – guerre aux pauvres, creusement d’un fossé racial ». Pour Romain Busnel, auteur de Planter la coca, cultiver la lutte (Iheal, 352 p., 22 €), cette politique a, en outre, conduit à « stigmatiser des populations pour qui la culture de la coca était millénaire et associée à leur spiritualité ». Cette politique constitue un « échec retentissant », renchérit Laurent Bonelli, professeur de science politique à l’université Paris-Nanterre : « Les Etats-Unis ont été le pays qui a le plus incarcéré au monde, sans effet sur les organisations criminelles ni sur la consommation. »
Pour ce dernier, auteur de La France a peur. Une histoire sociale de l’« insécurité » (La Découverte, 2008), ce choix rhétorique du mot « narcotrafic » s’inscrit dans une histoire franco-française. « Ce terme est le produit d’une escalade verbale qui, depuis trois décennies, accrédite l’idée qu’on n’en fait pas assez. » D’autant que le mot est lourd de sens implicites, juge-t-il : alors que les classes populaires vivent « des crises très brutales qui favorisent le trafic », parler de « “narcoracaille” renvoie ces vendeurs à une altérité irréductible », pointe le chercheur : « Or, toute la société consomme de la cocaïne, y compris dans les ministères. Si la consommation de drogue augmente alors que celle de l’alcool baisse, on pourrait s’inspirer de ce qui a marché : la prévention. » Aucun des 24 articles de la proposition de loi ne porte sur ce volet.
Youness Bousenna
https://www.lemonde.fr/idees/article/20 … _3232.html
Hors ligne

- prescripteur

- Modérateur
- Inscrit le 22 Feb 2008
- 12473 messages
- Blogs
https://www.stuartmcmillen.com/fr/comic … x-drogues/
Comment la "Guerre aux drogues" de Mr Nixon a créé le probleme.
Amicalement
S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Devise Shadok (et stoicienne)
Hors ligne
Ces données rendent compte d’une offensive lexicale impulsée il y a un peu plus d’un an par Bruno Retailleau.
Narcotrafic permet plein de choses.
Tout d'abord, c'est un nouvel ennemi, venu de l'extérieur de surcroit.
Il permet également d'absoudre tout échec policier dans un cadre prohibitif, surtout face aux nombre de personnes abattues dans un cadre de rivalité ou traitement de la concurrence.
Ça, c'est du narcotrafic, pas du simple trafic de stupéfiant. 
Just say no prohibition !
Hors ligne

- DjyOhm

- Nouveau Psycho

- Inscrit le 16 Jan 2025
- 58 messages
prescripteur a écrit
Je rappelle
https://www.stuartmcmillen.com/fr/comic … x-drogues/
Comment la "Guerre aux drogues" de Mr Nixon a créé le probleme.
Amicalement
Carrément.
La qualification des faits, la parole publique est toujours un acte de manipulation.
"narcotrafic" au lieu de "criminalité organisée"/ "règlements de comptes";
"guerre contre la drogue" à la place de "politique publique des drogues";
Hier, j'entendais un Général de gendarmerie commenter le fait-divers sordide du moment (pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir la  gerbe, je donne la réf exacte : hier 11 février sur FranceInfo à partir de 21:17 ("Général François Morel est notre invité") en parlant du gardé a vue du moment, il nous dit "c'est un fou, un déséquilibré, un toxicomane".
gerbe, je donne la réf exacte : hier 11 février sur FranceInfo à partir de 21:17 ("Général François Morel est notre invité") en parlant du gardé a vue du moment, il nous dit "c'est un fou, un déséquilibré, un toxicomane".
Quelque chose me dite qu'on n'a pas fini d'en prendre plein la gueule.
«au sujet des drogues, il y a beaucoup de science et peu de savoir » Ernst Jünger
Hors ligne
- Psychoactif
- » Forums
- » Actualités
- » Du trafic de drogue au « narcotrafic », une bascule sémantique et politique
1
Sujets similaires dans les forums, psychowiki et QuizzZ
 |
[ Forum ] Mafia Brésilienne et trafic de drogue
|
1 |
 |
[ Forum ] Etude - La civilisation occidentale s'est construite sur le trafic de drogue
|
0 |
 |
[ Forum ] Opinions - Calcul du PIB. L’Insee va intégrer le trafic de drogue
|
0 |
 77
77 0
0 0
0
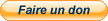 Soutenez PsychoACTIF
Soutenez PsychoACTIF