1

- Snoop'

- Modératrice à la retraite
- Inscrit le 09 Jul 2012
- 2280 messages
"Une vie pornographique" :
L’écrivain et journaliste Mathieu Lindon retrace le parcours d’un héroïnomane, entre manque, désir et jouissance impossible. Un roman sans complaisance, beau et toxique, sur la vie envisagée comme dépendance.
C’est un titre trompeur. Un titre cache-sexe. Car de sexe, justement, il n’y en a pas ou si peu. Une vie pornographique, le dernier roman de Mathieu Lindon, 58 ans, écrivain et journaliste à Libération, n’est pas un déballage de chair, mais la mise à nu d’un héroïnomane. Maître-assistant à l’université, Perrin est accro, même si le mot le rebute. Propre sur lui, inséré socialement, il ne ressemble pas à la caricature du camé. Il tente d’ailleurs de “conserver une toxicomanie bourgeoise”, maîtrisée, civilisée jusque dans ses rapports cordiaux avec les dealers.
Perrin est lucide, même dans le déni de son addiction. Mais de sexe, donc, il est peu question. Ou plutôt, il n’est question que de ça, de son absence, de sa défaillance. “L’héroïne est un serpent qui lui mord la queue ; il n’y a pas meilleur aphrodisiaque pour l’impuissance.” Perrin doit choisir entre la poudre et la baise, entre la poudre – la plus impérieuse des maîtresses – et ses amants. Choix tendu, fébrile. Polyamour imposé et intenable. Ainsi, quand son amoureux japonais débarque à Paris après douze heures d’avion, Perrin ne savoure pas de retrouver ses bras, obsédé par la dose qu’il lui faut acquérir de toute urgence. “Parfois, l’héroïne surpasse tout amour parce qu’on l’aime sans devoir coucher avec. Ou parce que coucher avec ne réclame aucun effort, aucune attention.” L’héroïne est pour Perrin un produit de substitution à l’amour, voire à la vie même.
Une relation presque exclusive avec l’héroïne
La drogue intoxiquait déjà Ce qu’aimer veut dire (prix Médicis 2011), précédent livre de Mathieu Lindon, récit autobiographique dans lequel il racontait son amitié avec Michel Foucault et, en creux, la relation avec son père, Jérôme Lindon, éditeur mythique des Editions de Minuit. Opium, acide, héroïne, cocaïne, Mathieu Lindon écrivait avoir tout pris.
Perrin, son personnage, vit une relation presque exclusive avec l’héroïne. Une passion triste que l’écrivain décrit dans ses moindres aspects : les contacts avec le dealer et le langage codé qu’ils impliquent, les “amitiés opiacées” qui se nouent autour du produit d’élection, le manque et ses manifestations physiques, la peur de la déchéance – “Quoique la déchéance ait sûrement son charme dont l’héroïne rend curieux du goût, il préférerait être moins bien informé – ainsi que tu as tout intérêt à ne pas chercher à savoir pour qui sonne le glas, puisque c’est pour toi” -, l’arrêt, enfin, après d’infructueuses tentatives. Tout est dit, montré, sans outrances ni complaisance. La phrase accidentée et sinueuse de Lindon ne bascule jamais dans la surenchère ou dans l’impudeur, même si l’on suit Perrin dans les “chiottes” ou qu’il est question de son sexe ratatiné.
Tous en quête d’un fix émotionnel
On est loin de la débauche stylistique hallucinée de Burroughs dans Le Festin nu, autre texte psychotrope. Loin aussi de l’exploration maniaque, frontale, d’un ars erotica sous substances comme chez Guillaume Dustan, ou du récit asphyxiant d’une descente aux enfers à la façon du Portrait d’un fumeur de crack en jeune homme de l’Américain Bill Clegg.
On se trouve dans la peau froide et fragile d’un homme qui a l’héroïne dans le sang. Au plus près, et pourtant tenu à distance par une prose comme détachée du corps et qui, à aucun moment, ne jouit de ce qu’elle raconte.
Mais que raconte Une vie pornographique ? L’addiction de Perrin, mais beaucoup plus que cela encore. C’est de l’existence tout entière conçue comme dépendance que ce roman nous entretient : “(…) il voit maintenant sans problème l’addiction dans les vies qui l’environnent, à l’amour, au sexe, à la famille, au boulot, aux conventions, et, fort de cette découverte, en arrive à compter pour rien sa dépendance à un réel stupéfiant.” Nous sommes tous sous l’emprise d’un produit, d’un affect ou d’un être à même de nous aider à traverser la vie ; en quête permanente d’un fix émotionnel ou chimique pour tenir et avancer.
“Comme un poisson dans l’eau marécageuse”
Lors d’un congrès universitaire, Perrin doit délivrer une communication sur l’image du désir “de Don Juan à Manon Lescaut”. En manque et en nage quand il arrive devant le pupitre, il se lance dans une tirade sur Des Grieux, l’amant épris de Manon Lescaut, héroïne du roman de l’abbé Prévost :
“Aimer, c’est ne pas avoir le choix. Des Grieux est mené hors de soi-même, dans un nouveau soi-même dont il n’avait jusqu’alors aucune idée, ignorant que l’humiliation était son monde puisque l’occasion ne lui avait pas encore été donnée d’y baigner. Il s’y trouve comme un poisson dans l’eau marécageuse.”
Des Grieux aime Manon, archétype romanesque de la femme vénale, de la prostituée ; il sacrifie pour elle sa fortune et son honneur. Etymologiquement, le mot “pornographie” signifie écrire ou représenter la prostitution. Ce que fait Lindon puisque Perrin, son personnage, paie lui aussi pour l’objet de son addiction, met en péril sa carrière, dilapide son argent.
Un soir au restaurant, Taroumond, un de ses collègues à l’université, spécialiste de Faulkner fermement accroché à sa flasque de whisky, traite Perrin de drogué devant une assistance consternée : “Ce sont les ratés qui se droguent, reprend Taroumond. C’est de la pure pornographie.” Lui-même est ivre mort, obscène, aveugle à sa propre dépendance alcoolique. La vie de Taroumond aussi est pornographique. Et toute vie l’est, à des degrés divers, exhibition plus ou moins consciente de failles et d’expédients, de béances et de tentatives pour les remplir. On “deale” littéralement avec ce que l’existence nous offre d’adjuvants. Toujours pour combler un manque. Le roman de Mathieu Lindon agit comme une puissante piqûre de rappel.
Elisabeth Philippe
Une vie pornographique (P.O.L), 272 pages, 17 €. En librairie le 3 octobre
L’écrivain et journaliste Mathieu Lindon retrace le parcours d’un héroïnomane, entre manque, désir et jouissance impossible. Un roman sans complaisance, beau et toxique, sur la vie envisagée comme dépendance.
C’est un titre trompeur. Un titre cache-sexe. Car de sexe, justement, il n’y en a pas ou si peu. Une vie pornographique, le dernier roman de Mathieu Lindon, 58 ans, écrivain et journaliste à Libération, n’est pas un déballage de chair, mais la mise à nu d’un héroïnomane. Maître-assistant à l’université, Perrin est accro, même si le mot le rebute. Propre sur lui, inséré socialement, il ne ressemble pas à la caricature du camé. Il tente d’ailleurs de “conserver une toxicomanie bourgeoise”, maîtrisée, civilisée jusque dans ses rapports cordiaux avec les dealers.
Perrin est lucide, même dans le déni de son addiction. Mais de sexe, donc, il est peu question. Ou plutôt, il n’est question que de ça, de son absence, de sa défaillance. “L’héroïne est un serpent qui lui mord la queue ; il n’y a pas meilleur aphrodisiaque pour l’impuissance.” Perrin doit choisir entre la poudre et la baise, entre la poudre – la plus impérieuse des maîtresses – et ses amants. Choix tendu, fébrile. Polyamour imposé et intenable. Ainsi, quand son amoureux japonais débarque à Paris après douze heures d’avion, Perrin ne savoure pas de retrouver ses bras, obsédé par la dose qu’il lui faut acquérir de toute urgence. “Parfois, l’héroïne surpasse tout amour parce qu’on l’aime sans devoir coucher avec. Ou parce que coucher avec ne réclame aucun effort, aucune attention.” L’héroïne est pour Perrin un produit de substitution à l’amour, voire à la vie même.
Une relation presque exclusive avec l’héroïne
La drogue intoxiquait déjà Ce qu’aimer veut dire (prix Médicis 2011), précédent livre de Mathieu Lindon, récit autobiographique dans lequel il racontait son amitié avec Michel Foucault et, en creux, la relation avec son père, Jérôme Lindon, éditeur mythique des Editions de Minuit. Opium, acide, héroïne, cocaïne, Mathieu Lindon écrivait avoir tout pris.
Perrin, son personnage, vit une relation presque exclusive avec l’héroïne. Une passion triste que l’écrivain décrit dans ses moindres aspects : les contacts avec le dealer et le langage codé qu’ils impliquent, les “amitiés opiacées” qui se nouent autour du produit d’élection, le manque et ses manifestations physiques, la peur de la déchéance – “Quoique la déchéance ait sûrement son charme dont l’héroïne rend curieux du goût, il préférerait être moins bien informé – ainsi que tu as tout intérêt à ne pas chercher à savoir pour qui sonne le glas, puisque c’est pour toi” -, l’arrêt, enfin, après d’infructueuses tentatives. Tout est dit, montré, sans outrances ni complaisance. La phrase accidentée et sinueuse de Lindon ne bascule jamais dans la surenchère ou dans l’impudeur, même si l’on suit Perrin dans les “chiottes” ou qu’il est question de son sexe ratatiné.
Tous en quête d’un fix émotionnel
On est loin de la débauche stylistique hallucinée de Burroughs dans Le Festin nu, autre texte psychotrope. Loin aussi de l’exploration maniaque, frontale, d’un ars erotica sous substances comme chez Guillaume Dustan, ou du récit asphyxiant d’une descente aux enfers à la façon du Portrait d’un fumeur de crack en jeune homme de l’Américain Bill Clegg.
On se trouve dans la peau froide et fragile d’un homme qui a l’héroïne dans le sang. Au plus près, et pourtant tenu à distance par une prose comme détachée du corps et qui, à aucun moment, ne jouit de ce qu’elle raconte.
Mais que raconte Une vie pornographique ? L’addiction de Perrin, mais beaucoup plus que cela encore. C’est de l’existence tout entière conçue comme dépendance que ce roman nous entretient : “(…) il voit maintenant sans problème l’addiction dans les vies qui l’environnent, à l’amour, au sexe, à la famille, au boulot, aux conventions, et, fort de cette découverte, en arrive à compter pour rien sa dépendance à un réel stupéfiant.” Nous sommes tous sous l’emprise d’un produit, d’un affect ou d’un être à même de nous aider à traverser la vie ; en quête permanente d’un fix émotionnel ou chimique pour tenir et avancer.
“Comme un poisson dans l’eau marécageuse”
Lors d’un congrès universitaire, Perrin doit délivrer une communication sur l’image du désir “de Don Juan à Manon Lescaut”. En manque et en nage quand il arrive devant le pupitre, il se lance dans une tirade sur Des Grieux, l’amant épris de Manon Lescaut, héroïne du roman de l’abbé Prévost :
“Aimer, c’est ne pas avoir le choix. Des Grieux est mené hors de soi-même, dans un nouveau soi-même dont il n’avait jusqu’alors aucune idée, ignorant que l’humiliation était son monde puisque l’occasion ne lui avait pas encore été donnée d’y baigner. Il s’y trouve comme un poisson dans l’eau marécageuse.”
Des Grieux aime Manon, archétype romanesque de la femme vénale, de la prostituée ; il sacrifie pour elle sa fortune et son honneur. Etymologiquement, le mot “pornographie” signifie écrire ou représenter la prostitution. Ce que fait Lindon puisque Perrin, son personnage, paie lui aussi pour l’objet de son addiction, met en péril sa carrière, dilapide son argent.
Un soir au restaurant, Taroumond, un de ses collègues à l’université, spécialiste de Faulkner fermement accroché à sa flasque de whisky, traite Perrin de drogué devant une assistance consternée : “Ce sont les ratés qui se droguent, reprend Taroumond. C’est de la pure pornographie.” Lui-même est ivre mort, obscène, aveugle à sa propre dépendance alcoolique. La vie de Taroumond aussi est pornographique. Et toute vie l’est, à des degrés divers, exhibition plus ou moins consciente de failles et d’expédients, de béances et de tentatives pour les remplir. On “deale” littéralement avec ce que l’existence nous offre d’adjuvants. Toujours pour combler un manque. Le roman de Mathieu Lindon agit comme une puissante piqûre de rappel.
Elisabeth Philippe
Une vie pornographique (P.O.L), 272 pages, 17 €. En librairie le 3 octobre
Born by accident, Bastard by choice, just...Bad seed...
"Si chaque personne savait ce que les uns disaient sur les autres, il n'y aurait pas deux amis au monde"
Hors ligne

- seba59

- Banni
- Inscrit le 21 Aug 2012
- 959 messages
Dans le même genre, mais se déroulant dans la très haute aristocratie Britannique et autobiographique, "Bad News" (en français, "Mauvaise nouvelle") de Edward Saint Aubyn paru en 1992. À lire absolument.
Amicalement,
Seba59
Amicalement,
Seba59

"Ils ont cru s'enivrer des Chants de Maldoror, et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale." H.F. Thiéfaine
Hors ligne
- SweetOpia

- Nouveau Psycho
- Inscrit le 19 Mar 2013
- 55 messages
Ouais merci beAucoup Snoopy!!! Je suis trop contente, sa fais un bout que je suis à la recherche d'un bon livre, j'ai des temps libres en ce moment et j'avais vraiment envie d'une bonne lecture, mais pas n'importe laquelle, quelque chose qui me passionnerait, le genre de livre que tu lis d'un trait! Et là pile dedans! Voilà que tu m'offres exactement ce que je recherchais  merci ma chère, moi aussi je cour directement, jusqu'à la librairie, ou en faite après un ptit détour chez mon dealer! Tser peut pas dévorer ce livre sans héroïne sous la main, ou plutôt dans les veines lolllllll (quand meme han
merci ma chère, moi aussi je cour directement, jusqu'à la librairie, ou en faite après un ptit détour chez mon dealer! Tser peut pas dévorer ce livre sans héroïne sous la main, ou plutôt dans les veines lolllllll (quand meme han  )
)
 merci ma chère, moi aussi je cour directement, jusqu'à la librairie, ou en faite après un ptit détour chez mon dealer! Tser peut pas dévorer ce livre sans héroïne sous la main, ou plutôt dans les veines lolllllll (quand meme han
merci ma chère, moi aussi je cour directement, jusqu'à la librairie, ou en faite après un ptit détour chez mon dealer! Tser peut pas dévorer ce livre sans héroïne sous la main, ou plutôt dans les veines lolllllll (quand meme han  )
)
Hors ligne

- melodynelson

- Nouveau Psycho
- Inscrit le 17 Aug 2013
- 190 messages
Ahahaha nan mais allo Lloigor!!!! Je vais pas tomber! Je cours comme une gazelle!
Ou comme un mome apres son croissant au beurre, ou comme Higelin apres sa clope!
Ou comme un mome apres son croissant au beurre, ou comme Higelin apres sa clope!
Hors ligne

- Caïn

- PsychoAddict
- Inscrit le 04 Oct 2013
- 2027 messages
Excellent bouquin. Une réalité de la dope que l'on connait moins, celle de ceux qui assurent (ou font semblant) en société. je reviendrai vous en parler plus longuement quand je l'aurais fini.
La drogue c'est de la merde, surtout quand t'en as plus.
Hors ligne

- Caïn

- PsychoAddict
- Inscrit le 04 Oct 2013
- 2027 messages
Voilà mon papier sur le bouquin (je ne sais pas si j'avais dit que j'étais journaliste). J'ai quand même enlevé mon nom.
Mathieu Lindon dresse le portrait d’un toxicomane bien intégré.
Portrait de l’artiste en toxico bobo
On a peu parlé d’Une vie pornographique de Mathieu Lindon lors de la dernière rentrée littéraire. Peut-être parce que ce roman singulier va à l’encontre de tous les clichés véhiculés sur la drogue. Le récit met en scène un jeune prof qui s’adonne aux joies de l’héroïne sans trop subir de conséquences néfastes liées à son addiction. L’écrivain évoque le quotidien et les pensées d’un héros en apparence banal, sans jamais donner de leçon de morale. Mais avec une lucidité et un sens de la psychologie aigus.
Hasard du calendrier, Une vie pornographique de Mathieu Lindon est paru presque en même temps que Moi, Christiane F, une vie malgré tout. Second volet de la confession de Christiane Felscherinow, après Moi, Christiane F, droguée, prostituée, où l’on retrouve celle qui est devenue la plus célèbre des junkies, toujours en proie à ses démons. Mais si Mathieu Lindon a, tout comme Christiane F., fait aussi de l’héroïne l’héroïne de son livre, c’est d’une façon résolument différente. Il impose en effet une singulière façon de parler de l’addiction. On cherchera en vain dans son roman les notions de déchéance physique et morale que l’on associe ordinairement à une drogue telle que la diacétylmorphine (nom scientifique de l’héroïne), prisée et injectée régulièrement. D’ailleurs, le livre n’est pas une confession où, selon un schéma presque immuable, le paradis est suivi de l’enfer avant que n’advienne la rédemption. C’est un roman qui met en scène Perrin, un homme jeune dont on ignore le prénom, sans doute parce que Lindon tient à garder avec lui ses distances. Il travaille dans l’enseignement supérieur, touche un salaire confortable qui lui permet de faire face à ses besoins en drogue. « Ça fait des années qu’il prend de l’héroïne, qu’il y est accroché même s’il n’emploierait jamais ce terme, et il est toujours à l’affût d’un nouveau dealer quand les circonstances, à savoir la police, ont la peau du précédent. Les dealers sont comme les animateurs et les amants sans préservatifs, ils ne se retirent jamais à temps. », est-il précisé d’emblée. Mais là où, par exemple, le junkie de Burroughs plonge irrémédiablement dans l’excès et l’anéantissement de soi-même, pour Perrin l’héroïne est « un plaisir qui se déguste comme un bon vin, comme on s’accorde des vacances quand le travail de la journée est terminé, quelle que soit l’heure ».
Une obscène addiction
Pour autant, devenu expert en auto-analyse, Perrin prend conscience de mener une vie pornographique. Pornê, en grec, est une prostituée : l'héroïne est une putain, Perrin la paie pour qu'elle lui donne du plaisir. Et il en obtient. Sauf que « L’héroïne met un nom sur toutes les choses de sa vie : intoxication, trafic, compulsion. Dépendance et indépendance ». Le regard des autres, l’incompréhension de ceux qui ne partagent pas son goût finissent par lui peser. Et, surtout, le fait que sa vie amoureuse et sexuelle en est gâchée. Il souffre de l’impuissance liée à sa consommation, l’héroïne étant pour lui « un aphrodisiaque de l’impuissance ». Sans compter qu’elle est aussi une maîtresse bien trop exclusive puisqu’elle ne supporte pas la concurrence avec d’autres passions. La place que la drogue prend dans sa vie devient problématique. Perrin entreprend de se désintoxiquer. Son cheminement est parfaitement retranscrit, aussi bien dans l’intoxication que dans la désintoxication. Le livre, nourri de l’expérience personnelle de Mathieu Lindon, frappe par son humour et sa justesse de ton. Notamment par la pertinence des réflexions qui tournent autour de la drogue mais aussi par le regard porté sur le monde contemporain. Où certaines addictions sont acceptées, et même encouragées, comme celle qui amène Perrin, à une pratique compulsive du sport pour combler le vide induit par son arrêt des opiacés. On tient là l’un des livres les plus intelligents qui n’ait jamais été écrits sur la drogue.
> Mathieu Lindon
Une vie pornographique
Editions P.O.L, 2013,
268 p., 17 €
Mathieu Lindon dresse le portrait d’un toxicomane bien intégré.
Portrait de l’artiste en toxico bobo
On a peu parlé d’Une vie pornographique de Mathieu Lindon lors de la dernière rentrée littéraire. Peut-être parce que ce roman singulier va à l’encontre de tous les clichés véhiculés sur la drogue. Le récit met en scène un jeune prof qui s’adonne aux joies de l’héroïne sans trop subir de conséquences néfastes liées à son addiction. L’écrivain évoque le quotidien et les pensées d’un héros en apparence banal, sans jamais donner de leçon de morale. Mais avec une lucidité et un sens de la psychologie aigus.
Hasard du calendrier, Une vie pornographique de Mathieu Lindon est paru presque en même temps que Moi, Christiane F, une vie malgré tout. Second volet de la confession de Christiane Felscherinow, après Moi, Christiane F, droguée, prostituée, où l’on retrouve celle qui est devenue la plus célèbre des junkies, toujours en proie à ses démons. Mais si Mathieu Lindon a, tout comme Christiane F., fait aussi de l’héroïne l’héroïne de son livre, c’est d’une façon résolument différente. Il impose en effet une singulière façon de parler de l’addiction. On cherchera en vain dans son roman les notions de déchéance physique et morale que l’on associe ordinairement à une drogue telle que la diacétylmorphine (nom scientifique de l’héroïne), prisée et injectée régulièrement. D’ailleurs, le livre n’est pas une confession où, selon un schéma presque immuable, le paradis est suivi de l’enfer avant que n’advienne la rédemption. C’est un roman qui met en scène Perrin, un homme jeune dont on ignore le prénom, sans doute parce que Lindon tient à garder avec lui ses distances. Il travaille dans l’enseignement supérieur, touche un salaire confortable qui lui permet de faire face à ses besoins en drogue. « Ça fait des années qu’il prend de l’héroïne, qu’il y est accroché même s’il n’emploierait jamais ce terme, et il est toujours à l’affût d’un nouveau dealer quand les circonstances, à savoir la police, ont la peau du précédent. Les dealers sont comme les animateurs et les amants sans préservatifs, ils ne se retirent jamais à temps. », est-il précisé d’emblée. Mais là où, par exemple, le junkie de Burroughs plonge irrémédiablement dans l’excès et l’anéantissement de soi-même, pour Perrin l’héroïne est « un plaisir qui se déguste comme un bon vin, comme on s’accorde des vacances quand le travail de la journée est terminé, quelle que soit l’heure ».
Une obscène addiction
Pour autant, devenu expert en auto-analyse, Perrin prend conscience de mener une vie pornographique. Pornê, en grec, est une prostituée : l'héroïne est une putain, Perrin la paie pour qu'elle lui donne du plaisir. Et il en obtient. Sauf que « L’héroïne met un nom sur toutes les choses de sa vie : intoxication, trafic, compulsion. Dépendance et indépendance ». Le regard des autres, l’incompréhension de ceux qui ne partagent pas son goût finissent par lui peser. Et, surtout, le fait que sa vie amoureuse et sexuelle en est gâchée. Il souffre de l’impuissance liée à sa consommation, l’héroïne étant pour lui « un aphrodisiaque de l’impuissance ». Sans compter qu’elle est aussi une maîtresse bien trop exclusive puisqu’elle ne supporte pas la concurrence avec d’autres passions. La place que la drogue prend dans sa vie devient problématique. Perrin entreprend de se désintoxiquer. Son cheminement est parfaitement retranscrit, aussi bien dans l’intoxication que dans la désintoxication. Le livre, nourri de l’expérience personnelle de Mathieu Lindon, frappe par son humour et sa justesse de ton. Notamment par la pertinence des réflexions qui tournent autour de la drogue mais aussi par le regard porté sur le monde contemporain. Où certaines addictions sont acceptées, et même encouragées, comme celle qui amène Perrin, à une pratique compulsive du sport pour combler le vide induit par son arrêt des opiacés. On tient là l’un des livres les plus intelligents qui n’ait jamais été écrits sur la drogue.
> Mathieu Lindon
Une vie pornographique
Editions P.O.L, 2013,
268 p., 17 €
La drogue c'est de la merde, surtout quand t'en as plus.
Hors ligne

- Snoop'

- Modératrice à la retraite
- Inscrit le 09 Jul 2012
- 2280 messages
merci cain pour ce retour et cet avis sur ce bouquin!!
allez, c'est decidé, je vais l'acheter !! pour une fois qu'un bouquin ne diabolise pas la drogue...a ne pas louper donc!!
allez, c'est decidé, je vais l'acheter !! pour une fois qu'un bouquin ne diabolise pas la drogue...a ne pas louper donc!!

Born by accident, Bastard by choice, just...Bad seed...
"Si chaque personne savait ce que les uns disaient sur les autres, il n'y aurait pas deux amis au monde"
Hors ligne

- Caïn

- PsychoAddict
- Inscrit le 04 Oct 2013
- 2027 messages
Il faut noter aussi que le bouquin n'est pas spécialement facile à lire, "Moi, Christiane F" que tu trouves ça nul ou non, force est de reconnaître qu'elle t'embarque dans une histoire. Pour le livre de Lindon, c'est autre chose, on est plus dans l'analyse, dans la pensée. Il y a très peu d'action, pas vraiment de progression dans le récit.
La drogue c'est de la merde, surtout quand t'en as plus.
Hors ligne
- bilou
- Nouveau Psycho
- Inscrit le 17 Apr 2007
- 179 messages
salut,
Je viens de finir le bouquin"une vie pornographique".
C'est surtout un livre sur l'addiction,plutot que sur l'héroine.
Mathieu Lindon fini par arrèter l'héro,surtout parceque l'héro l'empèche de vivre sa sexualité normalement.
ça me fait penser que si je vis si bien ma propre addiction à le métha,c'est que la baisse de libido m'arrange bien.
Avoir moins de libido me permet d'apprécier la vie sans avoir à me soucier de trouver une femme.
Et finalement,à près une vie ou les femmes m'étaient indispensable,c'est plutot agréable.
Je viens de finir le bouquin"une vie pornographique".
C'est surtout un livre sur l'addiction,plutot que sur l'héroine.
Mathieu Lindon fini par arrèter l'héro,surtout parceque l'héro l'empèche de vivre sa sexualité normalement.
ça me fait penser que si je vis si bien ma propre addiction à le métha,c'est que la baisse de libido m'arrange bien.
Avoir moins de libido me permet d'apprécier la vie sans avoir à me soucier de trouver une femme.
Et finalement,à près une vie ou les femmes m'étaient indispensable,c'est plutot agréable.
j'ai souvent envie d'envoyer tout ballader.Le probleme,c'est qu'après,ilfaut tout ramasser
Bilou
Hors ligne

- Caïn

- PsychoAddict
- Inscrit le 04 Oct 2013
- 2027 messages
Bilou,
Oui, je pensais ça aussi, ma femme n'ayant plus envie de moi après plus de vingt ans de mariage. Mais il se trouve que là j'ai rencontré quelqu'un et de ne pouvoir "assurer", ça devient problématique.
Sinon, c'est bien un livre sur l'addiction, mais sa façon d'analyser l'héro mérite l'intérêt.
Oui, je pensais ça aussi, ma femme n'ayant plus envie de moi après plus de vingt ans de mariage. Mais il se trouve que là j'ai rencontré quelqu'un et de ne pouvoir "assurer", ça devient problématique.
Sinon, c'est bien un livre sur l'addiction, mais sa façon d'analyser l'héro mérite l'intérêt.
La drogue c'est de la merde, surtout quand t'en as plus.
Hors ligne
Sujets similaires dans les forums, psychowiki et QuizzZ
 |
[ Forum ] Actualité - ASUD Journal N°56 "Drogues : Téléchargez la mise à jour" est sorti
|
1 |

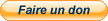 Soutenez PsychoACTIF
Soutenez PsychoACTIF