1
- Échec Scolaire

- Nouveau Psycho
- Inscrit le 13 Feb 2022
- 112 messages
Mes excuses anticipées si je n’ai pas choisi la bonne rubrique.
Bonne lecture.
RESPONSABILITÉ SANS BLÂME POUR L’ADDICTION, HANNA PICKARD, 2017.
Pickard, H. (2017). Responsibility without blame for addiction. Neuroethics, 10(1), 169-180.
ABSTRACT.
La consommation de drogues et la toxicomanie sont gravement stigmatisées dans le monde entier. Marc Lewis ne présente pas son modèle d’apprentissage de la dépendance comme un modèle de choix, car il craint que cela n’encourage la stigmatisation et le blâme. Pourtant, les preuves à l’appui d’un modèle de choix sont de plus en plus solides et s’accordent avec les éléments fondamentaux de son modèle d’apprentissage. Je propose un cadre de responsabilité sans blâme qui découle d’une réflexion sur les formes de pratique clinique qui favorisent le changement et le rétablissement des patients qui se font du mal ou en font aux autres. Ce cadre peut être utilisé pour interroger nos propres attitudes et réponses, afin que nous puissions mieux voir comment reconnaître la vérité sur le choix et l’agence dans la dépendance, tout en évitant la stigmatisation et le blâme, et en maintenant au contraire les soins et la compassion tout en s’engageant à travailler pour la justice et le bien social.
La consommation de drogues et la toxicomanie sont gravement stigmatisées dans le monde entier.1 Des études interculturelles suggèrent que la désapprobation sociale de la toxicomanie est plus forte que celle d’une série de conditions fortement stigmatisées, notamment la lèpre, la séropositivité, le fait d’être sans abri, la saleté, la négligence des enfants et un casier judiciaire pour cambriolage [1]. La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 qualifie la toxicomanie de “mal grave pour l’individu” et de “danger social et économique pour l’humanité” [2]. Notre langage commun exprime également la stigmatisation : les personnes qui consomment des drogues sont des “junkies”, les mères qui consomment des drogues sont des “mères crack”, et l’abstinence est appelée “se désintoxiquer” – ce qui implique, bien sûr, que les personnes qui consomment des drogues sont sales. Les images sombres et lugubres de la consommation de drogues et de la toxicomanie abondent dans les médias [3].2 En outre, étant donné que la possession et le trafic de nombreux types de substances psychoactives sont presque universellement criminalisés, la stigmatisation associée aux infractions pénales contribue également à la stigmatisation de la consommation de drogues et de la toxicomanie.3
La stigmatisation est une marque de disgrâce sociale. Elle est synonyme de condamnation et d’ostracisme de la part de la société et engendre généralement la honte et l’isolement correspondants de la part de la personne stigmatisée.4 La stigmatisation a généralement un impact sur l’identité et l’estime de soi des consommateurs de drogues et des toxicomanes eux-mêmes [8] et constitue un obstacle psychologique à la recherche d’un traitement [9]. Elle a également des conséquences pratiques concrètes. Dans de nombreuses régions du monde, la toxicomanie et les condamnations pour toxicomanie constituent des obstacles formels à l’accès aux soins de santé, au logement, aux prestations sociales, à l’emploi, aux prêts financiers et au droit de vote ; elles peuvent également entraîner une surveillance à long terme, le travail forcé, la torture et les abus pendant la détention [10].5 Enfin, bien que les niveaux de consommation de drogues soient relativement stables dans les différents secteurs de la société, les taux de toxicomanie et de condamnation ne sont pas répartis de manière égale, mais touchent de manière disproportionnée des personnes par ailleurs vulnérables et défavorisées, telles que les personnes issues de milieux socio-économiques défavorisés, ayant souffert d’abus et d’adversité dans leur enfance, luttant contre des problèmes de santé mentale, ou appartenant à des groupes ethniques minoritaires ou à d’autres groupes victimes de préjugés et de discrimination [10-16]. En conséquence, elles portent une part disproportionnée du fardeau de la stigmatisation et des conséquences associées à la consommation de drogues.
Pourquoi les consommateurs de drogues et les toxicomanes sont-ils stigmatisés et traités durement ? Il ne fait aucun doute qu’une explication complète dépend d’une variété de forces historiques, sociopolitiques et économiques complexes. Mais d’un point de vue idéologique, nous devons également reconnaître à quel point ces attitudes et ces politiques résonnent avec le modèle moral de la dépendance qui était dominant dans la première moitié du vingtième siècle.
Le modèle moral de la dépendance présente deux caractéristiques distinctives. Premièrement, il considère la consommation de drogues comme un choix, même pour les toxicomanes. Deuxièmement, il adopte une position morale critique à l’égard de ce choix. Les toxicomanes sont considérés comme des personnes de mauvaise moralité aux valeurs antisociales : égoïstes et paresseux, ils sont censés privilégier le plaisir, l’oisiveté et l’évasion par-dessus tout, et sont prêts à les rechercher à n’importe quel prix, pour eux-mêmes ou pour les autres. Dans la culture occidentale contemporaine, nous tenons généralement les gens responsables de leurs actes s’ils ont le choix et pouvaient donc agir autrement, et nous les exonérons de toute responsabilité dans le cas contraire. Parce que le modèle moral de la toxicomanie considère la consommation de drogue comme un choix, il considère les toxicomanes comme responsables ; parce qu’il condamne ce choix, il les considère comme responsables – méritant potentiellement la stigmatisation et le traitement sévère qu’ils reçoivent en fait. C’est pourquoi, dans la mesure où le modèle moral continue d’influencer – implicitement ou explicitement – les conceptions de la consommation de drogues et de la toxicomanie, les préjugés et les injustices dont sont victimes les consommateurs de drogues et les toxicomanes dans le monde entier peuvent sembler justifiables.
Pour ceux qui reculent devant les attitudes incarnées par le modèle moral, le modèle de la maladie de la dépendance peut sembler, par contraste, offrir un correctif idéologique désespérément nécessaire. Notre concept de maladie n’est pas précis et peut avoir des significations et des implications différentes selon les contextes d’utilisation [17]. Cependant, en ce qui concerne les modèles de dépendance, la signification et l’implication sont relativement claires : “Lorsque les spécialistes de la dépendance disent que la dépendance est une maladie, ils veulent dire que la consommation de drogue est devenue involontaire” [18]. Selon le modèle de la maladie, la dépendance est une maladie neurobiologique chronique et récidivante caractérisée par une consommation compulsive malgré les conséquences négatives. La consommation répétée de drogues est censée modifier le cerveau de manière à rendre le désir de drogues irrésistible : le modèle de la maladie soutient que les toxicomanes ne peuvent littéralement pas s’empêcher de consommer des drogues et n’ont pas le choix de leur consommation. La compulsion peut servir à expliquer pourquoi les toxicomanes persistent à consommer malgré le mal qu’ils font : s’ils pouvaient arrêter de consommer, ils le feraient, mais ils ne le peuvent pas, alors ils ne le font pas [19, 20]. Mais, en conséquence, il supprime également la responsabilité et, avec elle, la possibilité de blâmer. Le modèle de la maladie de la dépendance peut donc servir à combattre toute légitimité apparente que la stigmatisation et le traitement sévère des toxicomanes pourraient autrement être perçus comme ayant.6 Avec l’influence pernicieuse du modèle moral de la dépendance en arrière-plan, le modèle de la maladie émerge comme un appel à la compassion et une force pour la justice sociale et le bien.7
Il est frappant de constater que Marc Lewis rejette à la fois le modèle du choix et celui de la maladie, proposant à la place ce qu’il appelle un modèle d’apprentissage de la dépendance. Selon lui, le modèle du choix invite et offre à légitimer une position morale critique : “Malheureusement, le modèle du choix offre une plateforme commode à ceux qui considèrent que les dépendants sont indulgents et égoïstes. Si la dépendance est un choix, raisonnent-ils, alors les toxicomanes s’infligent délibérément des dommages à eux-mêmes et, plus grave encore, aux autres” [21]. Mais le modèle de la maladie n’est pas meilleur selon Lewis, car il pathologise à tort à la fois le cerveau et la personne. Il pathologise à tort le cerveau car, selon lui, les changements cérébraux causés par la consommation répétée de drogues ne sont pas la preuve d’une pathologie mais d’une neuroplasticité : une partie du processus ordinaire d’apprentissage et de formation d’habitudes qui se produit lorsque le cerveau est exposé à une récompense. Elle pathologise à tort la personne, car la plupart des toxicomanes ne se considèrent pas comme atteints d’une maladie. Il ne serait d’ailleurs pas bon pour eux qu’ils le fassent : se percevoir comme la victime impuissante d’une maladie et adopter le “rôle du malade” [22] risque de placer les toxicomanes dans une position où ils se considèrent comme dépendants des professionnels de la médecine et des autres secteurs pour une “guérison”.8 Pourtant, comme le souligne Lewis, l’expérience personnelle et les histoires de la majorité des personnes qui ont surmonté leur dépendance, à quelque degré que ce soit, impliquent généralement un sentiment d’agence et d’autonomisation, ainsi que la création et la mise en œuvre d’un récit de vie qui donne un sens au passé tout en racontant l’histoire d’un avenir différent [21, 24, 25]. En gros, les toxicomanes doivent apprendre à vouloir des choses différentes et à faire des choix différents pour surmonter leur dépendance. Tout ce qui peut les aider dans cette tâche – les interventions pharmacologiques qui réduisent les envies ou stabilisent les modes de consommation permettant une réduction progressive et contrôlée ; le soutien des pairs et un sentiment d’appartenance ; l’éducation et les possibilités d’emploi ; le soutien des amis et de la famille ; les livres, les passe-temps, les nouveaux plaisirs ; la thérapie cognitive et psychologique ; le traitement de gestion des contingences ; la compréhension narrative de soi – devrait être utilisé. Mais, pour reprendre une expression de Lewis, la dépendance est “étrangement normale” de part en part [21] – ce n’est pas une maladie nécessitant un traitement médical spécialisé, mais le produit d’un apprentissage et d’un développement ordinaires qui peuvent être surmontés par un apprentissage et un développement supplémentaires, sous forme de croissance personnelle et de compréhension de soi.
Je suis d’accord avec Lewis pour dire que l’addiction n’est pas une maladie – du moins au vu de la signification et des implications habituelles de ce concept. Je suis également sceptique quant au fait que, compte tenu de l’état actuel de notre compréhension et des preuves, nous soyons justifiés de maintenir que les changements cérébraux causés par la consommation répétée de drogues sont correctement classés comme pathologiques. Et je crois que Lewis a raison de souligner l’importance centrale d’un sentiment d’agence, d’autonomisation, de croissance personnelle et de compréhension de soi, pour surmonter la dépendance. Mais je ne suis pas d’accord pour dire que nous devons rejeter un modèle de choix de la dépendance.
Il y a deux raisons simples à cela. La première est qu’il est de plus en plus évident que, même s’il est difficile pour les toxicomanes de contrôler leur consommation, et même s’il est important que les autres reconnaissent et respectent cette lutte, les toxicomanes ne sont en fait pas obligés de consommer, mais ont le choix de leur consommation dans de nombreuses circonstances. Passons brièvement en revue certaines de ces preuves : Les rapports anecdotiques et personnels abondent sur les toxicomanes (y compris ceux qui ont reçu un diagnostic de dépendance basé sur le DSM) qui se jettent dans le vide [13, 18]. Des études épidémiologiques à grande échelle démontrent que la majorité des toxicomanes ” sortent ” sans intervention clinique à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine, au fur et à mesure que les responsabilités et les opportunités de l’âge adulte, comme la parentalité et l’emploi, augmentent [13, 16, 26, 27]. Les taux de consommation sont sensibles aux coûts : en effet, certains toxicomanes choisissent de se sevrer afin de diminuer la tolérance, réduisant ainsi le coût de la consommation future [28]. Il est de plus en plus évident que le traitement par gestion des contingences améliore l’abstinence et l’observance du traitement, par rapport aux formes standard de traitement telles que le conseil et la thérapie cognitivo-comportementale, en offrant une structure de récompense composée de biens alternatifs, tels que des incitations monétaires modestes et de petits prix, à condition que les toxicomanes produisent des échantillons d’urine propres [29]. Des études expérimentales montrent que, lorsqu’ils ont le choix entre prendre de la drogue et recevoir de l’argent sur-le-champ en laboratoire, les toxicomanes préfèrent souvent l’argent à la drogue [30, 31]. Enfin, depuis que l’expérience séminale de Bruce Alexander, “Rat Park”, a laissé entendre que quelque chose de semblable pourrait être vrai chez les rats [32, 33], la recherche animale sur la dépendance a démontré de façon convaincante que, bien que la majorité des rats cocaïnomanes augmentent leur auto-administration, parfois jusqu’à la mort, si aucun bien alternatif n’est disponible, ils renoncent en revanche à la cocaïne et choisissent des biens alternatifs, tels que la saccharine ou les câlins entre personnes du même sexe, s’ils sont disponibles [34, 35].9 En bref, il est évident que la consommation de drogues dans le cadre d’une dépendance n’est pas involontaire : les toxicomanes réagissent aux incitations et ont donc le choix et un certain degré de contrôle sur leur consommation dans un grand nombre de circonstances.10
La deuxième raison de maintenir un modèle de choix de la dépendance est que le processus qui consiste à surmonter la dépendance par un sentiment d’agence, d’autonomisation, de croissance personnelle et de compréhension de soi – un processus que Lewis décrit dans The Biology of Desire [21] avec beaucoup de soin et d’acuité – présuppose lui-même que les dépendants aient le choix et un certain degré de contrôle. L’agence doit exister pour être mobilisée : vous ne pouvez décider d’arrêter de consommer et faire ce qu’il faut pour changer votre mode de vie et le genre de personne que vous êtes que si vous avez un certain choix et un certain contrôle sur votre consommation et votre identité. Le chemin “étrangement normal” qui permet d’échapper à la dépendance est pavé de moments ordinaires de la vie où des choix sont faits, où la détermination se renforce et où la réflexion et le récit servent à les comprendre et à les étayer. Bien sûr, toutes les interventions qui aident les toxicomanes à changer n’impliquent pas de choix – beaucoup de choses échapperont toujours à notre contrôle – mais le choix et les processus psychologiques connexes sont néanmoins des éléments cruciaux dans la plupart, sinon la totalité, des récits de changements de vie qui découlent de la croissance personnelle et de la compréhension de soi, et il peut être important, voire habilitant, que cela soit reconnu et admis [21, 37-39].11
Rappelons que le modèle moral de la dépendance présente deux caractéristiques. Il considère la consommation de drogues comme un choix. Et il adopte une position morale critique à l’égard de ce choix. En raison de la preuve que les toxicomanes répondent aux incitations et du rôle du choix et des processus psychologiques connexes qui impliquent l’agence dans la lutte contre la dépendance, je pense que nous devons accepter la première caractéristique. Mais cela ne signifie pas que nous devons également accepter la seconde. Tout comme les toxicomanes ont le choix de consommer de la drogue, nous avons le choix de la façon dont nous répondons aux toxicomanes. Dans ce qui suit, je propose un cadre qui peut nous aider à interroger nos propres attitudes et réponses, afin que nous puissions mieux voir comment reconnaître la vérité sur le choix en matière de dépendance, tout en maintenant l’attention, la compassion et l’engagement en faveur de la justice et du bien social. Ce cadre est le fruit d’une réflexion philosophique sur mon expérience personnelle de travail avec des patients dont le comportement leur cause du tort, à eux et aux autres. La clé est de mieux distinguer notre concept de responsabilité de notre concept de blâme, afin de pouvoir reconnaître l’agence et, avec elle, la responsabilité, sans pour autant inviter immédiatement et encore moins légitimer la stigmatisation et le blâme.
RESPONSABILITÉ SANS BLÂME DANS LA CLINIQUE.
Pour une discussion plus approfondie de ce cadre et des recherches connexes, voir Pickard [37, 38, 41, 42] ; Lacey et Pickard [43, 44] explorent la pertinence du cadre dans les contextes de justice pénale. Pour certains entretiens et pièces d’engagement public, voir http://www.hannapickard.com/responsibil … lame.html.
Ma première expérience de travail en milieu clinique a eu lieu dans une communauté thérapeutique pour les personnes souffrant de troubles de la personnalité et ayant des besoins complexes. Les communautés thérapeutiques sont des environnements très particuliers. Elles fonctionnent en exigeant des relations personnelles et professionnelles authentiques et soutenues entre les cliniciens et les patients12 et entre les patients eux-mêmes. Dans les contextes de soins plus conventionnels, la relation médecin-patient est à la fois formelle et hiérarchique, et il n’y a pas d’engagement entre pairs. Le patient a un problème qu’il ne peut pas résoudre seul, et vient voir le médecin pour trouver le remède. L’expertise du médecin, par rapport au patient, et la nature médicale du cadre clinique servent à créer un fossé entre eux, ce qui peut contribuer à protéger les médecins d’une implication personnelle avec leurs patients. Il y a à la fois un déséquilibre de pouvoir et une sorte de distance émotionnelle qui structurent la nature de la relation et sont maintenus par les normes régissant les contextes de soins de santé standard. Les communautés thérapeutiques, en revanche, sont des environnements informels, communautaires et égalitaires, qui s’engagent à aplanir les hiérarchies entre les cliniciens et les patients – qui sont tous également appelés “membres de la communauté” – où la prise de décision et la responsabilité du traitement sont partagées. L’authenticité et l’intimité émotionnelle sont au cœur des relations entre les patients et entre les cliniciens et les patients. Nous passons beaucoup de temps ensemble, non seulement dans les diverses formes de séances de thérapie de groupe, mais aussi dans les activités sociales et les tâches quotidiennes, comme cuisiner, manger, nettoyer, jardiner ou faire des sorties en communauté. La “communauté” est vraiment le mot-clé ici – il n’y a pas de repli sur la “distance professionnelle”.
Outre les troubles de la personnalité, de nombreux membres de notre communauté souffrent également d’affections connexes, telles que des dépendances et des troubles alimentaires. De manière générale, ces troubles sont tous ce que l’on pourrait appeler des “troubles de l’action”. Les principaux symptômes diagnostiques ou facteurs de maintien des troubles de l’action sont les actions et les omissions : des modèles de comportement essentiels à la nature ou au maintien de la condition. Par exemple, le trouble de la personnalité limite est diagnostiqué en partie par l’automutilation délibérée et les tentatives de suicide, le comportement imprudent et impulsif, l’abus de substances, la violence et les accès de colère ; la dépendance est diagnostiquée par des schémas inadaptés de consommation de drogues ; les troubles de l’alimentation impliquent de manger trop ou trop peu. Pour qu’un usager puisse s’améliorer et, a fortiori, se rétablir de ces troubles, il doit changer le modèle de comportement diagnostiqué ou maintenu [47]. Par exemple, les utilisateurs de services souffrant de troubles de la personnalité borderline doivent cesser de s’automutiler ; les toxicomanes doivent arrêter de consommer des drogues ou de l’alcool ; les anorexiques doivent manger. Il y a, sans aucun doute, des composantes cognitives et affectives tout aussi centrales et importantes dans tous ces troubles. Le trouble de la personnalité borderline implique une instabilité de l’image de soi et une volatilité émotionnelle ; les toxicomanes peuvent consommer des drogues et de l’alcool pour faire face à leurs émotions négatives et à leur détresse psychologique ; les anorexiques peuvent avoir des idées surévaluées sur leur faible poids corporel et exprimer leur colère et obtenir un sentiment de contrôle en refusant de manger. Néanmoins, les actions et les omissions sont, d’un point de vue diagnostique, au cœur des troubles de l’action : un traitement efficace doit s’attaquer à ces schémas comportementaux fondamentaux, même si les résultats sont améliorés par une approche intégrative qui aborde le comportement en même temps que la cognition et l’affect.
Les patients souffrant de troubles de la personnalité sont notoirement difficiles à traiter. En psychiatrie, ils ont longtemps été stigmatisés comme les patients que “personne n’aime”. Mais de manière générale, les personnes qui se comportent de manière à se faire du mal ou à faire du mal aux autres – comme les toxicomanes et les personnes souffrant de troubles de l’alimentation – sont souvent très difficiles à traiter efficacement par les cliniciens, car leur comportement peut provoquer des émotions et des réactions intenses. Dans la clinique où je travaillais, les addictions étaient régulièrement conceptualisées comme des formes d’automutilation : des moyens malsains de faire face aux émotions négatives et à la détresse psychologique, offrant un soulagement à court terme, mais au prix – souvent non reconnu ou même souhaité par le patient – de causer des dommages à long terme et d’aggraver la situation. Il est extrêmement difficile de voir les personnes dont vous vous occupez se traiter avec un mépris brutal.13 Il est également extrêmement difficile de les voir agir d’une manière qui a un impact terrible sur les autres, en particulier ceux qui peuvent être dépendants d’eux et particulièrement vulnérables, comme leurs enfants. Le travail clinique nécessite une bonne relation thérapeutique. Mais quelle est la bonne attitude thérapeutique à adopter lorsque les patients se font directement du mal et en font indirectement à autrui, que ce soit par des coupures, des drogues ou d’autres moyens ?
Dans la communauté thérapeutique où j’ai travaillé, le personnel clinique était très clair sur l’attitude à adopter et y parvenait généralement, mais pas toujours. Les membres de la communauté étaient responsables de leurs actions et de leurs omissions et devaient en répondre devant la communauté – l’automutilation et les dommages causés aux autres n’étaient pas acceptés – mais une attitude de compassion et d’empathie prévalait, et ils n’étaient pas blâmés. En tant que clinicien novice, cette position de responsabilité sans blâme, comme j’ai été immédiatement enclin à la décrire, m’a frappé avec force. Et, pour être honnête, je n’avais au départ aucune idée de la façon dont cette position était conceptuellement possible, et encore moins réalisable pour moi-même dans le cadre de ma propre pratique clinique. Je pouvais donner un sens à l’idée que, malgré les apparences, un membre de la Communauté qui, par exemple, faisait un usage abusif de drogues et nuisait gravement à sa santé, à ses relations, à sa vie et à celle de son entourage, pouvait ne pas être responsable parce que sa dépendance l’excusait et qu’il ne devait donc pas être blâmé. En d’autres termes, je pourrais facilement invoquer un modèle de maladie de la dépendance, pour délégitimer le blâme en rendant leurs actions involontaires et donc la possibilité de leur attribuer une quelconque responsabilité. Et je pouvais donner un sens à l’idée que, malgré leur dépendance, ils étaient responsables, et donc à blâmer. En d’autres termes, je pouvais facilement voir comment le modèle moral pouvait être invoqué pour prétendument légitimer tout blâme que moi ou d’autres personnes pourrions ressentir. Mais la combinaison de la responsabilité sans le blâme pour des actions qui ont causé un préjudice grave – aux patients eux-mêmes ou à d’autres – m’a paru être une énigme philosophique et clinique.
Quelle est la source de cette énigme ? Tant au sein de la philosophie que dans notre culture en général, il existe une tendance profondément ancrée à lier l’idée de responsabilité fondamentalement à la moralité, en soutenant que son point ou son objectif est l’évaluation morale : l’évaluation d’une autre personne et de son comportement comme bon ou mauvais, juste ou faux. En outre, cette évaluation morale est parfois considérée comme fondamentalement affective [48] – incarnée et exprimée dans nos sentiments envers ceux dont nous condamnons moralement les actions. Ces sentiments peuvent inclure la colère, le ressentiment, la haine, l’indignation, le dégoût, la répulsion, le mépris et le mépris, et s’accompagnent souvent de pensées et d’actions tout aussi hostiles. Dans sa forme la plus radicale, le lien entre la responsabilité et ces types d’attitudes et d’expressions pourrait être considéré comme constitutif : “se considérer ou considérer un autre comme responsable, c’est simplement avoir la propension à réagir à son égard de cette manière” [49]. Plus modestement, tenir autrui pour responsable pourrait être compris comme consistant à croire que de telles réactions seraient appropriées ou adéquates, même si l’on ne ressent ou ne fait rien soi-même [50-52]. Mais ces nuances mises à part, l’idée de responsabilité qui émerge de ce tableau la relie fondamentalement à l’évaluation morale par le biais de notre pratique consistant à répondre aux autres par ce qui est en fait une forme affective de blâme – un ensemble de sentiments hostiles généralement accompagnés de pensées et d’actions tout aussi hostiles.14
La pratique clinique offre un correctif à cette tendance profondément enracinée. Le traitement efficace des troubles de l’action – lorsque les symptômes fondamentaux ou les facteurs de maintien impliquent des actions et des omissions, y compris celles qui causent du tort au patient ou à autrui – exige que les cliniciens s’engagent avec les patients en tant qu’agents responsables de leur comportement afin de les aider à changer [37, 41, 46, 47]. En effet, l’amélioration ou la guérison des troubles de l’agencement exige des patients qu’ils brisent le cycle en faisant les choses différemment. Comme le souligne Lewis, le modèle de la maladie et son “rôle de malade” correspondant n’aident pas les toxicomanes dans ce processus. Après tout, les gens n’essaient de changer que ce qu’ils croient être en mesure de changer [37, 53, 54]. Par conséquent, la tâche clinique avec ces patients n’est pas de nier leur action et de les sauver de la faute en pathologisant leur comportement, mais de travailler avec eux et de les aider à développer leur sens de l’action et de la responsabilité – de les soutenir et de leur donner les moyens de faire des choix différents. Dans la clinique, le but de l’utilisation du concept de responsabilité n’est donc pas fondamentalement une forme d’évaluation morale à rebours, par laquelle une personne est jugée et potentiellement condamnée pour son comportement passé. Au contraire, le but de l’utilisation du concept de responsabilité est fondamentalement tourné vers l’avant, servant à identifier où il existe une capacité de changement grâce à la présence de choix et de contrôle, et, par le biais de pratiques cliniques de responsabilisation, à motiver et à encourager les gens à briser le cycle – à se développer, à apprendre, et finalement à changer ce qu’ils choisissent de faire et leur sens de qui ils sont et peuvent être.
Bien sûr, la nature exacte des pratiques cliniques de responsabilisation et de reddition de comptes varie selon les modalités thérapeutiques. Mais au sein des communautés thérapeutiques, elles incluent généralement un retour d’information direct et stimulant, de sorte que les effets négatifs du comportement problématique sur soi, sur les autres et sur les relations sont explicités et doivent être affrontés, éventuellement avec l’imposition de conséquences si les membres continuent néanmoins à s’engager de manière répétée (généralement avec un avertissement préalable et l’accord de la personne). Ces conséquences impliquent inévitablement une composante réflexive, par laquelle l’histoire, les circonstances et la fonction psychologique consciente ou inconsciente du comportement problématique sont explorées, afin de développer la compréhension narrative que la personne a d’elle-même, de sorte qu’elle puisse mieux identifier ce qui l’empêche de changer et développer un plan pour réussir à l’avenir.15 Mais elles peuvent également impliquer des mesures qui peuvent potentiellement sembler punitives, comme le retrait de privilèges ou la suspension du groupe pour une durée limitée.
L’un des principes de base de la pratique clinique est que, comme ces formes de responsabilisation et d’obligation de rendre des comptes peuvent donner l’impression d’être punitives, elles doivent être appliquées avec une attitude de sollicitude, de respect et de compassion, et non accompagnées ou exprimées par des sentiments, des pensées ou des actions qui constituent une forme affective de blâme. Car, une fois encore, il ne s’agit pas d’évaluer et de condamner moralement, mais plutôt de prendre soin des patients et de les aider à s’améliorer et à se rétablir. Le blâme affectif est compris dans la pratique clinique comme minant la capacité de la responsabilité et de l’obligation de rendre des comptes pour permettre le changement et l’autonomisation, en raison de sa propension à faire en sorte que les patients se sentent rejetés, sans valeur, honteux et négligés, rompant ainsi la relation thérapeutique et détruisant tout sentiment d’espoir pour l’avenir qu’ils pourraient autrement avoir, et, par conséquent, toute motivation ou croyance qu’ils peuvent vraiment surmonter leurs difficultés [37, 39]. La clinique offre donc un correctif à la tendance à comprendre notre concept de responsabilité comme étant lié au blâme affectif, en offrant une pratique claire et établie d’attribution de la responsabilité pour le comportement problématique et en demandant des comptes sans blâme affectif, mais plutôt avec un regard positif, en maintenant des attitudes telles que la préoccupation, le respect et la compassion tout au long du processus.
Par conséquent, la réflexion sur la pratique clinique met en évidence une distinction entre, d’une part, le fait de savoir si le patient a le choix et un degré de contrôle suffisant sur son comportement pour qu’on lui demande de manière appropriée d’en assumer la responsabilité et de rendre des comptes et, d’autre part, la manière dont les autres réagissent aux patients qui sont responsables d’un comportement préjudiciable pendant le processus de traitement de ce comportement et de responsabilisation. Les membres de la communauté peuvent être responsables et tenus de rendre des comptes pour leur comportement nuisible, mais sans que le blâme affectif ne colore les attitudes et les actions de ceux qui s’engagent avec eux tout au long de ce processus.16
En effet, la position clinique de la responsabilité sans blâme trace une voie entre les modèles moral et pathologique de la dépendance. D’une part, comme le modèle moral, elle reconnaît le rôle du choix dans la dépendance, ouvrant ainsi la porte à la possibilité de la responsabilité. Bien sûr, il est important de reconnaître que le choix et la responsabilité ne sont pas tout ou rien, mais qu’ils sont graduels. Les gens peuvent avoir plus ou moins de choix à leur disposition, et plus ou moins de capacité de contrôle. Ceux qui, comme de nombreux toxicomanes, sont issus de milieux défavorisés ont généralement moins de choix à leur disposition ; de même, dans la mesure où la consommation de drogue est un mode habituel de gestion des émotions négatives et de la détresse psychologique, le désir de consommer est non seulement fort, mais il remplit également une fonction psychologique importante. Il est donc extrêmement difficile de renoncer aux drogues à moins que et jusqu’à ce que les sentiments et les difficultés sous-jacents soient abordés, que d’autres mécanismes d’adaptation plus sains soient appris et que d’autres options soient disponibles. Pour ces raisons et d’autres, l’action peut parfois être réduite par rapport à la norme, et la responsabilité réduite en conséquence. Mais la réduction n’est pas l’extinction : les choix peuvent être limités et le contrôle difficile à atteindre, sans que l’un ou l’autre soit annulé.17
D’autre part, contrairement au modèle moral mais comme le modèle de la maladie, la position clinique de la responsabilité sans blâme maintient une attitude de soin envers les dépendants. Mais elle n’y parvient pas en niant l’action des toxicomanes afin de les disculper de toute responsabilité, rendant ainsi toute amélioration ou guérison dépendante d’une “cure” médicale. Elle vise plutôt à mobiliser le sens de l’action et de l’autonomie des toxicomanes, en évitant de les blâmer non pas en les concevant comme des victimes impuissantes de la maladie, mais en reconnaissant leur action et en travaillant avec elle sans adopter des attitudes et des pratiques moralisatrices ou stigmatisantes. Indéniablement, cela va à l’encontre de nombreux aspects du climat culturel actuel, qui semble avoir un appétit presque insatiable pour la moralisation et le blâme, et – comme nous l’avons vu au début de cet article – stigmatise sévèrement les consommateurs de drogues et les toxicomanes. Mais – et c’est là le point essentiel – tout comme ceux que nous pouvons nous trouver inconsidérément enclins à blâmer et à stigmatiser ont souvent le choix de leur comportement, nous avons le choix de notre réaction. Il y a des choix à faire des deux côtés.
EN CONCLUSION : QUELQUES PREMIERS PAS VERS L’INTERROGATION DE NOS PROPRES ATTITUDES À L’ÉGARD DE LA CONSOMMATION DE DROGUES ET DE LA TOXICOMANIE.
Marc Lewis a diagnostiqué un véritable dilemme : le modèle de la maladie n’est ni crédible face aux preuves ni utile dans la mesure où il déresponsabilise les toxicomanes ; mais, avec l’influence continue du modèle moral sur notre pensée, un modèle de choix invite au blâme et à la stigmatisation en attribuant l’agence et la responsabilité aux toxicomanes. En réponse, il a choisi de prendre ses distances par rapport aux deux modèles. Mais il s’agit là d’une position instable, compte tenu de la preuve que les toxicomanes réagissent aux incitations et de l’importance de l’agence et de la responsabilité – à côté d’autres facteurs, bien sûr – pour surmonter la dépendance. Nous devons accepter un modèle de choix de la dépendance – bien que la nécessité de contextualiser les choix et de comprendre les différentes manières dont le contrôle, l’agence, et donc la responsabilité, peuvent être réduits dans la dépendance soit tout aussi cruciale [16, 19, 20, 37, 54, 56-58].18
Cependant, l’acceptation d’un modèle de choix de la dépendance entraîne un fardeau moral. Étant donné qu’il invite au blâme et à la stigmatisation, il est obligatoire de veiller à ce qu’il soit rejeté. Les modèles de choix de la dépendance devraient donc être associés à une pratique consistant à interroger nos propres attitudes à l’égard de la dépendance, ainsi qu’à un engagement à œuvrer pour la justice sociale. Le modèle clinique de la responsabilité sans blâme ouvre cette possibilité en distinguant mieux notre concept de responsabilité de celui de blâme, contribuant ainsi à bloquer toute tendance immédiate à glisser de l’un à l’autre – en théorie et en pratique. Mais la tâche difficile demeure, celle de faire évoluer les mentalités et de lutter pour le bien social. Je voudrais conclure en faisant un petit pas vers cet objectif, en diagnostiquant comment un choix forcé entre le modèle moral et le modèle de la maladie fonctionne pour nous empêcher de réfléchir à la part que nous avons, en tant que société, dans la consommation de drogues et la toxicomanie.
Supposons que nous commencions par poser une question directe pour remettre en question le modèle moral : Qu’est-ce qui est précisément censé être mauvais dans la consommation de drogues ?19 Tout au long de l’histoire de l’humanité, les drogues ont été utilisées comme moyen d’atteindre une foule de fins utiles, dont au moins les suivantes : (1) amélioration des interactions sociales ; (2) facilitation de l’accouplement et des rapports sexuels ; (3) amélioration des performances cognitives ; (4) facilitation de la récupération et de la gestion du stress ; (5) automédication des émotions négatives, de la détresse psychologique et d’autres problèmes et symptômes de santé mentale ; (6) curiosité sensorielle – élargissement de l’horizon expérimental ; et, enfin, (7) euphorie et hédonie – en d’autres termes, plaisir [60]. Les drogues nous font nous sentir bien, soulagent la souffrance et nous aident à faire diverses choses que nous voulons mieux faire. Si l’on adhère aux valeurs libérales fondamentales, où la liberté individuelle de rechercher une multiplicité de biens est respectée tant que cela ne nuit pas à autrui, il est difficile de voir ce qu’il y a de mal à consommer des drogues en soi [61]. En d’autres termes, en règle générale, la consommation de drogues ne devient problématique que si elle entraîne les conséquences négatives caractéristiques de la dépendance – les dommages chroniques et graves causés à soi-même et aux autres.20 Pour la grande majorité des personnes qui consomment des drogues, leur consommation ne s’intensifie jamais et n’atteint pas ce point : la consommation est gérée de manière à ce que les avantages dépassent les coûts, et aucun dommage évident (ou injustifiable par rapport aux avantages) n’est encouru par quiconque.
Supposons maintenant que nous posions une autre question directe : Lorsque la consommation s’intensifie jusqu’à la dépendance, qui doit être tenu responsable des conséquences négatives qui en découlent ? Selon le modèle moral, ce sont les toxicomanes eux-mêmes qui sont non seulement responsables, mais aussi à blâmer, car ils sont considérés comme des personnes de mauvaise moralité aux valeurs antisociales. Selon le modèle de la maladie, les toxicomanes ne sont ni responsables ni à blâmer ; leur état est le résultat d’une maladie qui s’est installée, et les conséquences négatives de la consommation de drogues ne sont donc la faute de personne – dans la mesure où nous pouvons “blâmer” quelque chose, c’est la maladie elle-même.21 En tant que partisan d’un modèle de choix de la dépendance, je ne nie pas, bien sûr, qu’une certaine responsabilité – mais, surtout, une responsabilité distincte du blâme – incombe aux toxicomanes eux-mêmes ; bien qu’il soit important de se rappeler qu’il y aura parfois des justifications ou des excuses complètes ou partielles, par exemple, celles liées à la nécessité de contextualiser les choix et de reconnaître comment et quand le contrôle peut être réduit.22 Le point que je souhaite souligner cependant est que, en plaçant la responsabilité sur les toxicomanes ou leur maladie respectivement, les deux modèles sont unis pour nous permettre de détourner notre attention de nous-mêmes et de notre société, en évitant la question de savoir si nous, en tant que société, portons aussi collectivement une certaine responsabilité dans la consommation de drogues et la toxicomanie et les dommages qui en découlent.
Portons-nous collectivement cette responsabilité ? Comme nous l’avons vu plus haut, un nombre disproportionné de toxicomanes sont issus de milieux socio-économiques défavorisés, ont souffert d’abus et d’adversité dans leur enfance, sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et sont membres de groupes ethniques minoritaires ou d’autres groupes victimes de préjugés et de discrimination. Ils peuvent souffrir d’une détresse psychologique extrême et d’une multitude de problèmes de santé mentale autres que leur dépendance [12], ressentir un manque d’intégration psychosociale [10, 14, 15] et être désavantagés sur le plan socio-économique, de sorte que leurs possibilités sont très limitées [10, 11, 13]. Ces circonstances sont essentielles pour comprendre la dépendance dans de nombreux contextes [16, 19, 20, 36, 54]. En termes simples, la raison en est que les drogues offrent un moyen de faire face au stress, à la douleur et à certaines des pires misères de la vie, lorsqu’il y a peu de possibilités d’espoir ou d’amélioration véritables et que les biens alternatifs proposés sont limités. Dans de telles circonstances, les inconvénients de la consommation de drogues doivent être mis en balance avec les inconvénients de la non-utilisation. C’est pourquoi l’explication de la dépendance et des conséquences négatives qui lui sont associées réside en grande partie dans les circonstances psycho-socio-économiques qui causent cette souffrance et limitent les possibilités. Et l’existence de ces circonstances est une caractéristique de notre société dont nous devons tous collectivement assumer la responsabilité, car nous la tolérons.
On peut donc considérer que le modèle moral et le modèle de la maladie de la dépendance fonctionnent tous deux comme une défense psychologique – nous empêchant de concentrer notre attention sur l’existence de ces circonstances et sur leur rôle dans l’explication de la consommation de drogues et de la dépendance, et maintenant ainsi à distance la conscience de notre propre responsabilité collective pour ces faits. L’une des raisons pour lesquelles nous blâmons et stigmatisons les toxicomanes pour leurs choix est peut-être que c’est plus confortable que de faire face aux aspects de notre société qui font que les drogues – quel qu’en soit le coût – sont une si bonne option pour beaucoup de nos membres déjà vulnérables et défavorisés.23
NOTES.
J’inclus l’alcool, ainsi que toutes les substances psychoactives illicites et pharmaceutiques courantes, dans la référence du terme “drogues”.
Pour un projet visant à contrer les images médiatiques stéréotypées des toxicomanes, voir les documentaires photographiques d’Aaron Goodman sur les consommateurs d’héroïne à long terme : http://outcastsproject.com/ et aussi http://www.storyturns.org/.
Les arguments en faveur de la décriminalisation de toutes les substances psychoactives et de leur réglementation sont extrêmement forts [4] ; voir également http://www.countthecosts.org/seven-costs. En outre, si les substances psychoactives doivent être criminalisées, il n’existe aucune justification neurochimique ou de santé publique valable pour exempter l’alcool, qui est associé à des taux élevés de dépendance et de dommages [5].
Cependant, il est important de noter que la déviance sociale peut parfois être une source d’identité et de valeur positives, en particulier pour ceux qui appartiennent à une sous-culture partagée [6, 7].
À l’heure où j’écris cet article, à l’automne 2016, on rapporte que plus de 2500 personnes ont été assassinées aux Philippines au cours des derniers mois, dans le cadre de la politique explicite du président Rodrigo Duterte visant à éradiquer la drogue en tuant tous ceux qui en vendent ou en consomment.
Dans The Biology of Desire [21], Marc Lewis suggère que cette ligne de pensée est ce qui anime Nora Volkow, l’un des puissants partisans du modèle de la maladie de la dépendance : ” Pourtant, son principal objectif […] était de faciliter le traitement des personnes qui en avaient besoin “. Qualifier la dépendance de maladie permet non seulement d’atténuer les volumes massifs de stigmatisation et de culpabilité, mais aussi de fournir aux toxicomanes des moyens accessibles de se faire aider. Cela semble être son objectif principal”.
Comme le dit Owen Flanagan : “La reclassification [de la dépendance en tant que maladie et donc “moins volontaire, plus involontaire” qu’un “choix de style de vie pécheur”] visait à modifier certaines pratiques de blâme et de responsabilité” [17].
La recherche suggère que cela n’aide pas à promouvoir le rétablissement : la croyance en un modèle de maladie de l’alcoolisme est corrélée à la probabilité de rechute six mois après le traitement [23].
Pour une discussion de certaines des caractéristiques les plus frappantes de cette recherche, voir Pickard et Ahmed [20].
Pour une discussion plus approfondie, voir Pickard [36], Pickard et Ahmed [20].
Le point de vue d’Augusten Burroughs sur la dépendance dans son livre This is How : Surviving What You Think You Can’t [40] exprime puissamment des éléments de ces deux préoccupations, que je cite longuement pour une perspective pertinente de première personne (mais notez qu’il y aura, bien sûr, des dépendants qui ne partagent pas le point de vue de Burroughs, ainsi que des éléments de l’expérience et de la nature de la dépendance qui sont sans doute importants mais omis) : “Ce qui a fonctionné pour moi, c’est de trouver quelque chose que je voulais plus que je ne voulais boire, ce qui était un putain de lot. Il s’agit moins d’une décision que d’une découverte. Et c’est pour cette raison que tout le monde ne deviendra pas sobre. Mon point de vue selon lequel la façon d’arrêter de boire est d’arrêter de boire est ridiculement simpliste à première vue. C’est “Dites simplement non”. Mais c’est aussi vrai. La façon d’arrêter de boire est de vouloir plus de sobriété. Et quand vous ressentez une envie, ressentez-la jusqu’à ce qu’elle passe. Mais ne passez pas à l’acte – pas plus que vous ne tueriez quelqu’un que vous avez envie de tuer lorsqu’il vous coupe la route. Ce n’est pas parce que vous avez envie de quelque chose que vous devez l’avoir. Je sais à quel point c’est exaspérant à entendre. La rechute est la crise de colère que vous vous autorisez à avoir lorsque vous vous interdisez de boire. Pour arrêter de boire, tu arrêtes de boire. Vous vous en débarrassez tout de suite. Tout le reste – les livres, les thérapies et les programmes – ne sont que des aides. Ils visent tous à accomplir la même chose : vous convaincre de ne pas boire. Je dis que si vous voulez arrêter, vous le ferez […] Pour réussir à ne pas boire, une personne doit occuper l’espace dans sa vie que l’alcool remplissait autrefois avec quelque chose de plus gratifiant que le confort et l’évasion de l’alcool. C’est cette chose que vous devez trouver. Vous ne le trouverez peut-être pas. La plupart des alcooliques ne le feront pas. La vérité est que les personnes qui ne peuvent pas arrêter de boire sont des personnes qui, quelle que soit la culpabilité qu’elles ressentent et quelles que soient les conséquences, sont devenues tellement dépendantes de la drogue et de l’expérience qu’elles la préfèrent au reste de leur vie. Même si elles souhaitent vraiment être sobres, elles veulent boire davantage. La pensée qui précède une rechute – en tout cas dans mon cas et je parie que c’est aussi le cas pour d’autres – est “on s’en fout”. Et puis merde est une expression idiomatique qui signifie “je m’en fous”. Prendre un verre, c’est le contraire de l’impuissance. C’est prendre une action ferme et décisive pour mettre fin à un état de sobriété qui semble moins satisfaisant et moins convaincant que ce que l’on a ressenti en buvant dans le passé ou que l’on imagine dans le présent. […] Le mythe selon lequel les alcooliques sont impuissants et incapables de façonner l’issue de leur dépendance est un message fatal et profondément faux. Aucun alcoolique ne devrait se sentir impuissant face à l’alcool. Ceux qui meurent n’étaient pas impuissants. Soit elles ont choisi l’alcool, soit elles ont glissé passivement vers l’issue inévitable de la consommation d’alcool ; elles ont pris une décision en choisissant de ne rien faire. Et c’est ce choix qui entraîne la mort […] En fin de compte, le traitement de la dépendance – jusqu’à ce qu’il existe un médicament efficace, et si c’est le cas – réside dans la personne dépendante. Vous ne pouvez pas passer votre temps à attendre que la cure de désintoxication “fonctionne” ou que quelque chose vous “répare”. Ces choses peuvent vous inspirer ou vous encourager, et elles le font. Vous n’avez pas besoin d’agir pour arrêter de boire. Boire est une action : verser la vodka dans le verre, porter le verre à ses lèvres. Pour arrêter de boire, il suffit de s’asseoir. Dans 100 % des cas documentés d’alcoolisme dans le monde, les personnes qui se sont rétablies avaient toutes une chose en commun, quelle que soit la manière dont elles s’y sont prises : Ils ne l’ont pas fait. Elles ne l’ont tout simplement pas fait. Vous pouvez absolument arrêter de boire aujourd’hui, tout de suite. La question est seulement de savoir si vous voulez être sobre plus que vous ne voulez boire. Très peu de personnes peuvent répondre sincèrement à cette question et répondre “oui”. J’espère que vous êtes l’une d’entre elles. Peut-être que vous l’êtes. Je ne pensais pas que je l’étais.
Comment caractériser précisément la forme idéale de cette relation est une question difficile. Une possibilité est de s’inspirer de la distinction entre soins et attachement telle que clarifiée par Wonderly [45] : les cliniciens doivent prendre soin des patients sans s’attacher à eux ; ou, peut-être, en développant une forme d’attachement partiel ou “quasi” seulement. Pour une discussion plus approfondie sur la nature et l’efficacité des communautés thérapeutiques, voir Pearce et Pickard [46].
La famille et les amis qui s’occupent de personnes souffrant de troubles de la personnalité et de troubles connexes le savent bien sûr encore mieux que les cliniciens qui travaillent avec elles.
Pour une discussion plus approfondie du blâme affectif, voir Pickard [37, 41, 42]. Le style de blâme varie évidemment beaucoup d’un individu à l’autre, en particulier selon qu’il est “chaud” et direct dans son agressivité ou “froid” et passif-agressif.
C’est pourquoi, bien que l’objectif fondamental de l’utilisation du concept de responsabilité dans la clinique soit tourné vers l’avant, la pratique de cette démarche contient néanmoins des éléments tournés vers l’arrière, dans la mesure où l’exploration réflexive du passé peut être utilisée pour faciliter le changement dans le futur. Pour une discussion, voir Pickard [24].
Bien entendu, je ne prétends pas que les cliniciens et les membres de la communauté parviennent toujours à atteindre cette position de responsabilité sans reproche dans la pratique. Il s’agit plutôt d’une norme directrice ou d’un principe implicite de l’engagement clinique dans certains contextes thérapeutiques, qui est souvent, sinon inévitablement, atteint. Pour une discussion de certains facteurs et techniques facilitant la compétence clinique consistant à tenir les gens responsables sans les blâmer, voir Pickard [37], Pearce et Pickard [46, 54], Lacey et Pickard [43, 44].
Le concept de responsabilité employé dans la clinique est lié au choix et au contrôle – peut-être en raison du pouvoir de ces idées de motiver et de permettre un sens de l’agence pour le changement [38, 39]. Mais pour ceux qui préfèrent un compte-rendu de la responsabilité basé sur les raisons [52], il peut être substitué en théorie et la distinction de base entre la responsabilité et le blâme préservée : la clé est simplement de ne pas lier un compte-rendu de la responsabilité aux émotions et attitudes constitutives du blâme affectif. Pour une discussion sur l’idée de degrés de responsabilité en relation avec un compte rendu de la réponse aux raisons, voir Coates et Swenson [55]. Pour une discussion sur la manière de comprendre potentiellement les façons dont le choix et le contrôle peuvent être présents mais réduits dans la dépendance, voir Holton et Berridge [56] et Henden [57].
Notons que Lewis lui-même souligne l’importance de ces considérations par rapport au choix tout au long de The Biology of Desire [21], à la fois tacitement dans son récit des histoires personnelles des toxicomanes, et explicitement dans ses discussions d’introduction et de conclusion (voir notamment les chapitres un, huit et neuf). Pour cette raison, bien qu’il prétende être hostile aux modèles de choix traditionnels, il est possible qu’il ne soit pas hostile à un modèle de choix plus nuancé ainsi reconfiguré.
Rappelons que je considère l’alcool, ainsi que toutes les substances psychoactives illicites et pharmaceutiques courantes, comme des drogues (voir note de bas de page 1) ; et qu’il n’existe aucune justification neurochimique ou de santé publique valable pour distinguer l’alcool et de nombreux produits pharmaceutiques de ce type des drogues illicites (voir note de bas de page 3) – en effet, dans certains cas (par exemple la méthamphétamine et la d-amphétamine [59]), il y a peu de différence neurochimique ou expérimentale entre les produits pharmaceutiques courants et les drogues illicites.
“En règle générale”, car il y a bien sûr des exceptions, notamment les cas tragiques où des consommateurs récréatifs généralement jeunes et inexpérimentés meurent après avoir consommé des drogues contenant des toxines, mélangé plusieurs substances ou pris des doses trop élevées. Toutefois, ce risque pourrait être considérablement réduit grâce à la décriminalisation et à une réglementation garantissant la disponibilité de sources fiables de drogues, ainsi qu’à des initiatives d’éducation publique adéquates fournissant des informations précises sur la manière d’utiliser les drogues en toute sécurité. Carl Hart a défendu avec force ces deux points et propose une éducation à la sécurité des drogues sur son site web ; voir http://drcarlhart.com/.
Il convient toutefois de noter, pour plus de clarté, qu’il est bien entendu conforme au modèle de la maladie de considérer que, même s’ils ne sont pas responsables de leur consommation actuelle de drogue et de ses conséquences, les toxicomanes peuvent néanmoins porter une part de responsabilité dans le fait d’être devenus dépendants en premier lieu.
Pour une discussion plus approfondie de ces points et d’autres points connexes en relation avec la responsabilité pénale, voir Morse [62].
Merci à Steve Matthews et Anke Snoek pour leurs commentaires utiles sur une version précédente de cet article, ainsi qu’à Stephen Morse pour m’avoir fait découvrir le travail d’Augusten Burroughs, cité dans la note de bas de page 11.
Dernière modification par pierre (04 mars 2023 à 16:32)
Hors ligne

- Morning Glory

- Ex modo
- Inscrit le 10 Oct 2017
- 4409 messages
- Blogs
Échec Scolaire a écrit
Dans la culture occidentale contemporaine, nous tenons généralement les gens responsables de leurs actes s’ils ont le choix et pouvaient donc agir autrement, et nous les exonérons de toute responsabilité dans le cas contraire
L'erreur fondamentale d'attribution ! Biais psychologique commun. On y revient sous peu
Échec Scolaire a écrit
Supposons que nous commencions par poser une question directe pour remettre en question le modèle moral : Qu’est-ce qui est précisément censé être mauvais dans la consommation de drogues ?19 Tout au long de l’histoire de l’humanité, les drogues ont été utilisées comme moyen d’atteindre une foule de fins utiles, dont au moins les suivantes : (1) amélioration des interactions sociales ; (2) facilitation de l’accouplement et des rapports sexuels ; (3) amélioration des performances cognitives ; (4) facilitation de la récupération et de la gestion du stress ; (5) automédication des émotions négatives, de la détresse psychologique et d’autres problèmes et symptômes de santé mentale ; (6) curiosité sensorielle – élargissement de l’horizon expérimental ; et, enfin, (7) euphorie et hédonie – en d’autres termes, plaisir [60]. Les drogues nous font nous sentir bien, soulagent la souffrance et nous aident à faire diverses choses que nous voulons mieux faire. Si l’on adhère aux valeurs libérales fondamentales, où la liberté individuelle de rechercher une multiplicité de biens est respectée tant que cela ne nuit pas à autrui, il est difficile de voir ce qu’il y a de mal à consommer des drogues en soi [61]. En d’autres termes, en règle générale, la consommation de drogues ne devient problématique que si elle entraîne les conséquences négatives caractéristiques de la dépendance – les dommages chroniques et graves causés à soi-même et aux autres.20 Pour la grande majorité des personnes qui consomment des drogues, leur consommation ne s’intensifie jamais et n’atteint pas ce point : la consommation est gérée de manière à ce que les avantages dépassent les coûts, et aucun dommage évident (ou injustifiable par rapport aux avantages) n’est encouru par quiconque
Le coeur du sujet.
Échec Scolaire a écrit
Dans de telles circonstances, les inconvénients de la consommation de drogues doivent être mis en balance avec les inconvénients de la non-utilisation. C’est pourquoi l’explication de la dépendance et des conséquences négatives qui lui sont associées réside en grande partie dans les circonstances psycho-socio-économiques qui causent cette souffrance et limitent les possibilités. Et l’existence de ces circonstances est une caractéristique de notre société dont nous devons tous collectivement assumer la responsabilité, car nous la tolérons.
Again.
Échec Scolaire a écrit
Rappelons que je considère l’alcool, ainsi que toutes les substances psychoactives illicites et pharmaceutiques courantes, comme des drogues (voir note de bas de page 1) ; et qu’il n’existe aucune justification neurochimique ou de santé publique valable pour distinguer l’alcool et de nombreux produits pharmaceutiques de ce type des drogues illicites (voir note de bas de page 3) – en effet, dans certains cas (par exemple la méthamphétamine et la d-amphétamine [59]), il y a peu de différence neurochimique ou expérimentale entre les produits pharmaceutiques courants et les drogues illicites.
“En règle générale”, car il y a bien sûr des exceptions, notamment les cas tragiques où des consommateurs récréatifs généralement jeunes et inexpérimentés meurent après avoir consommé des drogues contenant des toxines, mélangé plusieurs substances ou pris des doses trop élevées. Toutefois, ce risque pourrait être considérablement réduit grâce à la décriminalisation et à une réglementation garantissant la disponibilité de sources fiables de drogues, ainsi qu’à des initiatives d’éducation publique adéquates fournissant des informations précises sur la manière d’utiliser les drogues en toute sécurité. Carl Hart a défendu avec force ces deux points et propose une éducation à la sécurité des drogues sur son site web ; voir http://drcarlhart.com/.
Merci infiniment pour le partage !
Dernière modification par Morning Glory (17 janvier 2023 à 08:55)
Μόρνηνγγ Γλωρύ
I <3 5-HT & DA ~
Hors ligne

- prescripteur

- Modérateur
- Inscrit le 22 Feb 2008
- 12198 messages
- Blogs
Pour la grande majorité des personnes qui consomment des drogues, leur consommation ne s’intensifie jamais et n’atteint pas ce point : la consommation est gérée de manière à ce que les avantages dépassent les coûts, et aucun dommage évident (ou injustifiable par rapport aux avantages) n’est encouru par quiconque.
Supposons maintenant que nous posions une autre question directe : Lorsque la consommation s’intensifie jusqu’à la dépendance, qui doit être tenu responsable des conséquences négatives qui en découlent ? Selon le modèle moral, ce sont les toxicomanes eux-mêmes qui sont non seulement responsables, mais aussi à blâmer, car ils sont considérés comme des personnes de mauvaise moralité aux valeurs antisociales. Selon le modèle de la maladie, les toxicomanes ne sont ni responsables ni à blâmer ; leur état est le résultat d’une maladie qui s’est installée, et les conséquences négatives de la consommation de drogues ne sont donc la faute de personne – dans la mesure où nous pouvons “blâmer” quelque chose, c’est la maladie elle-même.21 En tant que partisan d’un modèle de choix de la dépendance, je ne nie pas, bien sûr, qu’une certaine responsabilité – mais, surtout, une responsabilité distincte du blâme – incombe aux toxicomanes eux-mêmes ; bien qu’il soit important de se rappeler qu’il y aura parfois des justifications ou des excuses complètes ou partielles, par exemple, celles liées à la nécessité de contextualiser les choix et de reconnaître comment et quand le contrôle peut être réduit.22 Le point que je souhaite souligner cependant est que, en plaçant la responsabilité sur les toxicomanes ou leur maladie respectivement, les deux modèles sont unis pour nous permettre de détourner notre attention de nous-mêmes et de notre société, en évitant la question de savoir si nous, en tant que société, portons aussi collectivement une certaine responsabilité dans la consommation de drogues et la toxicomanie et les dommages qui en découlent.
Portons-nous collectivement cette responsabilité ? Comme nous l’avons vu plus haut, un nombre disproportionné de toxicomanes sont issus de milieux socio-économiques défavorisés, ont souffert d’abus et d’adversité dans leur enfance, sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et sont membres de groupes ethniques minoritaires ou d’autres groupes victimes de préjugés et de discrimination. Ils peuvent souffrir d’une détresse psychologique extrême et d’une multitude de problèmes de santé mentale autres que leur dépendance [12], ressentir un manque d’intégration psychosociale [10, 14, 15] et être désavantagés sur le plan socio-économique, de sorte que leurs possibilités sont très limitées [10, 11, 13]. Ces circonstances sont essentielles pour comprendre la dépendance dans de nombreux contextes [16, 19, 20, 36, 54]. En termes simples, la raison en est que les drogues offrent un moyen de faire face au stress, à la douleur et à certaines des pires misères de la vie, lorsqu’il y a peu de possibilités d’espoir ou d’amélioration véritables et que les biens alternatifs proposés sont limités. Dans de telles circonstances, les inconvénients de la consommation de drogues doivent être mis en balance avec les inconvénients de la non-utilisation. C’est pourquoi l’explication de la dépendance et des conséquences négatives qui lui sont associées réside en grande partie dans les circonstances psycho-socio-économiques qui causent cette souffrance et limitent les possibilités. Et l’existence de ces circonstances est une caractéristique de notre société dont nous devons tous collectivement assumer la responsabilité, car nous la tolérons.
Dernière modification par prescripteur (17 janvier 2023 à 10:48)
S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Devise Shadok (et stoicienne)
Hors ligne

- prescripteur

- Modérateur
- Inscrit le 22 Feb 2008
- 12198 messages
- Blogs
https://www.hannapickard.com/
Traduction google d'un chapitre
De votre point de vue, quels changements sont nécessaires pour mieux lutter contre la toxicomanie? Quels changements faut-il dans notre compréhension socialement acceptée de la dépendance, et ces changements doivent-ils nécessairement être d'abord possible?
Mon point de vue peut être repris dans trois principes de base.
Premièrement, nous devrions dépénaliser toute consommation de drogue et la réglementer à la place. Je ne connais pas de bonne théorie de la portée du droit pénal qui justifie une sanction pénale pour un comportement privé tel que la consommation de drogue. L'implication de l'État dans la consommation de drogue de ses citoyens ne devrait être que réglementaire, ce qui implique la surveillance et le contrôle de la production et de la distribution, ainsi que l'imposition de divers types de garanties et la fourniture d'une éducation adéquate en matière de sécurité des médicaments. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, et l'élaboration des détails des formes idéales de régulation est à la fois compliquée et nécessairement une question d'essais et d'erreurs. Mais certaines des réussites et des pratiques que nous constatons dans des pays comme le Portugal et la Suisse peuvent fournir des orientations initiales.
Deuxièmement, nous devons nous attaquer aux multiples formes de désavantage et de vulnérabilité qui sont associées au risque d'élaborer un DAU. Il s'agit en tout cas d'une question de justice sociale, de sorte que son importance dans la lutte contre la toxicomanie est simplement une raison de plus parmi les autres que nous devons déjà combattre les inégalités, l'adversité et les mauvais traitements, et créer une société où nous avons tous la chance de nous épanouir.
Troisièmement, nous devons offrir un traitement plus large et meilleur pour les DAU. Il existe des interventions innovantes qui ont été développées ici à Johns Hopkins, dont le modèle Therapeutic Workplace, qui a été développé par Ken Silverman, et la thérapie assistée par la psilocybine pour la toxicomanie, qui a été développée par Roland Griffiths. Mais nous devons également supprimer les obstacles de toutes les formes de traitement actuellement disponibles, y compris les approches de minimisation des dommages telles que la thérapie assistée par les médicaments et les aiguilles propres. Trop souvent en relation avec les DAU, notre volonté d'offrir un traitement que nous savons que cela pourrait faire une différence dans la vie de quelqu'un dépend de sa conformité - non seulement avec le traitement lui-même, mais aussi avec notre vision de la moralité et de la façon dont ils devraient vivre. Je pense que l'une des principales raisons pour lesquelles nous n'apparons pas les gens et ne nous attaquons pas aux terribles dommages que l'addiction inflige à tant de personnes est que même ceux qui adoptent un modèle de maladie de la toxicomanie et se soucient profondément d'aider les gens avec les SUD à continuer parfois à moraliser la consommation de drogues et à la considérer comme une erreur. Nous devons remettre en question cette tendance au moralisme en nous-mêmes afin de traiter de manière morale et clinique les personnes qui prennent des drogues.
S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Devise Shadok (et stoicienne)
Hors ligne

- Mychkine

- Artichaut dans une caisse d'oranges
- Inscrit le 22 Dec 2020
- 392 messages
Selon elle, le fait que les personnes aient la capacité d'agir sur leurs désirs (inconscients, sur le long terme), leurs projets (conscients et sur le court et long terme) et leurs choix (conscients, court terme) réfute l'idée selon laquelle l'addiction est une maladie.
Mais le concept de maladie, tout labile qu'il soit, n'est pas aussi socialement péremptoire qu'elle le pense, y compris au sein de la communauté médicale. Deux exemples d'affections considérées (à raison amha) comme des pathologies, mais sur lesquelles une action volontaire et une influence palpable de l'individu sont déterminantes, me viennent à l'esprit. Déjà, les dépressions. Qui ont des causes biologiques, psychologiques et sociales, et dont les personnes atteintes peuvent dans beaucoup de cas (pas dans tous hélas) s'extirper en agissant sur les deuxième et troisième (et sur la première à plus long terme), que ce soit par l'exercice physique, la lutte contre les schémas de pensée automatiques délétères, la mise en place d'activités, etc. Les antidépresseurs sont bien entendu une aide appréciable, mais la façon actuelle d'aborder la dépression ne se réduit pas au prisme chimique.
Deuxièmement, l'approche médicale présente des TOCs (rituels envahissants visant à soulager une angoisse) s'approche beaucoup de ce que préconise Hannah Pickard vis-à-vis des addictions : aide médicamenteuse et psychologique, absence de culpabilisation, insistance sur la capacité de l'individu à dépasser sa dépendance à l'égard des compulsions qu'il a développées.
Ici, la maladie n'est mise en avant que pour insister sur la légitimité qu'a la personne à chercher de l'aide médicale. (Et sur l'inutilité de la culpabilisation).
Pour moi, la pathologie, ici, ce n'est pas l'"absence de choix" au sens littéral (qui n'existe quasi jamais, comme elle le souligne), mais plutôt l'importance extrême que revêtent la place (émotionelle/sensible) des rituels dans un cas, le plaisir/soulagement immédiat provoqué par les substances dans l'autre. Evidemment on parle de variables continues. Donc le seuil à partir duquel la disproportion devient pathologique est parfaitement arbitraire. Mais ce n'est pas selon moi un prétexte valable pour se détacher systématiquement de l'entité "pathologie" qui a l'avantage d'exprimer le fait qu'un état n'est pas souhaitable (pour la personne atteinte). (Il peut aussi être distordu de bien des façons pour servir des agendas idéologiques, appliqué sans pertinence à toutes sortes de populations, bien sûr, mais ce n'est pas mon propos). Le fait que ledit état résulte d'un apprentissage psycho- et neurologique est une variable importante pour comprendre l'étiologie du phénomène, mais n'influe pas sur ces conclusions.
Je remarque aussi qu'elle ne fait pas de différence sémantique entre dépendance et addiction, soit qu'elle confonde les deux, soit qu'elle assimile toutes les dépendances à des addictions.
Or ce n'est pas nécessairement vrai (cas des TSO, des AD, de l'insuline, etc).
Ce qui influe peut-être sur sa tendance à considérer les personnes dépendantes (à une substance, pour leur bien-être/santé) comme n'étant pas malades (= addictes (cravings, poursuite des pratiques malgré les conséquences négatives à long terme et que les individus choisissent d'éviter s'ils peuvent se détacher des impulsions (immédiates, non-conscientes) que leur conso leur a imposées à travers la neuroplasticité induite (coeur de la pathologie) ; détachement qui n'est pas impossible mais peut justifier tout de même une aide médico-psychologique)).
Donc j'suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle avance. Après, il existe peut-être des différences culturelles dans l'acception des mots qu'elle emploie, ainsi que dans les politiques à l'égard des drogues (et même en général : très teintées de messianisme religieux aux USA et fort peu nuancées dans un sens comme dans l'autre), qui me font déformer le fond de sa pensée.
Je n'asserte pas tout ça de façon définitive, je suis prêt à remettre en question c'que je dis, mais c'est l'état actuel de mon appréhension de la question relative aux dépendances/addictions/maladies et à la problématique de leur responsabilité...
Dernière modification par Mychkine (18 janvier 2023 à 10:53)
Hors ligne

- prescripteur

- Modérateur
- Inscrit le 22 Feb 2008
- 12198 messages
- Blogs
En fait ces mots consistent en des généralisations artificielles qui négligent le fait qu'ils sont la somme de Personnes , bien réelles, alors qu'elles même ne sont que des fictions.
Comme les "français", les "allemands", les "femmes" etc..
Par exemple, le mot "alpinistes" décrit des personnes pratiquant l'alpinisme mais au delà de ce fait, je ne peux rien dire d'un alpiniste en particulier. Est il petit, grand, actif, prudent ? Est une maladie d'être alpiniste ? d'ëtre imprudent ? Est ce un choix ? oui mais doit il être blâmé ? Autant de faux problèmes dès que l'on veut généraliser!
nb= L'Alpinisme a une mortalité non négligeable.
https://www.tf1info.fr/justice-faits-di … 28456.html
Personnellement je rejoins la classification de l'OMS (mais elle même est assez floue et en cours de modification).
L'usage simple, qui n'est pas une maladie et donc n'a pas de code dans la classification des maladies.
Les usages problématiques, pour diverses raisons médicales, familiales, judiciaires
L'addiction qui définit un trouble, partiel ou envahissant, du contrôle de la consommation.
Une personne (PUD) peut se définir elle même selon cette classification, mais pas "les toxicomanes".
Et ce dont la Personne a besoin lui est propre .
Amicalement
Dernière modification par prescripteur (17 janvier 2023 à 13:20)
S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Devise Shadok (et stoicienne)
Hors ligne

- prescripteur

- Modérateur
- Inscrit le 22 Feb 2008
- 12198 messages
- Blogs
https://nida.nih.gov/about-nida/noras-b … -addiction
Le blog de Nora
S'attaquer à la stigmatisation qui entoure la dépendance
22 avril 2020
Par le Dr. Nora Volkow
La consommation de drogues et d'alcool non traitées contribue à des dizaines de milliers de décès chaque année et a un impact sur la vie de beaucoup d'autres. Les soins de santé disposent déjà d'outils efficaces, notamment de médicaments pour les troubles liés à la consommation d'opiacés et d'alcool qui pourraient prévenir nombre de ces décès, mais ils ne sont pas suffisamment utilisés, et de nombreuses personnes qui pourraient en bénéficier ne les recherchent même pas. Une raison importante est la stigmatisation qui entoure les personnes dépendantes.
Image
Person in shadows sitting on curb
Source : Pixabay.com/CC0
La stigmatisation est un problème lié à des problèmes de santé allant du cancer et du VIH à de nombreuses maladies mentales. Certains progrès ont été réalisés en réduisant la stigmatisation autour de certaines conditions; l'éducation du public et l'utilisation généralisée de médicaments efficaces ont démystifié la dépression, par exemple, ce qui en fait un peu moins tabou aujourd'hui qu'il ne l'était dans les générations précédentes. Mais peu de progrès ont été réalisés dans l'élimination de la stigmatisation entourant les troubles liés à la consommation de substances. Les personnes dépendantes continuent d'être blâmées pour leur maladie. Même si la médecine est parvenue il y a longtemps à un consensus sur le fait que la dépendance est un trouble cérébral complexe avec des composantes comportementales, le public et même beaucoup dans les soins de santé et le système judiciaire continuent à le considérer comme une conséquence de la faiblesse morale et du caractère imparfait.
La stigmatisation des prestataires de soins de santé qui considèrent tacitement le problème de la drogue ou de l'alcool d'un patient comme leur propre faute conduit à des soins de qualité inférieure ou même à rejeter les personnes demandant un traitement. Les personnes présentant des signes d'intoxication ou de symptômes de sevrage sont parfois expulsées des urgences par le personnel craignant leur comportement ou en supposant qu'elles ne cherchent que des médicaments. Les personnes dépendantes intériorisent cette stigmatisation, ressentent la honte et refusent de se faire soigner.
Dans une perspective, j'ai récemment publié dans The New England Journal of Medicine
, je raconte l'histoire d'un homme que j'ai rencontré qui s'injectait de l'héroine à sa jambe dans une « galerie de tir » - un site d'injection de fortune - à San Juan, Porto Rico, lors d'une visite il y a plusieurs années. Sa jambe a été gravement infectée, et je l'ai exhorté à visiter une salle d'urgence, mais il a refusé. Il avait été traité horriblement en occasions, si préférait risquer sa vie, ou l'amputation probable, à la perspective de répéter son humiliation.
Cela met en évidence une dimension de stigmatisation qui a été moins remarquée dans la littérature et qui est particulièrement importante pour les personnes souffrant de troubles liés à l'usage de substances: au-delà de l'interdiction ou de la recherche de soins, la stigmatisation peut en fait renforcer ou rétablir l'usage de drogues, en jouant un rôle clé dans le cercle vicieux qui pousse les toxicomanes à continuer à consommer de la drogue.
Précédemment sur ce blog, j'ai mis en évidence la recherche de Marco Venniro au programme de recherche intramurale du NIDA, montrant que les rongeurs dépendant de l'héroine ou de la méthamphétamine choisissent toujours l'interaction sociale plutôt que l'auto-administration de la drogue, a eu le choix; mais lorsque le choix social est puni, les animaux reviennent à la drogue. C'est une découverte profonde, très probablement applicable aux humains, puisque nous sommes des êtres hautement sociaux. Certains d'entre nous réagissent aux châtiments sociaux et physiques en se tournant vers des substances pour soulager notre douleur. Le rejet humiliant subi par les personnes stigmatisées pour leur consommation de drogues constitue une lourde punition sociale, les conduisant à continuer et peut-être à intensifier leur consommation de drogue.
La stigmatisation des personnes souffrant de troubles liés à la consommation de substances pourrait être encore plus problématique dans la crise actuelle de la COVID-19. En plus de leur plus grand risque par le fait que le sans-abri et la consommation de drogue lui-même, la peur légitime de la contagion peut signifier que les passants ou même les premiers intervenants seront réticents à administrer de la naloxone aux personnes qui ont fait une overdose. Et il existe un risque que les hôpitaux surtaxés passent de préférence sur ceux qui ont des problèmes de drogue évidents lorsqu'ils prennent des décisions difficiles sur l'endroit où diriger le personnel et les ressources qui en sauvent.
Il n'est pas facile d'atténuer la stigmatisation, en partie parce que le rejet des personnes atteintes de dépendance ou de maladie mentale est dû à des violations des normes sociales. Même les personnes en cours de soins de santé, si elles ne reçoivent pas d'entraînement pour s'occuper des personnes souffrant de troubles liés à l'usage de substances, peuvent être à la légère pour interagir avec quelqu'un qui agit de manière menaçante en raison du sevrage ou de certains effets de la drogue (par exemple, le PCP). Il est crucial que les personnes travaillant dans les soins de santé, du personnel des services d'urgence aux médecins, infirmières et assistants médicaux, soient formées à des soins avec compassion et compétence pour les personnes souffrant de troubles liés à la consommation de substances. Traiter les patients avec dignité et compassion est la première étape.
Il doit être reconnu plus largement que la susceptibilité aux changements dans le cerveau , liés à l'addictio, est considérablement influencée par des facteurs échappant au contrôle d'un individu, tels que la génétique ou l'environnement dans lequel on est né et élevé, et que les soins médicaux sont souvent nécessaires pour faciliter la guérison et éviter les pires résultats tels que le surdosage. Lorsque les personnes dépendantes sont stigmatisées et rejetées, en particulier par les personnes dans le secteur des soins de santé, cela ne contribue qu'au cercle vicieux qui enracine leur maladie.
Voir aussi - Words Matter - Termes à utiliser et à éviter lorsqu'il s'agit de parler d'addiction
Image
Dr. Nora Volkow reviewing the NIDA Website
Dr. Nora Volkow, Directrice
Ici, je souligne un travail important accompli chez NIDA et d'autres informations relatives à la science de la consommation de drogues et de la toxicomanie.
S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Devise Shadok (et stoicienne)
Hors ligne
prescripteur a écrit
Une autre femme formidable ! Il y a vraiment beaucoup de femmes chez les soignant.e.s. compréhensifs. Messieurs ?? Amicalement
Nora Volkof considère l'addiction comme une maladie du cerveau... C'est pas vbraiment notre cas, et je trouve que le 1er article le démonte tres bien.
J'attends d'avoir lu le 1ere article plusieurs fois avant de faire une réponse, mais deja la dénonciation de la stigmatisation des drogués me plait.
De meme son discours rejoint beaucoup notre discours tonique sur le dispositif addicto actuel, orienté soit vers la maladie de la dépendance, soit vers le modèle morale de la dépendance (que nous appelons d’ailleurs le discours dominant sur l'abstinence)
J'aime comme il défonce le modéle de la maladie de la dépendance : J'aime la note de bas de page : La recherche suggère que cela n’aide pas à promouvoir le rétablissement : la croyance en un modèle de maladie de l’alcoolisme est corrélée à la probabilité de rechute six mois après le traitement.
Après il ne parle pas de RDR ni de gestion, c'est dépendance ou abstinence dans son schéma, et cela me gène. Il ne s'interroge pas si on peut vivre avec une addiction, et si ce ne peut pas etre normal.
Hors ligne

- prescripteur

- Modérateur
- Inscrit le 22 Feb 2008
- 12198 messages
- Blogs
Mais son plaidoyer pour la destigmatisation de la part des soignants est courageux, vu son positionnement institutionnel. Amicalement
Dernière modification par prescripteur (18 janvier 2023 à 09:04)
S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Devise Shadok (et stoicienne)
Hors ligne
- Échec Scolaire

- Nouveau Psycho
- Inscrit le 13 Feb 2022
- 112 messages
pierre a écrit
Après il ne parle pas de RDR ni de gestion, c'est dépendance ou abstinence dans son schéma, et cela me gène. Il ne s'interroge pas si on peut vivre avec une addiction, et si ce ne peut pas etre normal.
Bonjour Pierre,
En matière de drogues, vouloir définir ce qui est ”normal” ou non, ça serait loucher du côté d’une norme donc d’une morale, de quelque façon que l’on se place.
”Compréhensible” ou ”légitime” aurait fait l’affaire, ”normal” c'est plus dur à saisir. Mais passons.
Pour les auteurs, la prise de drogues n'est ni un choix ni une maladie, mais plutôt un instrument (c’est un positionnement complexe, voir ”la drogue comme instrument”).
Un résumé rapide sur l’instrumentalisation:
”Les substances psychoactives ayant un potentiel de dépendance sont largement utilisées par des personnes de pratiquement toutes les cultures de manière non addictive. Pour comprendre ce comportement, sa pénétration dans la population et sa persistance, l’instrumentalisation des drogues a été proposée comme moteur de cette consommation. Un petit pourcentage de personnes qui instrumentalisent régulièrement des drogues psychoactives font une transition vers la dépendance, qui commence souvent par des changements qualitatifs et quantitatifs dans les objectifs d’instrumentalisation. Ainsi, il est proposé que l’addiction se développe à partir d’une instrumentalisation des drogues préalablement établie à long terme. ” En vrai, ça fait bien 10 pages, ici c'est juste la conclusion de tout l’article.
De plus, la personne est philosophe et son sujet n’est pas la RdR mais plutôt la stigmatisation (entre autres) , elle parle peu de RdR, personne n'est parfait.
Pour finir, nous connaissons la différence entre dépendance et addiction. Si l’addiction est une perte de contrôle du niveau de consommation entraînant des troubles d’ordre médical, des perturbations de la vie personnelle, professionnelle et sociale, alors l’addiction n'est pas souhaitable.
Compte tenu de cette définition et quant à savoir si l’on peut aisément vivre avec, la réponse est clairement non.
C'est différent pour ce qui concerne l’usage simple ou même la dépendance (ex: TSO), ces mots n’ont ni le même sens ni les mêmes implications, tu sais tout ça.
Dernière modification par Échec Scolaire (18 janvier 2023 à 11:57)
Hors ligne
Échec Scolaire a écrit
Si l’addiction est une perte de contrôle du niveau de consommation entraînant des troubles d’ordre médical, des perturbations de la vie personnelle, professionnelle et sociale, alors l’addiction n'est pas souhaitable.
Le problème avec cette définition de l'addiction, c'est qu'on oublie les bénéfices qu'il peut y avoir.
Car ce n'est pas parce il y a une perte de controle... qu'il n'y a pas de des bénéfices à cotés. Cf le tabac et les bénéfices pour la sociabilité : les personnes qui souhaite continuer leur dépendance au tabac malgres les risques pour la santé. J'en connais à la pelle. Ce n'est pas noir ou blanc. Et c'est la même avec toutes les drogues.
De meme il y a un gradient dans la perte de contrôle...
Hors ligne
- Yero

- Nouveau Psycho

- Inscrit le 17 Feb 2020
- 72 messages
Plutôt hyper intéressant cet article, responsable et respecté, deux valeurs qui paraissent de loin si évidente pour qui que ce soit, c'est même dingue de devoir les répéter.
Dernière modification par Yero (18 janvier 2023 à 22:42)
Hors ligne
- Psychoactif
- » Forums
- » Stigmatisations et discriminations des Personnes Utilisatrices de Drogues
- » Addiction: responsabilité sans blâme.
1
 1
1 0
0 0
0
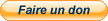 Soutenez PsychoACTIF
Soutenez PsychoACTIF