La poussière. Acte III : "Un doigt dans le cul et c'est fini".
La poussière. Acte III : « Un doigt dans le cul et c'est fini ».
Jeudi. 6h. Comme à l'accoutumée depuis trois jours, je me lève pour aller pisser. Ce matin Enrique n'est plus là , j'en serais presque attristée si ce n'était pas un affreux cafard avec pour manie de vaquer à sa vie de cafard sur les affaires de toilette de la voisine...
On toque à la porte de la chambre : « On vient changer votre couche ! ». Celle de la vieille voisine bien sûr. Je décide que sous aucun prétexte je ne dois voir ça et je reste dans les toilettes durant les longues minutes de l'opération. Maintenant que j'y repense, le tout premier matin aussi les aides soignantes ont débarqué dans la chambre pour changer la couche de la voisine... Je me rappelle m'être instinctivement enfouie sous ma couette pour rater tout du spectacle...
Je suis donc dans les toilettes à attendre qu'on change la couche de Madame D., 96 ans. Elle m'avait raconté un peu sa vie, jurant à tout bout de champs avoir encore toute sa tête. Elle était née en plein durant la Première guerre mondiale, avait connu la Seconde, élevé sa fille seule à vingt ans en temps de guerre, son mari avait été fait prisonnier six ans dans un camp en Allemagne. Elle m'avait récité son numéro d'écrou : elle n'avait jamais pu l'oublier. Elle avait perdu son fils. Elle avait survécu à un cancer du sein, elle avait perdu son mari, elle avait Parkinson depuis une dizaine d'année. Et surtout, elle attendait que sa fille vienne lui rende visite tandis que celle-ci ne venait que rarement.
Elle était donc terrée seule à l'hôpital. Accro à ses médocs pour dormir, elle avait fait une crise la veille au soir : « Où est mon Stilnox ! Où est mon Stilnox ! Vous ne m'avez pas donné mon Stilnox ! ».
Elle me répétait sans cesse qu'elle devait aller dans un service de réeducation, le « SSR » : « Ils vont m'y redonner mes vingt ans ! ».
J'étais partagée au sujet de Madame D. entre deux sentiments très contradictoires : d'un côté elle me touchait, et j'éprouvais de la compassion pour cette petite vieille dame qui avait tout vécu, et de l'autre je n'en pouvais plus de la voir déprimer et j'en venais à ne plus la supporter. A vingt ans comment peut-on appréhender quelqu'un si près de la mort et léthargique ? Elle me renvoyait à moi même et ça me perturbait plus que tout.
Elle était là à cause des maladies de l'âge, j'étais là à cause de mes conneries. Elle cherchait plus que tout ses vingt ans, je les brûlait comme s'ils n'avaient aucune importance. Elle avait « tout » vécu, je n'avais rien connu. Et pourtant, j'arrivais à en être là , dans la même chambre d'hôpital, à déprimer autant qu'elle.
15h30. Madame D. est transférée dans son fameux « SSR » qui « allait lui redonner ses vingt ans ».
Cette phrase ne m'a pas quitté. NB pour plus tard : Profiter de sa jeunesse.
Une remplaçante arrive. Autre spécimen. Une jeune musulmane voilée, qui ne fume pas, ne boit pas. L'intimité étant une donnée absente à l'hôpital, j'apprends rapidement qu'elle est diabétique, qu'elle est là pour une fibroscopie, qu'elle est divorcée, sans enfants. Bref, la voisine de chambre idéale d'une toxicomane là pour une infection : une fille droite et pieuse au possible.
Je prie de mon côté pour qu'elle ne me demande pas pourquoi je suis là , j'ai trop honte.
La journée continue, dans l'ennui profond. Je commence vraiment à n'en plus pouvoir d'être là . On me file deux antibios puissants le matin, le midi et le soir, c'est tout, et c'est tous les jours pareil. Mais ça va mieux, à tel point que je ne reste plus dans ma chambre. Dès que je peux, je descends fumer une clope en bas, non sans recueillir à chacune de mes absences les regards de travers des infirmières. Il fait un magnifique soleil, il fait chaud, mais qu'est-ce que je me fais chier comme un rat mort.
Je décide d'aller m'acheter des journaux avec les quelques sous que j'ai en poche. Je pars donc dans la rue à la recherche d'un kiosque. Ah, en voilà un, au pied d'une cité un peu glauque. Je jette un œil aux journaux : Le Monde ? Libération ? Le Figaro ? Tous aux abonnés absents... Par contre, je découvre « Le Monte », un journal satyrique sensé parodier l'original... Bon, ça commence bien pour se mettre à jour de l'actualité...
Voyons voir les magazines. Hum, tiens, mais je reconnais cette couverture de Tecknikart : avec Julian Assange, je l'ai déjà lu... Mais c'était y'a hyper longtemps ! Je regarde alors la date sur la couverture... Ah, en effet, c'est le numéro de mars 2011... On est en mai 2012, mais c'est pas grave, disons que c'est juste un « oubli » pendant 14 mois en plein milieu du rayon...
Je suis manifestement tombée dans le kiosque à journaux le plus actuel et « à la page » de la région parisienne. Je repars finalement avec Le Monde diplomatique, Courrier international et Les Inrocks. Il faut bien s'occuper l'esprit.
La journée se termine, aussi lente et interminable que les précédentes. A la nuance près que je suis en train de craquer, j'en ai marre, je n'en peux plus d'être ici. A ne rien faire de la journée à part attendre le lendemain. A bouffer de la merde micro-ondée pleine d'eau. Même l'odeur des draps m'est insupportable : cette odeur d'alcool à 90 ° m'écœure. J'ai la nausée en permanence dans ce lit.
Je shoote allègrement le Sub que j'ai récupéré la veille. Des shoots minutieux de propreté, j'ai retenu la leçon...
Et puis la nuit. Enfin une journée de finie. Dormir.
Vendredi. 7h. Toc toc, on frappe à la porte. Prise de sang du matin. Je ne redoute pas les aiguilles mais plutôt mes veines... Je me demande bien où l'infirmière va pouvoir piquer. Elle commence par mettre le garrot, pensant illusoirement piquer dans le creux du bras, je la rappelle à l'ordre :
« Cette veine là ne marche plus.
Laquelle vous préférez alors ?
Heu.. »
Finalement, elle piquera dans la veine où j'avais fait le shoot foireux qui m'avait fait atterrir ici...
11h. Un groupe de trois médecins dont la chef de service débarquent dans la chambre. Ils sont là pour me poser des questions sur ma consommation de drogue. Grosse gène. Ma voisine voilée se redresse ostensiblement dans son lit pour ne rien manquer de notre entretien. Je le remarque et demande donc à la médecin de lui parler dans son bureau. « Ok, allons y, je vais nous trouver un endroit tranquille ».
Elle m'emmène dans les couloirs de l'hôpital et trouve un bureau vide où l'on peut s'installer. Elle me pose quelques questions, je lui réponds honnêtement, c'est finalement la première fois que je parle à un médecin de ma consommation de drogue. Elle m'écoute, est plutôt gentille et réconfortante. Ce seront les seules minutes où j'aurais vu vraiment un médecin de tout le séjour.
Les jours précédents, on m'avait dit qu'un addictologue allait passer me voir. Il n'est jamais vu. « Il est très occupé, il n'a pas le temps ». Ah.
L'entretien se termine, la médecin me raccompagne. Petit détail que j'avais oublié : le sang dans les chiottes d'il y a deux jours... « Mon collègue va vous faire une rectoscopie, il semble que ce soit les antibios qui en sont la cause ».
Pardon ? Une quoi ? Un doigt, enfin, un rectoscope dans le cul ? Mais elle est folle. Au secours, sauvez-moi, je rêve ! Ceci n'est pas la réalité, ceci est un mauvais rêve. Je ne vais pas me faire ausculter le cul, tentais-je vainement de me persuader...
Son collègue arrive de nulle part, comme tapis dans l'ombre prêt à dégainer son rectoscope : « Vous me suivez mademoiselle ? On va procéder à l'examen. »
…
Bon, restons calme, soufflons. Tout va bien, ce n'est qu'un acte médical comme les autres. Comme les uns se font ausculter la gorge, moi je me fais ausculter le cul... Oh merde, non ça ne me convainc pas DU TOUT.
« Mettez-vous à quatre patte sur la table d'auscultation s'il vous plaÎt mademoiselle ».
Plouf. Doigt dans le cul en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Suivi d'un rectoscope dans le cul. Agrémenté d'une dignité perdue, d'une humanité envolée. Si la honte tuait, elle m'aurait enterré sur place, avec une dalle en forme de rectoscope.
« Voilà , c'est fini. En fait, ce n'était qu'une irritation locale du fait de la diarrhée causée par les antibiotiques. Au revoir mademoiselle.
- Au revoir docteur ». Vous m'excuserez si je ne vous sers pas la main. Cordialement. Vite, fuir.
15h. Une psychiatre vient me voir. Elle me dit que la médecin que j'avais vu plus tôt dans la journée lui avait demandé de passer. Une infirmière est avec elle. Elle me font passer un entretien dont je n'arrive toujours pas à cerner si il s'agissait de m'aider tout simplement ou, comme je l'ai ressenti, de déceler chez moi une maladie mentale.
Elle commence en effet par insinuer lourdement que je suis une menteuse, puis enchaÎne sur des questions toutes plus infantilisantes et absurdes les unes que les autres avec un ton mielleux et hypocrite :
« Vous avez des amis ? » Aucuns, je les ai tous dépecés dans ma cave. Pourquoi ?
« Vous avez des problèmes d'hygiène » Aucuns. Je prends une douche par an, je cultive les bacilles de mycoses partout sur mon corps, pourquoi, pas vous ?
Et ainsi de suite de questions toutes plus stupides les unes que les autres, toutes ponctuées de jugements non dissimulés. Bref, la meuf n'a pas du tout envie de m'écouter. Elle fait son petit questionnaire et au bout de cinq minutes décide arbitrairement qu'il me faut du Xanax. Je refuse catégoriquement.
J'ai en tête la série Weeds, je ne sais plus quelle saison, où Célia Hodes est dans le tunnel clandestin entre le Mexique et les Etats-Unis et où elle est complètement shootée au Xanax, dans un état pitoyable. A chaque fois que la psychiatre prononce le mot Xanax, j'ai cette image en tête, comme un flash. Impossible que j'en prenne. Je refuse donc poliment son offre.
« Très bien, comme vous voulez, mais vous n'aurez rien d'autre pour passer le week-end. »
Pauvre meuf, avec ses chaussettes noires à pois verts et ses bouclettes dégueulasses, qui dégaine le carnet d'ordonnance en cinq minutes sans s'intéresser vraiment à la personne qui est en face. Je quitte la pièce sans lui dire au revoir tellement elle incarne l'archétype de la psychiatre vendue aux labo pharmaceutiques et qui n'en a rien à foutre des patients qu'elle rencontre...Précisément le genre de psy sans aucune humanité ou empathie que je redoutais pour un premier rendez-vous. Et bim, dans le mille.
Samedi. 9h. « Mademoiselle, vous sortez aujourd'hui ». Enfin. Quitter ces lieux, vite.
Une semaine plus tard, je reçois par la poste la facture... 989 euros. Je n'ai pas de mutuelle. Aïe, j'ai mal au cul. J'ai l'impression d'avoir servi de variable d'ajustement au remplissage des chambres d'hôpital... Passé les 2 ou 3 premiers jours, j'aurais pu rentrer chez moi avec une ordonnance, pas besoin de me garder inutilement... Apparemment pour voir un addictologue qui n'est jamais venu.
Résultat, la facture de cette "poussière" est salée. Je l'ai dans le cul, c'est le cas de le dire.
Jeudi. 6h. Comme à l'accoutumée depuis trois jours, je me lève pour aller pisser. Ce matin Enrique n'est plus là , j'en serais presque attristée si ce n'était pas un affreux cafard avec pour manie de vaquer à sa vie de cafard sur les affaires de toilette de la voisine...
On toque à la porte de la chambre : « On vient changer votre couche ! ». Celle de la vieille voisine bien sûr. Je décide que sous aucun prétexte je ne dois voir ça et je reste dans les toilettes durant les longues minutes de l'opération. Maintenant que j'y repense, le tout premier matin aussi les aides soignantes ont débarqué dans la chambre pour changer la couche de la voisine... Je me rappelle m'être instinctivement enfouie sous ma couette pour rater tout du spectacle...
Je suis donc dans les toilettes à attendre qu'on change la couche de Madame D., 96 ans. Elle m'avait raconté un peu sa vie, jurant à tout bout de champs avoir encore toute sa tête. Elle était née en plein durant la Première guerre mondiale, avait connu la Seconde, élevé sa fille seule à vingt ans en temps de guerre, son mari avait été fait prisonnier six ans dans un camp en Allemagne. Elle m'avait récité son numéro d'écrou : elle n'avait jamais pu l'oublier. Elle avait perdu son fils. Elle avait survécu à un cancer du sein, elle avait perdu son mari, elle avait Parkinson depuis une dizaine d'année. Et surtout, elle attendait que sa fille vienne lui rende visite tandis que celle-ci ne venait que rarement.
Elle était donc terrée seule à l'hôpital. Accro à ses médocs pour dormir, elle avait fait une crise la veille au soir : « Où est mon Stilnox ! Où est mon Stilnox ! Vous ne m'avez pas donné mon Stilnox ! ».
Elle me répétait sans cesse qu'elle devait aller dans un service de réeducation, le « SSR » : « Ils vont m'y redonner mes vingt ans ! ».
J'étais partagée au sujet de Madame D. entre deux sentiments très contradictoires : d'un côté elle me touchait, et j'éprouvais de la compassion pour cette petite vieille dame qui avait tout vécu, et de l'autre je n'en pouvais plus de la voir déprimer et j'en venais à ne plus la supporter. A vingt ans comment peut-on appréhender quelqu'un si près de la mort et léthargique ? Elle me renvoyait à moi même et ça me perturbait plus que tout.
Elle était là à cause des maladies de l'âge, j'étais là à cause de mes conneries. Elle cherchait plus que tout ses vingt ans, je les brûlait comme s'ils n'avaient aucune importance. Elle avait « tout » vécu, je n'avais rien connu. Et pourtant, j'arrivais à en être là , dans la même chambre d'hôpital, à déprimer autant qu'elle.
15h30. Madame D. est transférée dans son fameux « SSR » qui « allait lui redonner ses vingt ans ».
Cette phrase ne m'a pas quitté. NB pour plus tard : Profiter de sa jeunesse.
Une remplaçante arrive. Autre spécimen. Une jeune musulmane voilée, qui ne fume pas, ne boit pas. L'intimité étant une donnée absente à l'hôpital, j'apprends rapidement qu'elle est diabétique, qu'elle est là pour une fibroscopie, qu'elle est divorcée, sans enfants. Bref, la voisine de chambre idéale d'une toxicomane là pour une infection : une fille droite et pieuse au possible.
Je prie de mon côté pour qu'elle ne me demande pas pourquoi je suis là , j'ai trop honte.
La journée continue, dans l'ennui profond. Je commence vraiment à n'en plus pouvoir d'être là . On me file deux antibios puissants le matin, le midi et le soir, c'est tout, et c'est tous les jours pareil. Mais ça va mieux, à tel point que je ne reste plus dans ma chambre. Dès que je peux, je descends fumer une clope en bas, non sans recueillir à chacune de mes absences les regards de travers des infirmières. Il fait un magnifique soleil, il fait chaud, mais qu'est-ce que je me fais chier comme un rat mort.
Je décide d'aller m'acheter des journaux avec les quelques sous que j'ai en poche. Je pars donc dans la rue à la recherche d'un kiosque. Ah, en voilà un, au pied d'une cité un peu glauque. Je jette un œil aux journaux : Le Monde ? Libération ? Le Figaro ? Tous aux abonnés absents... Par contre, je découvre « Le Monte », un journal satyrique sensé parodier l'original... Bon, ça commence bien pour se mettre à jour de l'actualité...
Voyons voir les magazines. Hum, tiens, mais je reconnais cette couverture de Tecknikart : avec Julian Assange, je l'ai déjà lu... Mais c'était y'a hyper longtemps ! Je regarde alors la date sur la couverture... Ah, en effet, c'est le numéro de mars 2011... On est en mai 2012, mais c'est pas grave, disons que c'est juste un « oubli » pendant 14 mois en plein milieu du rayon...
Je suis manifestement tombée dans le kiosque à journaux le plus actuel et « à la page » de la région parisienne. Je repars finalement avec Le Monde diplomatique, Courrier international et Les Inrocks. Il faut bien s'occuper l'esprit.
La journée se termine, aussi lente et interminable que les précédentes. A la nuance près que je suis en train de craquer, j'en ai marre, je n'en peux plus d'être ici. A ne rien faire de la journée à part attendre le lendemain. A bouffer de la merde micro-ondée pleine d'eau. Même l'odeur des draps m'est insupportable : cette odeur d'alcool à 90 ° m'écœure. J'ai la nausée en permanence dans ce lit.
Je shoote allègrement le Sub que j'ai récupéré la veille. Des shoots minutieux de propreté, j'ai retenu la leçon...
Et puis la nuit. Enfin une journée de finie. Dormir.
Vendredi. 7h. Toc toc, on frappe à la porte. Prise de sang du matin. Je ne redoute pas les aiguilles mais plutôt mes veines... Je me demande bien où l'infirmière va pouvoir piquer. Elle commence par mettre le garrot, pensant illusoirement piquer dans le creux du bras, je la rappelle à l'ordre :
« Cette veine là ne marche plus.
Laquelle vous préférez alors ?
Heu.. »
Finalement, elle piquera dans la veine où j'avais fait le shoot foireux qui m'avait fait atterrir ici...
11h. Un groupe de trois médecins dont la chef de service débarquent dans la chambre. Ils sont là pour me poser des questions sur ma consommation de drogue. Grosse gène. Ma voisine voilée se redresse ostensiblement dans son lit pour ne rien manquer de notre entretien. Je le remarque et demande donc à la médecin de lui parler dans son bureau. « Ok, allons y, je vais nous trouver un endroit tranquille ».
Elle m'emmène dans les couloirs de l'hôpital et trouve un bureau vide où l'on peut s'installer. Elle me pose quelques questions, je lui réponds honnêtement, c'est finalement la première fois que je parle à un médecin de ma consommation de drogue. Elle m'écoute, est plutôt gentille et réconfortante. Ce seront les seules minutes où j'aurais vu vraiment un médecin de tout le séjour.
Les jours précédents, on m'avait dit qu'un addictologue allait passer me voir. Il n'est jamais vu. « Il est très occupé, il n'a pas le temps ». Ah.
L'entretien se termine, la médecin me raccompagne. Petit détail que j'avais oublié : le sang dans les chiottes d'il y a deux jours... « Mon collègue va vous faire une rectoscopie, il semble que ce soit les antibios qui en sont la cause ».
Pardon ? Une quoi ? Un doigt, enfin, un rectoscope dans le cul ? Mais elle est folle. Au secours, sauvez-moi, je rêve ! Ceci n'est pas la réalité, ceci est un mauvais rêve. Je ne vais pas me faire ausculter le cul, tentais-je vainement de me persuader...
Son collègue arrive de nulle part, comme tapis dans l'ombre prêt à dégainer son rectoscope : « Vous me suivez mademoiselle ? On va procéder à l'examen. »
…
Bon, restons calme, soufflons. Tout va bien, ce n'est qu'un acte médical comme les autres. Comme les uns se font ausculter la gorge, moi je me fais ausculter le cul... Oh merde, non ça ne me convainc pas DU TOUT.
« Mettez-vous à quatre patte sur la table d'auscultation s'il vous plaÎt mademoiselle ».
Plouf. Doigt dans le cul en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Suivi d'un rectoscope dans le cul. Agrémenté d'une dignité perdue, d'une humanité envolée. Si la honte tuait, elle m'aurait enterré sur place, avec une dalle en forme de rectoscope.
« Voilà , c'est fini. En fait, ce n'était qu'une irritation locale du fait de la diarrhée causée par les antibiotiques. Au revoir mademoiselle.
- Au revoir docteur ». Vous m'excuserez si je ne vous sers pas la main. Cordialement. Vite, fuir.
15h. Une psychiatre vient me voir. Elle me dit que la médecin que j'avais vu plus tôt dans la journée lui avait demandé de passer. Une infirmière est avec elle. Elle me font passer un entretien dont je n'arrive toujours pas à cerner si il s'agissait de m'aider tout simplement ou, comme je l'ai ressenti, de déceler chez moi une maladie mentale.
Elle commence en effet par insinuer lourdement que je suis une menteuse, puis enchaÎne sur des questions toutes plus infantilisantes et absurdes les unes que les autres avec un ton mielleux et hypocrite :
« Vous avez des amis ? » Aucuns, je les ai tous dépecés dans ma cave. Pourquoi ?
« Vous avez des problèmes d'hygiène » Aucuns. Je prends une douche par an, je cultive les bacilles de mycoses partout sur mon corps, pourquoi, pas vous ?
Et ainsi de suite de questions toutes plus stupides les unes que les autres, toutes ponctuées de jugements non dissimulés. Bref, la meuf n'a pas du tout envie de m'écouter. Elle fait son petit questionnaire et au bout de cinq minutes décide arbitrairement qu'il me faut du Xanax. Je refuse catégoriquement.
J'ai en tête la série Weeds, je ne sais plus quelle saison, où Célia Hodes est dans le tunnel clandestin entre le Mexique et les Etats-Unis et où elle est complètement shootée au Xanax, dans un état pitoyable. A chaque fois que la psychiatre prononce le mot Xanax, j'ai cette image en tête, comme un flash. Impossible que j'en prenne. Je refuse donc poliment son offre.
« Très bien, comme vous voulez, mais vous n'aurez rien d'autre pour passer le week-end. »
Pauvre meuf, avec ses chaussettes noires à pois verts et ses bouclettes dégueulasses, qui dégaine le carnet d'ordonnance en cinq minutes sans s'intéresser vraiment à la personne qui est en face. Je quitte la pièce sans lui dire au revoir tellement elle incarne l'archétype de la psychiatre vendue aux labo pharmaceutiques et qui n'en a rien à foutre des patients qu'elle rencontre...Précisément le genre de psy sans aucune humanité ou empathie que je redoutais pour un premier rendez-vous. Et bim, dans le mille.
Samedi. 9h. « Mademoiselle, vous sortez aujourd'hui ». Enfin. Quitter ces lieux, vite.
Une semaine plus tard, je reçois par la poste la facture... 989 euros. Je n'ai pas de mutuelle. Aïe, j'ai mal au cul. J'ai l'impression d'avoir servi de variable d'ajustement au remplissage des chambres d'hôpital... Passé les 2 ou 3 premiers jours, j'aurais pu rentrer chez moi avec une ordonnance, pas besoin de me garder inutilement... Apparemment pour voir un addictologue qui n'est jamais venu.
Résultat, la facture de cette "poussière" est salée. Je l'ai dans le cul, c'est le cas de le dire.
Catégorie : Témoignages - 29 décembre 2013 à 07:55
Commentaires
1
#1 Posté par : LLoigor 29 décembre 2013 à 09:10
Et bien encore bien écrit :)
Ton passage avec la psychiatre me rappelle pourquoi je n'aime pas les psychiatre, toujours a poser leurs questions issue d'une sorte de "grand livre qui dit si tu est normal ou pas".
(lors d'une de mes mésaventure avec un psychiatre, il me l'avais même montré d’où il sortais ces questions ...Afin d'appuyer son propos "vous voyez ça montre bien que ..." et pour encore plus me convaincre qu'il fallait que j'essaye son traitement, traitement qui me coutera un mois de cécité sur un œil et des migraines, sans parler de la peur que cela engendre ... bref racontais > ici < )
Par contre j'avais pas capté, mais en fait ton histoire c'est passé l'an dernier, du coup j'imagine que tu n'as pas écrits cela "d'une traite" ?
En tout cas, pour l'avoir fait (et avoir hélas arrêté de le faire), je conseille vraiment au gens d'écrire leurs péripéties (bonnes ou mauvaises), car perso quand je relis mes écrits d'il y a 10 ans, cette remontée de nostalgie (qui a quand même un coté mélancolique), m'aide a me souvenir de certaines choses et surtout des détails que j'avais complètement oublié.
(je dois avoir quelques dizaines de pages, racontant ma progression dans les freeparty et tout ce qui va avec, bon y a beaucoup de pages, mais c'est du "one shot" du coup, bref ... Ceci dit quand j'y jette un œil parfois, cela a au moins le mérite de m'arracher un rictus ^^)
Après il faut avoir un peu de talent pour le rendre appréciable, et tu en as incontestablement
LLoigor
Ton passage avec la psychiatre me rappelle pourquoi je n'aime pas les psychiatre, toujours a poser leurs questions issue d'une sorte de "grand livre qui dit si tu est normal ou pas".
(lors d'une de mes mésaventure avec un psychiatre, il me l'avais même montré d’où il sortais ces questions ...Afin d'appuyer son propos "vous voyez ça montre bien que ..." et pour encore plus me convaincre qu'il fallait que j'essaye son traitement, traitement qui me coutera un mois de cécité sur un œil et des migraines, sans parler de la peur que cela engendre ... bref racontais > ici < )
Par contre j'avais pas capté, mais en fait ton histoire c'est passé l'an dernier, du coup j'imagine que tu n'as pas écrits cela "d'une traite" ?
En tout cas, pour l'avoir fait (et avoir hélas arrêté de le faire), je conseille vraiment au gens d'écrire leurs péripéties (bonnes ou mauvaises), car perso quand je relis mes écrits d'il y a 10 ans, cette remontée de nostalgie (qui a quand même un coté mélancolique), m'aide a me souvenir de certaines choses et surtout des détails que j'avais complètement oublié.
(je dois avoir quelques dizaines de pages, racontant ma progression dans les freeparty et tout ce qui va avec, bon y a beaucoup de pages, mais c'est du "one shot" du coup, bref ... Ceci dit quand j'y jette un œil parfois, cela a au moins le mérite de m'arracher un rictus ^^)
Après il faut avoir un peu de talent pour le rendre appréciable, et tu en as incontestablement

LLoigor

#2 Posté par : Bicicle 29 décembre 2013 à 09:39
Merci de ton com Lloigor, oui ça date de mai 2012, j'avais écrit le texte alors que j'étais encore à l'hosto tellement j'en pouvais plus, mais je l'ai pas publié car c'était encore trop frais et surtout hyper long (l'original faisait genre 8 pages d'ordi).
Et puis là j'ai retrouvé le texte par hasard et j'ai décidé de le réecrire pour le rendre plus lisible et publiable.
C'est vrai que c'est toujours sympa de relire nos expériences passées car on oublie avec le temps, et y'en a qui méritent d'être retenues !
Et puis là j'ai retrouvé le texte par hasard et j'ai décidé de le réecrire pour le rendre plus lisible et publiable.
C'est vrai que c'est toujours sympa de relire nos expériences passées car on oublie avec le temps, et y'en a qui méritent d'être retenues !
#3 Posté par : Disturb 29 décembre 2013 à 18:20
salut Bicicle ,
pas grand chose à ajouter , j'étais dans la chambre avec toi...!
le paragraphe que je retiens et que je trouve énorme :
"Elle était là à cause des maladies de l'âge, j'étais là à cause de mes conneries. Elle cherchait plus que tout ses vingt ans, je les brûlait comme s'ils n'avaient aucune importance. Elle avait « tout » vécu, je n'avais rien connu. Et pourtant, j'arrivais à en être là , dans la même chambre d'hôpital, à déprimer autant qu'elle. "
Tu as vraiment l'art et la manière d'écrire des trucs à la fois intelligents et fluides
Au plaisir de continuer à lire le récit de tes "aventures"
bonne soirée
Dstrb
pas grand chose à ajouter , j'étais dans la chambre avec toi...!
le paragraphe que je retiens et que je trouve énorme :
"Elle était là à cause des maladies de l'âge, j'étais là à cause de mes conneries. Elle cherchait plus que tout ses vingt ans, je les brûlait comme s'ils n'avaient aucune importance. Elle avait « tout » vécu, je n'avais rien connu. Et pourtant, j'arrivais à en être là , dans la même chambre d'hôpital, à déprimer autant qu'elle. "
Tu as vraiment l'art et la manière d'écrire des trucs à la fois intelligents et fluides

Au plaisir de continuer à lire le récit de tes "aventures"

bonne soirée
Dstrb
#4 Posté par : omertà 30 décembre 2013 à 09:22
bien écrit bicicle..et bon courage pour ta vie futur..
#5 Posté par : virtualfacto 30 décembre 2013 à 18:16
"un 38 tonnes sur une route départementale", c'est à ca que m'a fait penser ton "expérience anale"!!!
Salut Bicicle!
dure vie de toxicomane, n'est ce pas! on oublie trop tous ces à côtés qui viennent agrémenter notre parcours de vie.
Et tellement de similitudes dans les cas lorsque je lis les posts de psychoA. Moi, j'ai eu droit à une fibro: imagine le doigt...d'E.T. qui téléphone maison, mais le téléphone se trouve au fond de mes intestins!!! c'est sympa aussi.
Comme on te le dit souvent, tu as l'art de raconter les choses, et ca fait plaisir de lire de telles péripéties sur ce ton là . Au delà , bien sûr, de l'aspect difficile de cet état de fait!!
Tu donnes l'impression de garder une certaine pêche et un certain recul sur la condition d'UD, et c'est vraiment rare.
Take care...
Salut Bicicle!
dure vie de toxicomane, n'est ce pas! on oublie trop tous ces à côtés qui viennent agrémenter notre parcours de vie.
Et tellement de similitudes dans les cas lorsque je lis les posts de psychoA. Moi, j'ai eu droit à une fibro: imagine le doigt...d'E.T. qui téléphone maison, mais le téléphone se trouve au fond de mes intestins!!! c'est sympa aussi.
Comme on te le dit souvent, tu as l'art de raconter les choses, et ca fait plaisir de lire de telles péripéties sur ce ton là . Au delà , bien sûr, de l'aspect difficile de cet état de fait!!
Tu donnes l'impression de garder une certaine pêche et un certain recul sur la condition d'UD, et c'est vraiment rare.
Take care...
#6 Posté par : Fabrice 30 décembre 2013 à 21:01
Les filtres et cotons imbibés d'eau et particules présentent la faune idéale au développement rapide de micro-organismes comme les bactéries.
Cette histoire vécue est très utile pour la RDR en rappelant qu'il faut toujours jeter dans les collecteurs dédiés son kit stéribox après usage unique et ne surtout pas ré-employer du matériel usagé au risque d'avoir une septicémie foudroyante et vivre le triste séjour hospitalier talentueusement narré par Bicicle.
Bicicle la facture est salée! J'espère que tu as une bonne mutuelle ou bien une cmu et/ou complémentaire.
Bonne fête de fin d'année.
ps tu écris bien, tes textes sont agréables à lire.
Cette histoire vécue est très utile pour la RDR en rappelant qu'il faut toujours jeter dans les collecteurs dédiés son kit stéribox après usage unique et ne surtout pas ré-employer du matériel usagé au risque d'avoir une septicémie foudroyante et vivre le triste séjour hospitalier talentueusement narré par Bicicle.
Bicicle la facture est salée! J'espère que tu as une bonne mutuelle ou bien une cmu et/ou complémentaire.
Bonne fête de fin d'année.
ps tu écris bien, tes textes sont agréables à lire.
#7 Posté par : ziggy 02 janvier 2014 à 23:06
whooaa !! enfin l'acte 3 ... reste plus qu'à trouver le prochain thème ? Une idée pour la suite ? :) On en veux encore encore un ! :) Merci pour ces textes plein d'un petit truc irrésistible... bonne année !
#8 Posté par : Ize 10 janvier 2014 à 12:22
Salut Bicicle,
Franchement, t'es douée pour l'écriture, toi! Tu racontes tes (més)aventures d'une telle façon qu'on s'y croirait, et avec humour en prime....
Ton histoire me rappelle ma "première rencontre" avec le monde de la drogue:
J'étais en stage en réanimation, un mec nous est ramené des urgences, la trentaine, plutôt beau gosse. Embolie pulmonaire et abcès à force de se shooter dans l'artère fémorale. Héroïnomane.
Première réaction de l'équipe: "Ah non, pas encore un! Il va encore nous saouler".
Naïvement, je demande pourquoi. "Ben c'est parce qu'il est tox, ils sont tous comme ça.".
Pour ma part, je suis pas du genre à avoir des préjugés, et comme je dois lui apporter ses médocs, j'en profite pour papoter avec lui. Il me demande son sac, je lui donne, puis je sors de la chambre.
Et là , panique à bord, l'équipe m'engueule: "Mais pourquoi tu lui as donné son sac!! Il était à deux doigts de se piquer!! Il avait sorti son citron et sa drogue!!". Je ne comprends rien, je bafouille que je croyais qu'on l'avait fouillé, que je ne savais pas à quoi servait du citron dans ce cas ci, etc, etc.
Tremblante, je retourne dans sa chambre, et lui demande pourquoi il a fait ça, qu'en plus je viens de me faire taper sur les doigts. Il me répond que le médecin qui doit lui prescrire son produit de substitution ne voulait pas faire le trajet jusqu'à l'hôpital, que du coup il n'avait rien pour faire passer son manque, sauf son héroïne.
J'en parle à l'équipe, qui ne dit qu'elle ne peut rien faire.
Plus la journée avance, plus il est agité, plus on lui donne des cachetons "pour qu'il reste tranquille", et plus on lui parle mal.
Le lendemain matin, il avait pissé par terre, il était complètement shooté, il insultait l'équipe. Deux gros bras ont fait sa toilette intégrale au lit, rapidement, fermement, durement.
Ils ont fini par l'endormir, "Parce qu'on arrivera jamais à le soigner, sinon.".
Le lendemain, quand je suis passée dans sa chambre pour lui injecter ses médicament, il a entrouvert les yeux, m'a dit "Vous êtes gentille Mademoiselle. Vous avez de beaux yeux....", et est reparti dans les bras de Morphée.
J'ai ensuite été supervisée par ma prof de stage pour faire sa toilette intégrale (l'équipe ne voulait plus le laver, donc on refile la tâche à la stagiaire, forcément) c'était la première fois que je lavais entièrement quelqu'un de si jeune. Il n'a même pas cillé dans son sommeil. J'ai essayé d'être la plus douce possible, de prendre soin de lui, c'est déjà un minimum dans ce monde de brutes.
J'ai fini mon stage avant qu'il ne soit réveillé de son sommeil artificiel.
Quelques semaines plus tard, je le croise dans la rue, il faisait la manche avec un vieil alcoolique. Je lui dis bonjour, il a l'impression de m'avoir déjà vu quelque part. Je lui répond discrètement "en réa!", le vieux me drague lourdement, mon "ex-patient" lui demande de dégager d'un ton sec, puis reprend le fil de notre conversation "ah oui... vous avez de beaux yeux....".
Nous nous sommes revus quelquefois fois dans la rue, on a parlé de tout, de rien, de la came, de ses progrès, de ses échecs, et j'ai donné mes premiers conseils en réduction des risques sans le savoir.
Voilà comment j'en suis venue à bosser en addicto. Parce que les gens ne sont pas assez informés, les gens ont peur, les gens ont des préjugés à la con, les gens sont fermés, les gens se croient supérieurs, les gens traitent les "toxicos" comme des bêtes. Et je trouve ça pitoyable, encore plus de nos jours, et encore plus pour des gens qui se disent "altruistes" et qui veulent "aider son prochain". Ah ben bravo, les gens.
Franchement, t'es douée pour l'écriture, toi! Tu racontes tes (més)aventures d'une telle façon qu'on s'y croirait, et avec humour en prime....
Ton histoire me rappelle ma "première rencontre" avec le monde de la drogue:
J'étais en stage en réanimation, un mec nous est ramené des urgences, la trentaine, plutôt beau gosse. Embolie pulmonaire et abcès à force de se shooter dans l'artère fémorale. Héroïnomane.
Première réaction de l'équipe: "Ah non, pas encore un! Il va encore nous saouler".
Naïvement, je demande pourquoi. "Ben c'est parce qu'il est tox, ils sont tous comme ça.".
Pour ma part, je suis pas du genre à avoir des préjugés, et comme je dois lui apporter ses médocs, j'en profite pour papoter avec lui. Il me demande son sac, je lui donne, puis je sors de la chambre.
Et là , panique à bord, l'équipe m'engueule: "Mais pourquoi tu lui as donné son sac!! Il était à deux doigts de se piquer!! Il avait sorti son citron et sa drogue!!". Je ne comprends rien, je bafouille que je croyais qu'on l'avait fouillé, que je ne savais pas à quoi servait du citron dans ce cas ci, etc, etc.
Tremblante, je retourne dans sa chambre, et lui demande pourquoi il a fait ça, qu'en plus je viens de me faire taper sur les doigts. Il me répond que le médecin qui doit lui prescrire son produit de substitution ne voulait pas faire le trajet jusqu'à l'hôpital, que du coup il n'avait rien pour faire passer son manque, sauf son héroïne.
J'en parle à l'équipe, qui ne dit qu'elle ne peut rien faire.
Plus la journée avance, plus il est agité, plus on lui donne des cachetons "pour qu'il reste tranquille", et plus on lui parle mal.
Le lendemain matin, il avait pissé par terre, il était complètement shooté, il insultait l'équipe. Deux gros bras ont fait sa toilette intégrale au lit, rapidement, fermement, durement.
Ils ont fini par l'endormir, "Parce qu'on arrivera jamais à le soigner, sinon.".
Le lendemain, quand je suis passée dans sa chambre pour lui injecter ses médicament, il a entrouvert les yeux, m'a dit "Vous êtes gentille Mademoiselle. Vous avez de beaux yeux....", et est reparti dans les bras de Morphée.
J'ai ensuite été supervisée par ma prof de stage pour faire sa toilette intégrale (l'équipe ne voulait plus le laver, donc on refile la tâche à la stagiaire, forcément) c'était la première fois que je lavais entièrement quelqu'un de si jeune. Il n'a même pas cillé dans son sommeil. J'ai essayé d'être la plus douce possible, de prendre soin de lui, c'est déjà un minimum dans ce monde de brutes.
J'ai fini mon stage avant qu'il ne soit réveillé de son sommeil artificiel.
Quelques semaines plus tard, je le croise dans la rue, il faisait la manche avec un vieil alcoolique. Je lui dis bonjour, il a l'impression de m'avoir déjà vu quelque part. Je lui répond discrètement "en réa!", le vieux me drague lourdement, mon "ex-patient" lui demande de dégager d'un ton sec, puis reprend le fil de notre conversation "ah oui... vous avez de beaux yeux....".
Nous nous sommes revus quelquefois fois dans la rue, on a parlé de tout, de rien, de la came, de ses progrès, de ses échecs, et j'ai donné mes premiers conseils en réduction des risques sans le savoir.
Voilà comment j'en suis venue à bosser en addicto. Parce que les gens ne sont pas assez informés, les gens ont peur, les gens ont des préjugés à la con, les gens sont fermés, les gens se croient supérieurs, les gens traitent les "toxicos" comme des bêtes. Et je trouve ça pitoyable, encore plus de nos jours, et encore plus pour des gens qui se disent "altruistes" et qui veulent "aider son prochain". Ah ben bravo, les gens.
#9 Posté par : Disturb 10 janvier 2014 à 15:14
Merci à toi Ize pour ce témoignage !
j'ai l'impression qu'une partie des personne de ta génération ( tu dois être encore assez " jeune " si je ne m'abuse ) prends de plus en plus conscience que les UD ( Usagers de Drogues ) et les toxicos sont des êtres humains avant tout ; et doivent être traités et respectés en tant que tels .
En espérant que beaucoup de gens suivent ton exemple
à bientôt
Dstrb
j'ai l'impression qu'une partie des personne de ta génération ( tu dois être encore assez " jeune " si je ne m'abuse ) prends de plus en plus conscience que les UD ( Usagers de Drogues ) et les toxicos sont des êtres humains avant tout ; et doivent être traités et respectés en tant que tels .
En espérant que beaucoup de gens suivent ton exemple
à bientôt
Dstrb
#10 Posté par : durban_poison 10 janvier 2014 à 15:55
bonjour Ize
Sa fais plaisir de te lire et de voir que tous le monde n'est pas fou. On à la même perception, j'imagine, sur la vie en société, la vie....
bien à toi.
Sa fais plaisir de te lire et de voir que tous le monde n'est pas fou. On à la même perception, j'imagine, sur la vie en société, la vie....
bien à toi.
#11 Posté par : durban_poison 10 janvier 2014 à 16:00
enfin tous le monde n'est pas fou, mais la plupart des gens son aveuglés, endormi... j'emploi plutôt le mot "victime ". Victime d'une société malsaine.
#12 Posté par : bardof 26 avril 2023 à 14:59
Presque 9 ans depuis que j'ai lu chaque article de ce blog sur mon smartphone dans un coffeeshop à rotterdam. Depuis, je viens 1x par an pour voir si tu en publies d'autres. Aujourd'hui, pour x et y raison, parce que ça fait des années que tu ne donnes plus signe de vie, j'ai décidé de créé un compte sur ce forum, juste pour t'écrire qu'il y a qq années, qqun a lu ton blog comme si c'était une série netflix...J'espère que tout va bien pour toi
#13 Posté par : meumeuh 26 avril 2023 à 17:09
bardof a écrit
Presque 9 ans depuis que j'ai lu chaque article de ce blog sur mon smartphone dans un coffeeshop à rotterdam. Depuis, je viens 1x par an pour voir si tu en publies d'autres. Aujourd'hui, pour x et y raison, parce que ça fait des années que tu ne donnes plus signe de vie, j'ai décidé de créé un compte sur ce forum, juste pour t'écrire qu'il y a qq années, qqun a lu ton blog comme si c'était une série netflix...J'espère que tout va bien pour toi
Hell'O !
Si tu vas sur son Profil, tu peux voir qu'il n'est plus venu se connecter depuis 2018.
Amicalement
1
- Psychoactif
- » Blogs » Bicicle
- » La poussière. Acte III : "Un doigt dans le cul et c'est fini".
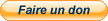 Soutenez PsychoACTIF
Soutenez PsychoACTIF