Trou noir
Quel était mon état d’esprit quand je me rendais à l’endroit où nous nous rencontrions ? Excitation à l’idée de l’ivresse approchante, désir puissant du premier verre, celui qui n’est qu’une amorce, mais qui, quand enfin il est absorbé, ne permet plus aucun retour en arrière, anticipation de l’exaltation partagée, de cette sensation si merveilleuse de se sentir libre, d’oser parler, s’affirmer, crier. Oui, mon état d’esprit était celui-là. Comme si sans alcool je ne faisais qu’attendre la prochaine occasion où je pourrais à nouveau être cette personne gaie, détendue à l’extrême, souple dans la relation aux autres.
Le premier verre bu, il ne restait plus qu’à se laisser couler. Paroles, gorgées, sourires, gorgées, salut, gorgée, un autre, celui-ci est à peine fini mais oui un autre. Sans relâche, pendant des heures. De temps en temps une interrogation à moi-même, souvent provoquée par la solitude qu’impose le passage aux toilettes, ça va, comment tu te sens ? Le t’es bourrée? habituel. L’exercice qui met à l’épreuve, celui de tenir encore sur ses deux jambes repliées sans s’effondrer sur la cuvette que même inconsciente on n’effleure pas. La réponse habituelle, peu importe le degré d’alcoolisation : je suis bien, je vais bien, je kiffe, je passe un trop bon moment. Les gueule-de-bois, attention-méfie-toi-de-la-gueule-de-bois, balayés… Tout va bien. Donc comme tout va bien, pas de raison de s’arrêter.
Puis vient le moment où mon récit se complique, où tout est flou, où, malgré la conscience du fait que je suivais toujours le même chemin, invariablement, je suis incapable de détailler ce qui se passait alors en moi. Pourquoi je continuais à boire sans relâche, de plus en plus avidement, toujours plus, toujours plus, toujours plus, je l’ignore. Je ne savais pas que j’avais mon compte, je ne réalisais pas que j’avais déjà dépassé la limite qui me permet de ne pas souffrir le martyr le lendemain, que j’étais déjà trop ivre pour être intéressante. Mais j’étais celle qui est bourrée à chaque fois. Rarement la seule mais la valeur sure, celle qui fait qu’on est pas le ou la seul.e quand c’est notre tour de nous lâcher, à être l’ivrogne de service. Comment ces gens qui sont censés être mes amis m’ont laissée faire ça, je l’ignore, je ne les blâme pas mais je m’interroge.
L’étape précédente (celle qui occupe la majorité de la nuit) terminée, c’était le moment de l’inconscience. Un état qui, je ne sais comment, ne m’a pas fait plus flipper que ça pendant toutes ces années. Un état pourtant complètement effrayant. Vivre ça, y survivre, et s’y coller à nouveau, encore et encore, ça dépasse l’entendement.
Je parle de moins en moins, je me replie, je ne sais pas exactement, mais je continue de m’enfiler les verres d’alcool, toujours plus vite, comme s’il en allait de ma survie, sans soupçonner que c’est complètement l’inverse ! Si on me dit, pour prendre soin de moi, que je devrais baisser le rythme, boire de l’eau, je m’insurge. On veut me contrôler, on n’y comprend rien, je ne suis pas bourrée, je suis bien, tout va bien. Mais tout ne va pas bien, car je m’enfonce, je me noie. Certains tentent de me calmer (un peu trop tard mais comment le leur reprocher), d’autres m’encouragent à continuer et réprimandent même les premiers, laisse-la-bien-faire-ce-qu’elle-veut, ceux-là on peut dire qu’ils m’ont aidée... Je ne doute pas qu’ils ne me voulaient pas de mal, mais leur aval m’a longtemps amenée à penser que tout ça était “normal”, que j’étais comme les autres. En réalité, non, je n’étais pas comme ces autres, je ne le suis pas aujourd’hui. Aucun d’entre eux n’est en train d’écrire ce texte, pourquoi, parce qu’il n’en ont pas besoin, parce que s’ils ont perdu le contrôle, ils l’ont perdu ponctuellement. Ils ne se sont pas construits autour de cette identité, de ce désir incessant d’ivresse, de toujours-plus, de ce-n’est-jamais-assez. Moi, je suis sûrement plein d’autre choses, mais je ne suis aussi que ça. Et, paradoxe ridicule, je tiens à cette identité, à cette soif d’absolu, à cette recherche de l’ivresse ultime, qui tournoie en-dedans et te fait exploser vers le dehors. Je m’égare.
Arrive le moment où je n’ai plus rien à raconter car je ne l’ai jamais vécu. Ce moment où mon esprit quitte mon corps. Mon enveloppe est là, posée sur une chaise, ou contre un mur. Elle ne s’effondre pas, elle tient plus ou moins droit. Mais moi, où suis-je ? Je n’ai pas de réponse à cette question que je me pose depuis relativement peu comparé à toutes ces années où je me suis retrouvée dans cet état. Personne n’a jamais pris ma tension, ni vérifié le rythme de mon cœur, mes pupilles, je ne sais quoi d’autre. Je suis là, réveillée, mais il n’y a personne dedans. On me dit, Isore, bois de l’eau, je bois de l’eau, Isore arrête de boire du vin, j’arrête de boire du vin, Isore on rentre à la maison… Je suis docile, une coquille vide.
Ils pourraient faire ce qu’ils voudraient de moi mais ce sont mes amis. Extrêmement rarement je me suis retrouvée dans cet état sans des personnes suffisamment proches pour me prendre en charge. Ai-je ces jours-là mobilisé une énergie supplémentaire pour tenir le coup jusqu’à la maison, ou simplement ai-je moins bu, je n’ai que des éléments de réponse et ce n’est pas important.
Un jour, une amie qui boit beaucoup également (mais qui jamais ne frôle l’état dans lequel je peux être) a fait une sorte d’épisode psychotique, impossible de la raisonner, elle hurlait, voulait qu’on la laisse prendre le volant pour rentrer chez elle. L’un d’entre nous (d’entre eux?) a dû l’attraper, la pousser, pour qu’elle ne monte pas dans la voiture. Ensuite elle s’en est prise à une amie, lui a hurlé dessus. La soirée avait tourné au cauchemar. Je n’en dirai pas plus, en réalité je n’étais pas là. Quand j’ai demandé à mes amis, mais je faisais quoi moi, pendant ce temps ? Toi, tu ne faisais rien, tu étais là, tu ne bougeais pas. Une plante verte. Tu la poses là et elle y reste. Effrayant. Les cris de mes amis, le conflit que je déteste, rien ne peut me faire réagir. Simplement parce que je ne suis pas présente. Mon corps est là, donc pour les autres je suis là, mais c’est faux. Moi, Isore, je suis absente. Où suis-je est une autre question. Dans un univers merveilleux, en souffrance, ou simplement morte, je l’ignore, mais ce qui est sûr c’est que je ne suis pas là. Ce n’est pas seulement que je ne me souviens pas du moment, car ça aussi ça m’est arrivé, ça arrive d’ailleurs souvent en amont de ces moments d’absence, ces moments où je refuse d’arrêter de boire contre toute logique je ne m’en souviens pas toujours. Mais le moment dont je parle ici, où je ne suis plus qu’un corps vide, ce n’est pas une question de perte de mémoire. Je n’ai rien fait que je puisse regretter ou dont je ne me souvienne pas. À ma place il y avait un corps, une femme, des yeux ouverts mais qui ne voient rien, un corps capable de se tenir debout, de marcher, d’uriner, parfois même de se laver les dents. Mais dans ce corps il n’y avait personne…
Catégorie : No comment - 08 décembre 2019 à 23:05
1
Merci !
Tu parles à l'imparfait, c'est donc une époque révolue ?
Isortemple sache que j étais exactement dans la même situation il y a peu de temps.
Une traversée du désert...
Puis j'ai essayé le baclofène à haute dose au début ça marchait bien puis le ministère de la santé a réduit les doses à 80mg soit 8 comprimés.
Je suis allé au csapa et on me prescrit de la ritaline contre la coke et l alcool.
Je ne bois quasiment plus et jamais d alcool fort.
Faut dire aussi que je me faisais soigner une hépatite C donc ça m'a motivé aussi.
Si tu ne prends pas d opiacés il y a le Selincro qui apporte d excellents résultats.
Si tu veux tu peux me contacter par mp ça ne m ennuie pas.
Courage
Je m'y retrouve par moments. Dans ce qui se passe "avant" : l'euphorie de l'attente, le prérituel.
La relation au "produit" : c'est lui qui fait le lien avec les personnes présentes, ou l'inverse ?
Les personnes présentes... Franchi un certain cap elles n'ont plus grand rôle à jouer, mais on se veut en droit d'attendre qu'elles en tiennent un.
Et voilà que tu me soulèves beaucoup de questions et me rappelle quelques souvenirs... Merci pour ton texte. Une deuxième fois sera pas de trop.
On m'a donné 20 environ heureusement que j'avais ma methadone après sinon... Gros bobos !
C'est la première fois que j'entends parle de cet effet "plante verte" qui confirme que les uns et les autres nous pouvons réagir très différemment à l'alcool, et surtout à l'alcool consommé en excès.
Pour ma part je sais que si je peux entretenir un plateau d'ivresse sympathique en ne buvant pas trop rapidement mais en maintenant ma conso tout au long de la soirée, l'excès va me faire basculer assez brutalement dans des effets sédatifs incapacitants - ce qui n'empêche pas la gueule de bois!
Merci Cusco pour ton soutien. Je crois cependant pourvoir te dire que, si ma faiblesse vis à vis de l'alcool n'est pas résolue, ce genre d'épisode fait à présent partie du passé (j'aimerais d'ailleurs aussi mettre à plat tout ça pour écrire à ce sujet).
Cheshire Cat a écrit
Dans ce qui se passe "avant" : l'euphorie de l'attente, le prérituel.
S'il y a bien quelque chose qui accompagne chacune de mes consommations (la "soif" de toujours plus mise à part) c'est bien ça...
Hilde a écrit
Pour ma part je sais que si je peux entretenir un plateau d'ivresse sympathique en ne buvant pas trop rapidement mais en maintenant ma conso tout au long de la soirée, l'excès va me faire basculer assez brutalement dans des effets sédatifs incapacitants - ce qui n'empêche pas la gueule de bois!
Sans même parler de ces soirées où l'excès m'entraine dans ces profondeurs, j'ai de grandes difficultés à me maintenir sur le plateau dont tu parles. Encore aujourd'hui, même si je ne sombre plus dans l'inconscience, si la soirée dure longtemps, il y a toujours un moment où je peux basculer. En sachant ça, j'essaye de me rapprocher le moins possible de ce point de non retour, même si, selon les circonstances, c'est plus ou moins facile...
j'ai vraiment apprécier lire ton texte !
Toi qui nous avais diit , que tu n'écrivais pas trop sur PA...
Bien je peux te dire que tu peux , non que tu doit continuer !!
MM
Ton commentaire me fait plaisir
Je vais tenter de t'écouter alors
 j'avais dit d'ailleurs que j'écrirais la suite, c'est à dire, comment je me sens (sentais) les lendemains de ces terribles soirées...
j'avais dit d'ailleurs que j'écrirais la suite, c'est à dire, comment je me sens (sentais) les lendemains de ces terribles soirées...
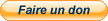 Soutenez PsychoACTIF
Soutenez PsychoACTIF