#1

- Mascarpone

Vieux clacos corse pas coulant
- 27 février 2018 à 06:47
Iran: le pays le plus drogué du monde

Shahnaz a 44 ans et un fils. Elle a tenté d’arrêter. Mais comme elle n’a pas pu déménager, elle a replongé. Aslon Arfa
Cette nation riche et qui fut jadis hautement développée est en dépression. La drogue est une des conséquences d’un fiasco de trente-deux ans : ruine du tissu économique, corruption dévastatrice et dictature sanglante. Triste record annoncé par l’Onu, l’Iran si majoritairement peuplé de jeunes – les deux tiers ont moins de 30 ans – compte la plus grande proportion de consommateurs d’opiacés : environ 3 % de la population, plus du double de la France. Sur place, les intellectuels et les artistes tirent la sonnette d’alarme, la cinéaste Rakhshan Bani-Etemad dans son film « Mainline », et surtout le photographe Aslon Arfa. Il a mis quatre ans à réaliser ce reportage choc parmi les drogués les plus pauvres du sud de Téhéran.
Elle s’est rasé les sourcils pour en redessiner l’arc au crayon gras : agrandis, dramatisés à la façon d’une tragédienne. Fereshteh, comme tant d’Iraniennes, adore le maquillage. Aujourd’hui, cette coquetterie est ce qui la tient active dans le monde des épaves. Elle aussi est dépendante du « black crack ». De l’héroïne cristallisée. Pour se payer ses doses, elle se prostitue. Assise en tailleur sur les vieux tapis persans, elle charbonne ses grands yeux, la fierté familiale. Ses frères, sa très chère sœur, Dieu ait leur âme, tout le monde avait des yeux immenses. Paupières turquoise, rouge à lèvres nacré, un maquillage appuyé, vulgaire. C’est délibéré : Fereshteh s’apprête à quitter la pièce unique où vit ce qui reste de la famille pour aller racoler. En tchador, bien sûr. Deux minutes dans la rue, pas plus, la prostitution est interdite. Certaines filles prennent le risque d’arpenter les parcs ou de raser les façades un peu plus longtemps. Les autres se font appeler sur leur portable.
A 19 ans, avec son teint fatigué, ses ongles pas très nets, la jeune fille, est quasiment une ancienne dans le « métier ». Elle a commencé il y a trois, quatre ans… Ses premiers souvenirs de « pute » se confondent avec ses premiers manques de toxico, elle avait 12 ou 14 ans, elle ne sait plus très bien. A l’époque, la famille – cinq frères et deux sœurs – venait de quitter une ville sinistrée à la frontière irakienne. Depuis la guerre Iran-Irak (1980-1988), cette région de tous les trafics était restée infestée de mines et ravagée par le chômage. Le père avait fini par déserter : étouffé par les responsabilités dans ce système sans plus aucune loi sociale, et qui inféode les femmes. Lâchée par son mari, sous les regards pleins de reproches du voisinage – « Qu’est-ce que tu lui as fait pour qu’il parte ? » – la mère embarque sa tribu vers Téhéran. Téhéran-Sud, la zone de toutes les misères. Arrivant de province, les familles pauvres se retrouvent dans cette banlieue triste et dangereuse. Des constructions de pierre à deux étages, décrépies, bringuebalantes, sont tenues par des voyous, des dealers. Moyennant de « petits services », on peut loger – à six, huit, dix… – dans une seule pièce donnant sur la cour à la manière d’un riad, avec un robinet d’eau au milieu, et des toilettes communes. Là, entre les cris d’enfants, le bruit du jet d’eau dans les cuvettes à vaisselle, les engueulades des marchands de sommeil, on comprend vite que c’est chacun pour soi.
Depuis quatre ans, Fereshteh assure le minimum économique familial. Et les doses. La drogue a déjà emporté ses quatre frères. Eux se piquaient. Elle, sa mère et sa belle-sœur Nastaran se contentent de fumer. « L’opium a toujours fait partie de notre vie. On en prenait pour calmer la grippe, les douleurs des règles… » A Téhéran, ce fut l’escalade. L’un de ses frères est arrivé un jour avec du black crack. Au début, c’était bon. « A présent, on en a besoin pour ne pas être mal », lâche-t-elle. Importée d’Afghanistan, l’héroïne coûte 2 ou 3 dollars le gramme. Une fois mélangée à du bicarbonate (ou à n’importe quoi), elle est asséchée et craque comme du cristal ; il faut compter 2 dollars la dose de black crack. Ça n’a rien à voir avec le crack de France ou d’Amérique, dérivé, lui, de la cocaïne. Le black crack est une production locale avec du pavot récolté de l’autre côté de la frontière irano-afghane par des paysans au service des talibans. A raison d’une dizaine de doses par jour, Fereshteh et sa mère ont besoin de 20 dollars chacune.
Le petit frère – le dernier de cette famille décimée – semble en être sorti. Il a commencé à fumer à 9 ans... et s’est arrêté à 12 ans ! Petit mec lucide et volontaire d’une quinzaine d’années, il fait de la gym, ne va pas vraiment à l’école, ne travaille pas non plus, il bricole. Mais ne se défonce plus. Autrefois, c’était la sœur aînée qui partait vendre son corps pour entretenir tout le monde. Elle a été fauchée dans un accident alors qu’elle rentrait chez elle au petit matin en moto-taxi. Fereshteh enfourche elle aussi une moto-taxi pour rejoindre ses clients à une douzaine de kilomètres de là, au nord de cette ville tentaculaire de 686 kilomètres carrés, six fois la surface de Paris. Le trafic est tel qu’il faut des heures pour franchir deux ou trois kilomètres en voiture collective ou en bus. Les bons soirs, un bourgeois des beaux quartiers de Darband l’appelle sur son portable pour lui demander de le rejoindre chez lui. Mais le plus souvent, elle doit se contenter de trois ou quatre maçons afghans qui se partagent ses faveurs dans une des tours en chantier de ce nord tranquille. Elle se fait entre 30 et 130 dollars par nuit.
Dr Shirazi: «On est un peuple de drogués»
Avant de rentrer à la maison, elle part acheter son crack. Plus elle gagne, plus elle est tranquille. Pour un jour ou deux. A la maison, elle partage avec maman et parfois avec Nastaran. Elles mangent le moins possible, persuadées de démultiplier ainsi les effets de leur dope. « On est un peuple de drogués », soupire le Dr Shirazi, dans son petit cabinet de Chak Sefid, dans les quartiers Est. Depuis dix ans, il tente de sauver ces drogués, les plus pauvres parmi les pauvres. Il en a vu succomber des centaines, terrassés par une overdose. Dans les années 1980-1990, c’était l’héroïne qui s’ajoutait à l’opium, bien éloigné de sa dimension onirique et méditative célébrée dans les fantasmes baudelairiens. Un sexagénaire iranien exilé se souvient : « Du temps de l’opium dans les familles, même à l’époque du Shah et de son père, les nounous calmaient les bébés avec une goutte d’huile d’opium massée sur le front. J’ai vu des chats drogués à l’opium : ils étaient agités, énervés, ils griffaient les tapis, et quand ils avaient pu aspirer la fumée de la pipe, ils s’apaisaient, allaient se poser dans un coin. » Cela, c’étaient les belles années, le faste, si l’on peut dire, d’avant la révolution des mollahs. Eux aussi ont toujours fumé l’opium, ils continuent.
Des industries de pointe et tout l'artisanat se sont effondrés, saignés par la corruption
Religieux ? Tout le monde rigole. Des débauchés sans scrupules, c’est connu. Trente-deux ans après s’être arrogé le pouvoir, les mollahs ont ruiné le pays. Protégés par leurs milices pasdarans et bassijis, ils se sont rempli les poches en rackettant tous les secteurs, des pistaches jusqu’aux ressources minières. Les raffineries de pétrole n’ont jamais été modernisées, des pans entiers de la métallurgie, des industries de pointe et tout l’artisanat se sont effondrés, saignés par les expropriations illégales et la corruption. Les Iraniens impuissants continuent d’envoyer leurs enfants à l’école, à l’université – où les programmes ont été « islamisés ». Mais le chômage touche 25 % de cette population essentiellement composée de jeunes (60 % ont moins de 30 ans). « Et non seulement on ne trouve pas de boulot mais, en plus, on ne peut même pas profiter librement de la vie, ni boire d’alcool, ni faire la fête, ni draguer, ni sortir », résume Ahmad, la trentaine. Etonnez-vous ensuite de les voir se défoncer…
Chez certains, la drogue se consomme, disons, proprement. Rakhshan Bani-Etemad connaît bien ces familles aisées du nord de Téhéran désespérées par un enfant accro. Elle en a fait un film, « Mainline », qui montre le combat d’une mère pour arracher sa fille à l’héroïne. « En Iran, les problèmes sociaux et psychologiques engendrent une très grande demande de drogue », euphémise prudemment cette cinéaste engagée qui affronte mille obstructions pour monter ses films. « Et, malheureusement, la consommation ne se limite pas à une seule classe sociale. Ni aux grandes villes. Corollaire de l’appauvrissement général, elle est partout. Partout ! Bien sûr, les plus pauvres sont les plus touchés. Mais on a tellement de laboratoires clandestins qui fabriquent toutes sortes de saloperies… » Oui, en Iran, il est bien plus facile qu’en France de se droguer. La vie y est moins chère, et le prix des « produits » est carrément imbattable : si la cocaïne est réservée aux « riches », un gramme d’opium se négocie environ 10 dollars, et l’héroïne, encore moins. « Avec un peu d’argent, des seringues régulièrement changées, tu peux vivre dix, vingt ans en te shootant à l’héro si tu fais attention », explique Aslon Arfa, qui, lui, a passé quatre ans à photographier la lie des drogués dans le sud de Téhéran.
Shahnaz, par exemple, 44 ans, mère d’un garçon, est au bout du rouleau. Elle a tenté d’arrêter le crack. Elle a tenu six mois. Mais elle n’a pas pu quitter ce voisinage funeste, ses voisins toxicos, les dealers qui lui tournaient autour. Elle a replongé. Dans les hôpitaux du nord de Téhéran, ce n’est guère mieux : les médecins voient maintenant affluer des jeunes de bonne famille détruits par la « chiché », version iranienne de la méthamphétamine, une drogue synthétique hautement addictive, le poison « qui rend fou » et vous lamine en moins d’un an. « Dans les classes sociales aisées, c’est devenu un fléau », explique un observateur.
Deux ans après la révolution verte, les Iraniens ont sombré dans une dépression sans fond
Deux ans après la « révolution verte » qui s’est dressée contre l’élection trafiquée d’Ahmadinejad, puis après les emprisonnements, les tortures, les viols, les exécutions, bref après la répression sanglante qui a suivi, les Iraniens ont sombré dans une dépression sans fond. Aslon Arfa : « Tout le monde était porté par l’euphorie, on y croyait. Pour la première fois, malgré les violences, les gens étaient heureux. Ils entrevoyaient la fin du tunnel. Aujourd’hui tout est retombé. » Et la situation économique qui s’est aggravée n’a rien arrangé. Ceci explique cela : « Non seulement nous sommes les plus gros consommateurs d’opiacés mais, maintenant, notre consommation de médicaments équivaut à quatre fois la demande mondiale », s’affole le romancier Firouz Nadji-Ghazvini. Ce sont les chiffres de l’Onu. Car depuis deux ans, en Iran, tous les instituts de statistiques ont été fermés, et les sociologues emprisonnés. Comme les journalistes, les étudiants, les blogueurs… Aux abois, les dictateurs ne font pas dans le détail.
A propos des problèmes d’addiction, le gouvernement cultive l’ambiguïté : officiellement interdite et punie de pendaison, la drogue et ses avatars n’engendrent aucune structure d’accueil et de traitement. Pis : on soupçonne un certain nombre de pasdarans voyous de se sucrer sur le trafic à la frontière. Ce sont des médecins et des travailleurs sociaux qui prennent l’initiative de l’aide. En l’absence de financement étatique, ils s’appuient essentiellement sur des organisations non gouvernementales, qui sont très mal vues, est-il besoin de le préciser, à cause de leurs chartes fondées sur les droits de l’homme. Ainsi lorsqu’un de leurs membres, le Dr Alahi, s’est rendu aux Etats-Unis pour s’enquérir des nouveaux traitements antidrogues, il a été arrêté à son retour.
En Iran comme en France, en Suisse et ailleurs, on donne de la méthadone pour aider à décrocher. Sceptique, Aslon Arfa a surtout vu les drogués fauchés se défoncer avec ce produit de substitution en attendant mieux.
Les riches, comme dans le film « Mainline », envoient leur enfant en clinique de désintoxication. Privée, la clinique. Restent les méthodes plus pragmatiques, comme la suppression brutale de toute substance, sous l’autorité d’un surveillant qui ne vous lâche pas pendant des semaines. Et il y a les Narcotiques Anonymes. En version iranienne, ça n’a rien à voir avec la discrète organisation à la française ou à l’américaine. Dans ce parc où les toxicos se piquent au grand jour sous l’œil des passants, des mères et des enfants, N.A. réunit ses membres à ciel ouvert pour les habituelles confessions de «décroche ». Non loin, assommés ou prostrés dans l’herbe, sous les arbres, sur les bancs de pierre, les drogués ne voient rien, même plus capables de ramasser les seringues qui jonchent les allées.
Ces parcs, Baharestan (Le lieu du Printemps) ou Darvazeh Ghar (La bouche de la Cave) étaient autrefois des briqueteries. Dans les immenses cavernes creusées pour extraire la terre, des trafiquants, des voyous, des toxicos menaient leurs « affaires », étranges souterrains de la honte, tout en labyrinthes. Le Shah les a fait raser. Insupportable image d’un Iran impérial, cultivé et qui se rêvait exemplaire. Aujourd’hui, le pays ne songe même plus à cacher ses miséreux. Quand les voisins de Fereshteh ont été expropriés faute d’argent, ils sont venus s’installer là, sur l’herbe, entre pavés et cailloux, près des voitures. Les flics les ont mollement délogés. La famille est revenue, ailleurs, sous le pont du parc. Avec d’autres.
Sources:http://www.parismatch.com/Actu/International/Iran-le-pays-le-plus-drogue-du-monde-144622

Shahnaz a 44 ans et un fils. Elle a tenté d’arrêter. Mais comme elle n’a pas pu déménager, elle a replongé. Aslon Arfa
Cette nation riche et qui fut jadis hautement développée est en dépression. La drogue est une des conséquences d’un fiasco de trente-deux ans : ruine du tissu économique, corruption dévastatrice et dictature sanglante. Triste record annoncé par l’Onu, l’Iran si majoritairement peuplé de jeunes – les deux tiers ont moins de 30 ans – compte la plus grande proportion de consommateurs d’opiacés : environ 3 % de la population, plus du double de la France. Sur place, les intellectuels et les artistes tirent la sonnette d’alarme, la cinéaste Rakhshan Bani-Etemad dans son film « Mainline », et surtout le photographe Aslon Arfa. Il a mis quatre ans à réaliser ce reportage choc parmi les drogués les plus pauvres du sud de Téhéran.
Elle s’est rasé les sourcils pour en redessiner l’arc au crayon gras : agrandis, dramatisés à la façon d’une tragédienne. Fereshteh, comme tant d’Iraniennes, adore le maquillage. Aujourd’hui, cette coquetterie est ce qui la tient active dans le monde des épaves. Elle aussi est dépendante du « black crack ». De l’héroïne cristallisée. Pour se payer ses doses, elle se prostitue. Assise en tailleur sur les vieux tapis persans, elle charbonne ses grands yeux, la fierté familiale. Ses frères, sa très chère sœur, Dieu ait leur âme, tout le monde avait des yeux immenses. Paupières turquoise, rouge à lèvres nacré, un maquillage appuyé, vulgaire. C’est délibéré : Fereshteh s’apprête à quitter la pièce unique où vit ce qui reste de la famille pour aller racoler. En tchador, bien sûr. Deux minutes dans la rue, pas plus, la prostitution est interdite. Certaines filles prennent le risque d’arpenter les parcs ou de raser les façades un peu plus longtemps. Les autres se font appeler sur leur portable.
A 19 ans, avec son teint fatigué, ses ongles pas très nets, la jeune fille, est quasiment une ancienne dans le « métier ». Elle a commencé il y a trois, quatre ans… Ses premiers souvenirs de « pute » se confondent avec ses premiers manques de toxico, elle avait 12 ou 14 ans, elle ne sait plus très bien. A l’époque, la famille – cinq frères et deux sœurs – venait de quitter une ville sinistrée à la frontière irakienne. Depuis la guerre Iran-Irak (1980-1988), cette région de tous les trafics était restée infestée de mines et ravagée par le chômage. Le père avait fini par déserter : étouffé par les responsabilités dans ce système sans plus aucune loi sociale, et qui inféode les femmes. Lâchée par son mari, sous les regards pleins de reproches du voisinage – « Qu’est-ce que tu lui as fait pour qu’il parte ? » – la mère embarque sa tribu vers Téhéran. Téhéran-Sud, la zone de toutes les misères. Arrivant de province, les familles pauvres se retrouvent dans cette banlieue triste et dangereuse. Des constructions de pierre à deux étages, décrépies, bringuebalantes, sont tenues par des voyous, des dealers. Moyennant de « petits services », on peut loger – à six, huit, dix… – dans une seule pièce donnant sur la cour à la manière d’un riad, avec un robinet d’eau au milieu, et des toilettes communes. Là, entre les cris d’enfants, le bruit du jet d’eau dans les cuvettes à vaisselle, les engueulades des marchands de sommeil, on comprend vite que c’est chacun pour soi.
Depuis quatre ans, Fereshteh assure le minimum économique familial. Et les doses. La drogue a déjà emporté ses quatre frères. Eux se piquaient. Elle, sa mère et sa belle-sœur Nastaran se contentent de fumer. « L’opium a toujours fait partie de notre vie. On en prenait pour calmer la grippe, les douleurs des règles… » A Téhéran, ce fut l’escalade. L’un de ses frères est arrivé un jour avec du black crack. Au début, c’était bon. « A présent, on en a besoin pour ne pas être mal », lâche-t-elle. Importée d’Afghanistan, l’héroïne coûte 2 ou 3 dollars le gramme. Une fois mélangée à du bicarbonate (ou à n’importe quoi), elle est asséchée et craque comme du cristal ; il faut compter 2 dollars la dose de black crack. Ça n’a rien à voir avec le crack de France ou d’Amérique, dérivé, lui, de la cocaïne. Le black crack est une production locale avec du pavot récolté de l’autre côté de la frontière irano-afghane par des paysans au service des talibans. A raison d’une dizaine de doses par jour, Fereshteh et sa mère ont besoin de 20 dollars chacune.
Le petit frère – le dernier de cette famille décimée – semble en être sorti. Il a commencé à fumer à 9 ans... et s’est arrêté à 12 ans ! Petit mec lucide et volontaire d’une quinzaine d’années, il fait de la gym, ne va pas vraiment à l’école, ne travaille pas non plus, il bricole. Mais ne se défonce plus. Autrefois, c’était la sœur aînée qui partait vendre son corps pour entretenir tout le monde. Elle a été fauchée dans un accident alors qu’elle rentrait chez elle au petit matin en moto-taxi. Fereshteh enfourche elle aussi une moto-taxi pour rejoindre ses clients à une douzaine de kilomètres de là, au nord de cette ville tentaculaire de 686 kilomètres carrés, six fois la surface de Paris. Le trafic est tel qu’il faut des heures pour franchir deux ou trois kilomètres en voiture collective ou en bus. Les bons soirs, un bourgeois des beaux quartiers de Darband l’appelle sur son portable pour lui demander de le rejoindre chez lui. Mais le plus souvent, elle doit se contenter de trois ou quatre maçons afghans qui se partagent ses faveurs dans une des tours en chantier de ce nord tranquille. Elle se fait entre 30 et 130 dollars par nuit.
Dr Shirazi: «On est un peuple de drogués»
Avant de rentrer à la maison, elle part acheter son crack. Plus elle gagne, plus elle est tranquille. Pour un jour ou deux. A la maison, elle partage avec maman et parfois avec Nastaran. Elles mangent le moins possible, persuadées de démultiplier ainsi les effets de leur dope. « On est un peuple de drogués », soupire le Dr Shirazi, dans son petit cabinet de Chak Sefid, dans les quartiers Est. Depuis dix ans, il tente de sauver ces drogués, les plus pauvres parmi les pauvres. Il en a vu succomber des centaines, terrassés par une overdose. Dans les années 1980-1990, c’était l’héroïne qui s’ajoutait à l’opium, bien éloigné de sa dimension onirique et méditative célébrée dans les fantasmes baudelairiens. Un sexagénaire iranien exilé se souvient : « Du temps de l’opium dans les familles, même à l’époque du Shah et de son père, les nounous calmaient les bébés avec une goutte d’huile d’opium massée sur le front. J’ai vu des chats drogués à l’opium : ils étaient agités, énervés, ils griffaient les tapis, et quand ils avaient pu aspirer la fumée de la pipe, ils s’apaisaient, allaient se poser dans un coin. » Cela, c’étaient les belles années, le faste, si l’on peut dire, d’avant la révolution des mollahs. Eux aussi ont toujours fumé l’opium, ils continuent.
Des industries de pointe et tout l'artisanat se sont effondrés, saignés par la corruption
Religieux ? Tout le monde rigole. Des débauchés sans scrupules, c’est connu. Trente-deux ans après s’être arrogé le pouvoir, les mollahs ont ruiné le pays. Protégés par leurs milices pasdarans et bassijis, ils se sont rempli les poches en rackettant tous les secteurs, des pistaches jusqu’aux ressources minières. Les raffineries de pétrole n’ont jamais été modernisées, des pans entiers de la métallurgie, des industries de pointe et tout l’artisanat se sont effondrés, saignés par les expropriations illégales et la corruption. Les Iraniens impuissants continuent d’envoyer leurs enfants à l’école, à l’université – où les programmes ont été « islamisés ». Mais le chômage touche 25 % de cette population essentiellement composée de jeunes (60 % ont moins de 30 ans). « Et non seulement on ne trouve pas de boulot mais, en plus, on ne peut même pas profiter librement de la vie, ni boire d’alcool, ni faire la fête, ni draguer, ni sortir », résume Ahmad, la trentaine. Etonnez-vous ensuite de les voir se défoncer…
Chez certains, la drogue se consomme, disons, proprement. Rakhshan Bani-Etemad connaît bien ces familles aisées du nord de Téhéran désespérées par un enfant accro. Elle en a fait un film, « Mainline », qui montre le combat d’une mère pour arracher sa fille à l’héroïne. « En Iran, les problèmes sociaux et psychologiques engendrent une très grande demande de drogue », euphémise prudemment cette cinéaste engagée qui affronte mille obstructions pour monter ses films. « Et, malheureusement, la consommation ne se limite pas à une seule classe sociale. Ni aux grandes villes. Corollaire de l’appauvrissement général, elle est partout. Partout ! Bien sûr, les plus pauvres sont les plus touchés. Mais on a tellement de laboratoires clandestins qui fabriquent toutes sortes de saloperies… » Oui, en Iran, il est bien plus facile qu’en France de se droguer. La vie y est moins chère, et le prix des « produits » est carrément imbattable : si la cocaïne est réservée aux « riches », un gramme d’opium se négocie environ 10 dollars, et l’héroïne, encore moins. « Avec un peu d’argent, des seringues régulièrement changées, tu peux vivre dix, vingt ans en te shootant à l’héro si tu fais attention », explique Aslon Arfa, qui, lui, a passé quatre ans à photographier la lie des drogués dans le sud de Téhéran.
Shahnaz, par exemple, 44 ans, mère d’un garçon, est au bout du rouleau. Elle a tenté d’arrêter le crack. Elle a tenu six mois. Mais elle n’a pas pu quitter ce voisinage funeste, ses voisins toxicos, les dealers qui lui tournaient autour. Elle a replongé. Dans les hôpitaux du nord de Téhéran, ce n’est guère mieux : les médecins voient maintenant affluer des jeunes de bonne famille détruits par la « chiché », version iranienne de la méthamphétamine, une drogue synthétique hautement addictive, le poison « qui rend fou » et vous lamine en moins d’un an. « Dans les classes sociales aisées, c’est devenu un fléau », explique un observateur.
Deux ans après la révolution verte, les Iraniens ont sombré dans une dépression sans fond
Deux ans après la « révolution verte » qui s’est dressée contre l’élection trafiquée d’Ahmadinejad, puis après les emprisonnements, les tortures, les viols, les exécutions, bref après la répression sanglante qui a suivi, les Iraniens ont sombré dans une dépression sans fond. Aslon Arfa : « Tout le monde était porté par l’euphorie, on y croyait. Pour la première fois, malgré les violences, les gens étaient heureux. Ils entrevoyaient la fin du tunnel. Aujourd’hui tout est retombé. » Et la situation économique qui s’est aggravée n’a rien arrangé. Ceci explique cela : « Non seulement nous sommes les plus gros consommateurs d’opiacés mais, maintenant, notre consommation de médicaments équivaut à quatre fois la demande mondiale », s’affole le romancier Firouz Nadji-Ghazvini. Ce sont les chiffres de l’Onu. Car depuis deux ans, en Iran, tous les instituts de statistiques ont été fermés, et les sociologues emprisonnés. Comme les journalistes, les étudiants, les blogueurs… Aux abois, les dictateurs ne font pas dans le détail.
A propos des problèmes d’addiction, le gouvernement cultive l’ambiguïté : officiellement interdite et punie de pendaison, la drogue et ses avatars n’engendrent aucune structure d’accueil et de traitement. Pis : on soupçonne un certain nombre de pasdarans voyous de se sucrer sur le trafic à la frontière. Ce sont des médecins et des travailleurs sociaux qui prennent l’initiative de l’aide. En l’absence de financement étatique, ils s’appuient essentiellement sur des organisations non gouvernementales, qui sont très mal vues, est-il besoin de le préciser, à cause de leurs chartes fondées sur les droits de l’homme. Ainsi lorsqu’un de leurs membres, le Dr Alahi, s’est rendu aux Etats-Unis pour s’enquérir des nouveaux traitements antidrogues, il a été arrêté à son retour.
En Iran comme en France, en Suisse et ailleurs, on donne de la méthadone pour aider à décrocher. Sceptique, Aslon Arfa a surtout vu les drogués fauchés se défoncer avec ce produit de substitution en attendant mieux.
Les riches, comme dans le film « Mainline », envoient leur enfant en clinique de désintoxication. Privée, la clinique. Restent les méthodes plus pragmatiques, comme la suppression brutale de toute substance, sous l’autorité d’un surveillant qui ne vous lâche pas pendant des semaines. Et il y a les Narcotiques Anonymes. En version iranienne, ça n’a rien à voir avec la discrète organisation à la française ou à l’américaine. Dans ce parc où les toxicos se piquent au grand jour sous l’œil des passants, des mères et des enfants, N.A. réunit ses membres à ciel ouvert pour les habituelles confessions de «décroche ». Non loin, assommés ou prostrés dans l’herbe, sous les arbres, sur les bancs de pierre, les drogués ne voient rien, même plus capables de ramasser les seringues qui jonchent les allées.
Ces parcs, Baharestan (Le lieu du Printemps) ou Darvazeh Ghar (La bouche de la Cave) étaient autrefois des briqueteries. Dans les immenses cavernes creusées pour extraire la terre, des trafiquants, des voyous, des toxicos menaient leurs « affaires », étranges souterrains de la honte, tout en labyrinthes. Le Shah les a fait raser. Insupportable image d’un Iran impérial, cultivé et qui se rêvait exemplaire. Aujourd’hui, le pays ne songe même plus à cacher ses miséreux. Quand les voisins de Fereshteh ont été expropriés faute d’argent, ils sont venus s’installer là, sur l’herbe, entre pavés et cailloux, près des voitures. Les flics les ont mollement délogés. La famille est revenue, ailleurs, sous le pont du parc. Avec d’autres.
Sources:http://www.parismatch.com/Actu/International/Iran-le-pays-le-plus-drogue-du-monde-144622
Qui pète plus haut que son cul, fini par se chier dessus!
Le pire con, c'est le vieux con, car on ne peut rien contre l'expérience!
Ce qui est bien chez les félés, c'est que de temps en temps ils lais
Hors ligne
#2
Le sujet est intéressant dommage que le ton soit si méprisant/chelou ...
Merci pour le partage.
Merci pour le partage.
Dernière modification par anonyme 9999 (28 février 2018 à 00:25)
Hors ligne
#3

- Sufenta
Adhérent PsychoACTIF - 28 février 2018 à 00:40
Merci pour cet article, qui montre à quel point la dictature est synonyme de misère et lorsqu’on a des opiacés de cette qualité ça adoucit la misère, mais le gouvernement de l’iran ne résous rien niveau pauvreté.
L’avenir paraît bien sombre pour ces personnes
L’avenir paraît bien sombre pour ces personnes
Hors ligne
#4

- Mascarpone

Vieux clacos corse pas coulant
- 28 février 2018 à 08:44
Breaking Bad à Téhéran : en Iran, les jeunes femmes diplômées sont de plus en plus accros aux drogues dures

L'Iran connaît un problème croissant de consommation de drogues. Les jeunes femmes, avec un très bon niveau d'études, sont parmi les plus grandes victimes. Alors que le premier centre de désintoxication pour femmes a ouvert à Téhéran il y a quatre ans, le gouvernement du président Hassan Rohani, au pouvoir depuis 2013, a abordé la question de façon plus frontale.
Les filles de 13 ans sont de plus en plus dépendantes
L'année dernière, Shahindokht Molaverdi, le vice-président des Affaires familiales et des femmes, a admis que le nombre de femmes toxicomanes a plus que doublé au cours des deux dernières années, sans toutefois donner de chiffres précis, explique le site Quartz.
Pire, les filles de 13 ans sont de plus en plus dépendantes, d'après les responsables iraniens. Shahindokht Molaverdi a déclaré, en janvier 2015, qu'il y avait 500 femmes toxicomanes sans-abris dans les rues de Téhéran. Un nombre revu à la hausse par certains experts qui l'estiment plus proche de 15 000.
Jeunes, instruites et au chômage, elles tombent dans la drogue
Mais le plus frappant, c'est que les problèmes de drogue affectent non seulement les femmes pauvres mais aussi celles issues de milieux bourgeois et très instruites. La formation continue a connu un grand engouement parmi les femmes iraniennes au cours des 25 dernières années, et en particulier dans la dernière décennie. Le nombre d'universités privées et les étudiantes admises ont considérablement augmenté. Mais après avoir terminé leurs études, beaucoup de ces femmes, qui généralement vivent avec leurs parents avant leur mariage, n'ont pas été en mesure d'obtenir des emplois dans une économie affaiblie par la mauvaise gestion et les sanctions économiques. Jeunes, instruites et au chômage, certaines femmes des classes économiques moyennes et supérieures sont alors tombées dans la dépression et se sont tournées vers la toxicomanie. Bien que la révolution de 1979 ait imposé le strict respect de la loi islamique, les Iraniens ont maîtrisé l'art du contournement et un grand nombre d'alcools et de drogues sont facilement disponibles.
85 % des toxicomanes rechutent après une cure
Les centres de désintoxication gérés par le gouvernement sont rares et les familles aisées cachent la dépendance de leurs enfants. Du coup, il existe peu de chiffres fiables sur la dépendance. Cependant, les responsables iraniens indiquent que 85 % des toxicomanes rechutent après une cure de désintoxication. Aux Etats-Unis, une étude réalisée en 2000 a estimé que le taux de rechute était de 40 à 60 % chez les Américains. Et la plupart effectuent un séjour de désintoxication 15 à 20 fois dans leur vie.
On trouve de tout : de la méta-amphétamine à l'opium
En Iran, les drogues ne coûtent pas cher et sont faciles à trouver. Les gens utilisent de tout : des cristaux de méta-amphétamine à l'opium, avec des analgésiques comme le Tramadol pour accompagner les descentes. Selon The Guardian, au nord de Téhéran, à 2 heures du matin, l'heure de pointe, on assiste à des files de voitures qui attendent pour se ravitailler. La cocaïne, la marijuana, l'ecstasy sont très prisés et l'opium est considéré comme une drogue pour personnes âgées. Quant aux cristaux de méta-amphétamine, ils ont réussi à transcender les clivages sociaux et se trouvent partout dans la ville.
De la meth pour perdre du poids
Les femmes iraniennes ont développé l'habitude d'utiliser les cristaux de méta-amphétamine pour perdre du poids.
Certaines en achètent illégalement dans des spas et des salons de beauté, où on leur explique qu'ils vont les aider à conserver une silhouette élancée. En 2012, l'Iran était le quatrième importateur mondial de la pseudoéphédrine, le principal élément chimique utilisé dans la production de méta-amphétamine en cristaux. Et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime a estimé que plus d'un demi million de Téhéranais, âgés de 15 à 45 ans, en avait consommé au moins une fois.
Vers une légalisation de l'opium et du cannabis ?
Actuellement, les Iraniens risquent jusqu’à la peine de mort pour la simple détention de substances illicites (500 personnes exécutées pour des affaires liées à la drogue en 2015). Mais, après plusieurs années d’échecs dans leurs politiques de répression, les autorités iraniennes réfléchiraient à assouplir la loi pour tenter d’endiguer le phénomène. The Conversation rapporte la proposition de Saeed Sefatian, une personnalité de premier plan à la tête d’un groupe de travail sur la réduction des drogues au Conseil de discernement, qui proposerait une nouvelle politique en matière de drogues incluant une légalisation de l’opium et du cannabis. Mais cette proposition iconoclaste ne fait pas l’unanimité et les conservateurs estiment que l’usage de drogues doit continuer à être prohibé.
Sources: http://www.atlantico.fr/decryptage/brea … 19387.html

L'Iran connaît un problème croissant de consommation de drogues. Les jeunes femmes, avec un très bon niveau d'études, sont parmi les plus grandes victimes. Alors que le premier centre de désintoxication pour femmes a ouvert à Téhéran il y a quatre ans, le gouvernement du président Hassan Rohani, au pouvoir depuis 2013, a abordé la question de façon plus frontale.
Les filles de 13 ans sont de plus en plus dépendantes
L'année dernière, Shahindokht Molaverdi, le vice-président des Affaires familiales et des femmes, a admis que le nombre de femmes toxicomanes a plus que doublé au cours des deux dernières années, sans toutefois donner de chiffres précis, explique le site Quartz.
Pire, les filles de 13 ans sont de plus en plus dépendantes, d'après les responsables iraniens. Shahindokht Molaverdi a déclaré, en janvier 2015, qu'il y avait 500 femmes toxicomanes sans-abris dans les rues de Téhéran. Un nombre revu à la hausse par certains experts qui l'estiment plus proche de 15 000.
Jeunes, instruites et au chômage, elles tombent dans la drogue
Mais le plus frappant, c'est que les problèmes de drogue affectent non seulement les femmes pauvres mais aussi celles issues de milieux bourgeois et très instruites. La formation continue a connu un grand engouement parmi les femmes iraniennes au cours des 25 dernières années, et en particulier dans la dernière décennie. Le nombre d'universités privées et les étudiantes admises ont considérablement augmenté. Mais après avoir terminé leurs études, beaucoup de ces femmes, qui généralement vivent avec leurs parents avant leur mariage, n'ont pas été en mesure d'obtenir des emplois dans une économie affaiblie par la mauvaise gestion et les sanctions économiques. Jeunes, instruites et au chômage, certaines femmes des classes économiques moyennes et supérieures sont alors tombées dans la dépression et se sont tournées vers la toxicomanie. Bien que la révolution de 1979 ait imposé le strict respect de la loi islamique, les Iraniens ont maîtrisé l'art du contournement et un grand nombre d'alcools et de drogues sont facilement disponibles.
85 % des toxicomanes rechutent après une cure
Les centres de désintoxication gérés par le gouvernement sont rares et les familles aisées cachent la dépendance de leurs enfants. Du coup, il existe peu de chiffres fiables sur la dépendance. Cependant, les responsables iraniens indiquent que 85 % des toxicomanes rechutent après une cure de désintoxication. Aux Etats-Unis, une étude réalisée en 2000 a estimé que le taux de rechute était de 40 à 60 % chez les Américains. Et la plupart effectuent un séjour de désintoxication 15 à 20 fois dans leur vie.
On trouve de tout : de la méta-amphétamine à l'opium
En Iran, les drogues ne coûtent pas cher et sont faciles à trouver. Les gens utilisent de tout : des cristaux de méta-amphétamine à l'opium, avec des analgésiques comme le Tramadol pour accompagner les descentes. Selon The Guardian, au nord de Téhéran, à 2 heures du matin, l'heure de pointe, on assiste à des files de voitures qui attendent pour se ravitailler. La cocaïne, la marijuana, l'ecstasy sont très prisés et l'opium est considéré comme une drogue pour personnes âgées. Quant aux cristaux de méta-amphétamine, ils ont réussi à transcender les clivages sociaux et se trouvent partout dans la ville.
De la meth pour perdre du poids
Les femmes iraniennes ont développé l'habitude d'utiliser les cristaux de méta-amphétamine pour perdre du poids.
Certaines en achètent illégalement dans des spas et des salons de beauté, où on leur explique qu'ils vont les aider à conserver une silhouette élancée. En 2012, l'Iran était le quatrième importateur mondial de la pseudoéphédrine, le principal élément chimique utilisé dans la production de méta-amphétamine en cristaux. Et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime a estimé que plus d'un demi million de Téhéranais, âgés de 15 à 45 ans, en avait consommé au moins une fois.
Vers une légalisation de l'opium et du cannabis ?
Actuellement, les Iraniens risquent jusqu’à la peine de mort pour la simple détention de substances illicites (500 personnes exécutées pour des affaires liées à la drogue en 2015). Mais, après plusieurs années d’échecs dans leurs politiques de répression, les autorités iraniennes réfléchiraient à assouplir la loi pour tenter d’endiguer le phénomène. The Conversation rapporte la proposition de Saeed Sefatian, une personnalité de premier plan à la tête d’un groupe de travail sur la réduction des drogues au Conseil de discernement, qui proposerait une nouvelle politique en matière de drogues incluant une légalisation de l’opium et du cannabis. Mais cette proposition iconoclaste ne fait pas l’unanimité et les conservateurs estiment que l’usage de drogues doit continuer à être prohibé.
Sources: http://www.atlantico.fr/decryptage/brea … 19387.html
Dernière modification par Mascarpone (28 février 2018 à 08:45)
Qui pète plus haut que son cul, fini par se chier dessus!
Le pire con, c'est le vieux con, car on ne peut rien contre l'expérience!
Ce qui est bien chez les félés, c'est que de temps en temps ils lais
Hors ligne
#5

- Mascarpone

Vieux clacos corse pas coulant
- 28 février 2018 à 08:49
Le 1er article était de 2011, le second, de 2015, voilà le résultat en Juin 2017...
En Iran, le nombre de drogués a doublé

Voisin de l'Afghanistan, qui est le principal producteur d'opium dans le monde, l'Iran est une route de transit de la drogue vers l'Europe et les pays du Proche-Orient. Mais la drogue est aussi distribuée en contrebande dans le pays, ce qui explique une forte augmentation du nombre de drogués.
Selon le porte-parole du Centre pour la lutte contre la drogue, le nombre des toxicomanes iraniens a doublé en six ans. Il y a aujourd'hui 2,8 millions de toxicomanes contre seulement 1,3 million il y a six ans, a déclaré Parviz Afshar. Près de 70 % des toxicomanes iraniens consomment de l'opium, et les autres d'autres sortes de drogues, notamment du cristal.
Selon les médias iraniens, la forte augmentation du nombre de toxicomanes s'explique par l'augmentation de la production d'opium en Afghanistan, une hausse de la contrebande et les prix peu élevés des drogues sur le marché iranien. Au cours des trois derniers mois, les forces de l'ordre ont saisi 200 tonnes de drogue en provenance de l'Afghanistan. La pauvreté explique aussi cette forte hausse de la consommation de la drogue.
La production d'opium en Afghanistan a fortement augmenté depuis l'intervention militaire des Etats-Unis et de leurs alliés en 2001 pour renverser les talibans. Selon les Nations unies, la production de l'opium a atteint près de 5 000 tonnes en 2016, contre seulement 200 en 2001.
Sources: http://www.rfi.fr/moyen-orient/20170625 … fghanistan
En Iran, le nombre de drogués a doublé

Voisin de l'Afghanistan, qui est le principal producteur d'opium dans le monde, l'Iran est une route de transit de la drogue vers l'Europe et les pays du Proche-Orient. Mais la drogue est aussi distribuée en contrebande dans le pays, ce qui explique une forte augmentation du nombre de drogués.
Selon le porte-parole du Centre pour la lutte contre la drogue, le nombre des toxicomanes iraniens a doublé en six ans. Il y a aujourd'hui 2,8 millions de toxicomanes contre seulement 1,3 million il y a six ans, a déclaré Parviz Afshar. Près de 70 % des toxicomanes iraniens consomment de l'opium, et les autres d'autres sortes de drogues, notamment du cristal.
Selon les médias iraniens, la forte augmentation du nombre de toxicomanes s'explique par l'augmentation de la production d'opium en Afghanistan, une hausse de la contrebande et les prix peu élevés des drogues sur le marché iranien. Au cours des trois derniers mois, les forces de l'ordre ont saisi 200 tonnes de drogue en provenance de l'Afghanistan. La pauvreté explique aussi cette forte hausse de la consommation de la drogue.
La production d'opium en Afghanistan a fortement augmenté depuis l'intervention militaire des Etats-Unis et de leurs alliés en 2001 pour renverser les talibans. Selon les Nations unies, la production de l'opium a atteint près de 5 000 tonnes en 2016, contre seulement 200 en 2001.
Sources: http://www.rfi.fr/moyen-orient/20170625 … fghanistan
Qui pète plus haut que son cul, fini par se chier dessus!
Le pire con, c'est le vieux con, car on ne peut rien contre l'expérience!
Ce qui est bien chez les félés, c'est que de temps en temps ils lais
Hors ligne
#6

- Mascarpone

Vieux clacos corse pas coulant
- 28 février 2018 à 09:00
Et en Janvier 2018...Même eux, commencent à reconnaitre du bout des lèvres que la pire répréssion en matière de drogue n'a aucune réelle efficacité pour lutter contre ce "fléau"...
L’Iran va limiter les condamnations à mort pour trafic de drogue
Des milliers de condamnés à la peine capitale vont voir leur peine suspendue, alors que Téhéran a exécuté 567 personnes en 2016.
L’entrée en vigueur d’une nouvelle loi va suspendre les condamnations à la peine de mort qui pesaient sur quelque 5 000 trafiquants de drogue en Iran. Le 9 janvier, le chef du pouvoir judiciaire, Sadegh Amoli Larijani, a transmis à son administration le décret d’application de ce texte, voté par le Parlement en août 2017, avec effet rétroactif. En pratique, ce décret oblige les juges à réexaminer plusieurs milliers de dossiers et à commuer certaines condamnations à la peine capitale en peines d’emprisonnement et, parfois, en simples amendes.
La mise en application de cette loi constitue un profond changement de stratégie de la part de Téhéran dans sa lutte contre le trafic de stupéfiants. Elle représente aussi une tentative des autorités de répondre aux critiques des organisations de défense des droits de l’homme, qui dénoncent le grand nombre d’exécutions dans le pays. En 2016, avec 567 exécutions recensées, la République islamique d’Iran se plaçait en deuxième position des pays ayant le plus appliqué la peine de mort, derrière la Chine.
Selon cette loi, seuls les Iraniens arrêtés pour le trafic et la distribution de plus de 50 kg d’opium seront condamnés à la peine capitale, contre 5 kg jusqu’ici. Ce seuil, auparavant fixé à 30 grammes pour l’héroïne et les amphétamines, passe respectivement à 2 kg et à 3 kg. De par sa frontière avec l’Afghanistan, premier producteur d’opium au monde, l’Iran se situe sur une importante route internationale de trafic de cette substance ainsi que de l’héroïne, qui en dérive et est également produite en Afghanistan. La consommation de drogues est importante en Iran, où le taux de chômage des jeunes atteint 28 %, selon les chiffres officiels, sous-estimés à en croire beaucoup d’analystes.
Image ternie
Malgré de vives critiques de l’Organisation iranienne de la lutte contre les drogues, qui rassemble autour du président, Hassan Rohani, des représentants des forces de sécurité, de la justice et de la santé, cette loi a été votée au Parlement, à l’été 2017, au début du second mandat de M. Rohani. Elle a été depuis validée par le Conseil des gardiens de la Constitution, un corps chargé de vérifier la conformité des lois avec le droit islamique et la loi fondamentale du pays. Cet organe s’oppose pourtant d’ordinaire à tout « relâchement » du droit sociétal, et à la modification des lois qu’il juge essentielles à la République islamique, comme celle sur la peine de mort.
Cette annonce survient alors que des organisations des droits de l’homme évoquent la mort en prison de cinq manifestants, arrêtés lors de la vague de contestation ayant secoué l’Iran pendant une semaine, à partir du 28 décembre 2017. Alors que les pays occidentaux et des organisations internationales s’inquiètent de la violence exercée par Téhéran contre les manifestants, ces suspensions massives d’exécutions permettent au président Rohani de mettre en avant un progrès réel de l’Iran en matière des droits de l’homme.
« C’est une très bonne nouvelle, parce que l’application de la peine de mort en Iran a gravement terni l’image du pays à l’étranger, s’est réjoui l’avocat reconnu Saleh Nikbakht, dans un entretien au quotidien iranien Etemad. Si la peine de mort avait été efficace, elle aurait fait diminuer le nombre des trafiquants de stupéfiants depuis longtemps. Au contraire, ils se multiplient. »
La nouvelle loi n’annule pas les peines capitales prononcées contre les chefs des cartels ni contre ceux qui engagent des mineurs et qui ont recours aux armes à feu. En Iran, le viol, le meurtre et la pédophilie sont encore aujourd’hui passibles de la peine de mort.
Sources: http://www.lemonde.fr/proche-orient/art … _3218.html
L’Iran va limiter les condamnations à mort pour trafic de drogue
Des milliers de condamnés à la peine capitale vont voir leur peine suspendue, alors que Téhéran a exécuté 567 personnes en 2016.
L’entrée en vigueur d’une nouvelle loi va suspendre les condamnations à la peine de mort qui pesaient sur quelque 5 000 trafiquants de drogue en Iran. Le 9 janvier, le chef du pouvoir judiciaire, Sadegh Amoli Larijani, a transmis à son administration le décret d’application de ce texte, voté par le Parlement en août 2017, avec effet rétroactif. En pratique, ce décret oblige les juges à réexaminer plusieurs milliers de dossiers et à commuer certaines condamnations à la peine capitale en peines d’emprisonnement et, parfois, en simples amendes.
La mise en application de cette loi constitue un profond changement de stratégie de la part de Téhéran dans sa lutte contre le trafic de stupéfiants. Elle représente aussi une tentative des autorités de répondre aux critiques des organisations de défense des droits de l’homme, qui dénoncent le grand nombre d’exécutions dans le pays. En 2016, avec 567 exécutions recensées, la République islamique d’Iran se plaçait en deuxième position des pays ayant le plus appliqué la peine de mort, derrière la Chine.
Selon cette loi, seuls les Iraniens arrêtés pour le trafic et la distribution de plus de 50 kg d’opium seront condamnés à la peine capitale, contre 5 kg jusqu’ici. Ce seuil, auparavant fixé à 30 grammes pour l’héroïne et les amphétamines, passe respectivement à 2 kg et à 3 kg. De par sa frontière avec l’Afghanistan, premier producteur d’opium au monde, l’Iran se situe sur une importante route internationale de trafic de cette substance ainsi que de l’héroïne, qui en dérive et est également produite en Afghanistan. La consommation de drogues est importante en Iran, où le taux de chômage des jeunes atteint 28 %, selon les chiffres officiels, sous-estimés à en croire beaucoup d’analystes.
Image ternie
Malgré de vives critiques de l’Organisation iranienne de la lutte contre les drogues, qui rassemble autour du président, Hassan Rohani, des représentants des forces de sécurité, de la justice et de la santé, cette loi a été votée au Parlement, à l’été 2017, au début du second mandat de M. Rohani. Elle a été depuis validée par le Conseil des gardiens de la Constitution, un corps chargé de vérifier la conformité des lois avec le droit islamique et la loi fondamentale du pays. Cet organe s’oppose pourtant d’ordinaire à tout « relâchement » du droit sociétal, et à la modification des lois qu’il juge essentielles à la République islamique, comme celle sur la peine de mort.
Cette annonce survient alors que des organisations des droits de l’homme évoquent la mort en prison de cinq manifestants, arrêtés lors de la vague de contestation ayant secoué l’Iran pendant une semaine, à partir du 28 décembre 2017. Alors que les pays occidentaux et des organisations internationales s’inquiètent de la violence exercée par Téhéran contre les manifestants, ces suspensions massives d’exécutions permettent au président Rohani de mettre en avant un progrès réel de l’Iran en matière des droits de l’homme.
« C’est une très bonne nouvelle, parce que l’application de la peine de mort en Iran a gravement terni l’image du pays à l’étranger, s’est réjoui l’avocat reconnu Saleh Nikbakht, dans un entretien au quotidien iranien Etemad. Si la peine de mort avait été efficace, elle aurait fait diminuer le nombre des trafiquants de stupéfiants depuis longtemps. Au contraire, ils se multiplient. »
La nouvelle loi n’annule pas les peines capitales prononcées contre les chefs des cartels ni contre ceux qui engagent des mineurs et qui ont recours aux armes à feu. En Iran, le viol, le meurtre et la pédophilie sont encore aujourd’hui passibles de la peine de mort.
Sources: http://www.lemonde.fr/proche-orient/art … _3218.html
Qui pète plus haut que son cul, fini par se chier dessus!
Le pire con, c'est le vieux con, car on ne peut rien contre l'expérience!
Ce qui est bien chez les félés, c'est que de temps en temps ils lais
Hors ligne
#7

- Raoul Duke91

Nouveau Psycho
- 27 juin 2020 à 20:49
Je suis iranien et j’adore mon pays mais qu’est-ce que c’est triste les dirigeants ne font rien pour lui. J’ai eu l’occasion de goûter cette fameuse héroïne qui vient d’Iran et incroyable je comprend complètement que l’on veuille se réfugier dedans et que l’on arrive même plus à s’en sortir.
Je pense je personne ne devrait commencer les opiacés c’est beaucoup dangereux et engrange beaucoup trop de problème autant pour la santé que pour l’entourage et le plus dur c’est que même après 1 an sans en consommer on sait qu’on est toujours accro et qu’il vas falloir prendre sur sois
Je pense je personne ne devrait commencer les opiacés c’est beaucoup dangereux et engrange beaucoup trop de problème autant pour la santé que pour l’entourage et le plus dur c’est que même après 1 an sans en consommer on sait qu’on est toujours accro et qu’il vas falloir prendre sur sois
Ce que la drogue te donne d’une main elle te le reprend de l’autre
Hors ligne
#8

- Mister No

Pussy time - 27 juin 2020 à 21:13
Je pense je personne ne devrait commencer les opiacés c’est beaucoup dangereux et engrange beaucoup trop de problème autant pour la santé que pour l’entourage e
Je ne dis pas que les opiacés ne sont pas dangereux, mais c'est la prohibition qui crée surtout du danger, ajoute des problèmes de santé ou avec la société.
Après commencer, continuer, goûter ou pas, c'est avant tout une question de décision personnelle.
La prohibition fait du mal partout, pas qu'en Iran.
Dernière modification par Mister No (27 juin 2020 à 21:15)
Just say no prohibition !
Hors ligne
Sujets similaires dans les forums, psychowiki et QuizzZ
Psychoactif
Psychoactif est une communauté dédiée à l'information, l'entraide, l'échange d'expériences et la construction de savoirs sur les drogues, dans une démarche de réduction des risques. Droit d'auteur : les textes de Psychoactif de https://www.psychoactif.org sont sous licence CC by NC SA 3.0 sauf mention contraire.
Affichage Bureau - A propos de Psychoactif - Politique de confidentialité - CGU - Contact -


 0, 23066 vues, dernier message :
0, 23066 vues, dernier message : 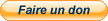 Soutenez PsychoACTIF
Soutenez PsychoACTIF