1
- Atypique

- Nouveau membre
- Inscrit le 17 Jul 2017
- 1 message
Bonjour ou bonsoir à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous me lisez.
J'ignore par où commencer. De prime abord, je ressemble à une personne lambda : j'ai bientôt dix-huit ans, j'ai passé mon bac récemment, j'ai des amis proches, je passe mes journées à lire ou à traîner sur mon ordinateur ou mon téléphone : une presque adulte comme toutes les autres.
Mais dans le fond, j'ai vécu ce que je ne souhaite à personne.
Au plus loin que je me souvienne, le début de mon cauchemar date de la classe de quatrième : j'avais 13 ans. J'étais tombée follement amoureuse d'une personne de l'école, mais j'ignore pourquoi, cette banalité a terminé en d'énormes ragots qui se sont transformés en harcèlement vers le mois de mars. En septembre, à ma rentrée en troisième, j'espérais que toutes ces histoires auraient été tassées : mais non, les provocations et rabaissements des autres élèves avaient même décuplé.
Le 25 novembre 2013, j'ai fait ma première tentative de suicide en avalant 8 Ixprim.
Tentative ratée, en effet, en ayant pourtant pris une dose létale pour mon jeune organisme.
Et j'ai continué. Ma mère prenait souvent du Ixprim à l'époque et il y en avait énormément de boîtes, ainsi que le générique de ce médicament, dans la maison. C'était extrêmement facile pour moi d'en prendre, et tout le long de la classe de troisième, je me suis amusée à aller en cours shootée à deux ou trois cachets. La seconde s'est passée de la même manière, avec les mêmes médicaments. J'ai continué après le suicide de mon meilleur ami survenu en mai 2015. Eh oui, à croire qu'à cette période, la terre entière était contre moi. Mais en juillet 2015, j'ai rencontré une fille qui nous a reliées par un coup de foudre réciproque. On est sorties ensemble pendant assez longtemps. Septembre, ma rentrée en première s'est assez bien passée, malgré un changement de lycée qui m'avait bouleversée. Je m'y suis faite, et pour m'aider à supporter les points noirs, j'avais encore les cachets que j'aimais tant, je contrôlais ce que je prenais, et quand je prenais, même si mes doses avaient largement augmenté.
Je ne sais pas quand est-ce que j'ai perdu pied. Mais vers le mois de janvier 2016, je me suis rendu compte que je prenais TOUS LES JOURS en grosse dose mais que le stock de médicaments avait beaucoup diminué : je n'avais presque plus rien. J'ai cherché autre chose, j'ai trouvé de la codéine. J'en ai pris plusieurs mois.
Et plus tard, j'ai trouvé de la morphine dans les tiroirs de ma mère. J'en ai pris aussi, pendant combien de temps, je l'ignore. Beaucoup trop de temps. Une surdose m'a même valu un séjour à l'hôpital après avoir eu un malaise en cours, que j'ai été obligée de faire passer pour un simple excès d'une carence auprès de mes profs ; je ne pouvais pas parler, par peur, par honte surtout. La honte qu'on me prenne pour une folle et qu'on fasse ENCORE des histoires.
J'ai passé le bac de français. J'ai passé mon oral complètement shootée au Ixprim. Pour moi, je me concentrais tellement mieux avec ça, et j'étais nettement moins stressée. Mais vu de l'extérieur, je me dis que c'était pire que tricher. Mon 16/20 ne vaut rien.
Et en juillet 2016, ma copine en a eu marre. Elle n'en pouvait plus et souffrait de me voir ainsi : elle m'a posé le pire ultimatum de ma vie, "c'est ta drogue ou moi".
J'ai fait le mauvais choix. Les trente jours d'essai qu'elle m'avait laissés pour arrêter, ou du moins lui montrer ma bonne foi, on été les pires de ma vie : sevrage forcé du jour au lendemain, je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je suais, tremblais et étais incapable de me concentrer. J'ai pleuré toute la semaine, et ça s'est calmé. Sauf que deux jours plus tard, je suis retombée.
Elle m'a quittée. Et j'ai compris que cette drogue m'avait fait perdre la personne que j'aimais le plus au monde. J'avais fait la plus grosse connerie de mon existence, et je vous promets qu'un an après, j'en souffre encore, une plaie lancinante et suintante qu'aucune pommade ne peut apaiser. J'ai compris que je DEVAIS arrêter. Pour moi, pour elle, pour mes parents qui commençaient à se douter que les médicaments disparus avaient sûrement un lien avec mes malaises à répétition. J'ai essayé d'arrêter début terminale, j'ai subi la semaine de sevrage et j'ai perdu espoir : je n'avais pas de quoi m'occuper la tête et les mains, je ne pouvais plus dormir si je n'avais rien pris dans la journée. Encore quelques malaises en cours, une prof très gentille, très attentionnée qui s'est énormément inquiétée pour moi et à qui aujourd'hui je regrette énormément de ne pas avoir parlé davantage.
Quand j'ai tenté une nouvelle semaine de sevrage, j'ai eu une pensée horriblement douloureuse : ce n'était pas arrêter que je voulais, mais simplement ne jamais être tombée dedans.
Il n'y avait plus énormément de stock de médicaments chez moi. Alors je gardais l'argent de poche que me donnait ma mère pour parer aux éventualités en ville, il m'est même arrivé parfois de ne pas manger du tout à midi pour garder l'argent et aller dans une pharmacie, demander deux ou trois boîtes de Prontalgine pour supporter la semaine. Je me sentais à la fois ridicule et puissante dans ces moments-là.
Le mois dernier, j'ai passé mon bac. Je rêvais tellement de décrocher ce diplôme avec mention que j'ai mis toutes les chances de mon côté : j'ai commencé à travailler sérieusement dès le mois de mars, j'ai révisé quasiment chaque soir, et entre mars et fin avril, il me semble avoir assez bien tenu le coup : quelques dérapages mais je m'étais relevée.
Le 23 avril, après environ 5 semaines de force, j'ai craqué pour aucune raison. Je partais en voyage scolaire et nous étions à peine arrivés dans notre hôtel à Prague que j'ai craqué : j'avais avec moi une boîte d'ibuprofène censée contrer d'éventuels maux de tête, elle s'est vidée en deux jours.
J'avais honte de ce que j'avais fait. J'ai gâché mon voyage avec ça. Un des profs a bien vu que je n'allais pas bien un matin, je marchais à peine droit, j'avais les yeux vitreux et le teint pâle. J'aimais bien ce prof mais une fois de plus, je n'ai rien osé dire.
Je me suis remise au travail physique dès mon retour. J'avais beaucoup de révisions à rattraper et je pense que c'est ça qui m'a sauvée. J'avais de quoi faire de huit heures du matin à vingt-deux ou vingt-trois heures, et j'étais contente de mon efficacité scolaire. J'ai appris à ne plus m'endormir comme une masse sous les effets des médicaments, mais à apprécier les pensées à la con qui d'habitude empêchent les gens de dormir. J'ai recommencé à apprécier d'avoir une vie normale.
Le pire dans tout ça ? L'enfermement, et l'incompréhension. L'incompréhension face à nos propres actes, face à notre perte de repères totale que l'on subit. Le fait de ne pas savoir comment s'y prendre. L'enfermement avec soi-même, la honte et la peur d'affoler les autres, d'être catégorisée en "toxico". Et aussi, cette peine de voir son portefeuille diminuer, vidé d'au moins trente euros par mois dans des conneries qui ne durent que quelques heures mais qui étaient suffisantes à me détruire de l'intérieur.
Ça fait aujourd'hui tout juste dix semaines que je n'ai rien touché. Deux mois et deux semaines, j'entame la troisième semaine. Soixante-dix-sept jours. Je m'en suis sortie seule et même si parfois j'aimerais bien retrouver cette caresse illusoire du monde de la drogue, je tiens le coup. Je n'y pense presque plus et c'est la plus grande fierté que je traîne pour le moment.
J'ai l'impression que ma dépendance s'est calmée aussi discrètement qu'elle est apparue, et j'en suis contente. Même si je ne prends pas cela pour acquis, jamais, je suis contente de mon parcours.
J'espère pour vous que vous ne perdrez non plus jamais espoir dans votre lutte. On sait ce qu'on risque mais on est les seuls à pouvoir entreprendre une vraie bataille, aidés ou non par des proches, des amis, des médecins. Il n'y a que nous, les drogués, pour faire le travail, et pour ressentir cette fierté incompréhensible du point de vue des autres après un jour sans drogue.
Je tiendrai le coup, et vous aussi.
J'ignore par où commencer. De prime abord, je ressemble à une personne lambda : j'ai bientôt dix-huit ans, j'ai passé mon bac récemment, j'ai des amis proches, je passe mes journées à lire ou à traîner sur mon ordinateur ou mon téléphone : une presque adulte comme toutes les autres.
Mais dans le fond, j'ai vécu ce que je ne souhaite à personne.
Au plus loin que je me souvienne, le début de mon cauchemar date de la classe de quatrième : j'avais 13 ans. J'étais tombée follement amoureuse d'une personne de l'école, mais j'ignore pourquoi, cette banalité a terminé en d'énormes ragots qui se sont transformés en harcèlement vers le mois de mars. En septembre, à ma rentrée en troisième, j'espérais que toutes ces histoires auraient été tassées : mais non, les provocations et rabaissements des autres élèves avaient même décuplé.
Le 25 novembre 2013, j'ai fait ma première tentative de suicide en avalant 8 Ixprim.
Tentative ratée, en effet, en ayant pourtant pris une dose létale pour mon jeune organisme.
Et j'ai continué. Ma mère prenait souvent du Ixprim à l'époque et il y en avait énormément de boîtes, ainsi que le générique de ce médicament, dans la maison. C'était extrêmement facile pour moi d'en prendre, et tout le long de la classe de troisième, je me suis amusée à aller en cours shootée à deux ou trois cachets. La seconde s'est passée de la même manière, avec les mêmes médicaments. J'ai continué après le suicide de mon meilleur ami survenu en mai 2015. Eh oui, à croire qu'à cette période, la terre entière était contre moi. Mais en juillet 2015, j'ai rencontré une fille qui nous a reliées par un coup de foudre réciproque. On est sorties ensemble pendant assez longtemps. Septembre, ma rentrée en première s'est assez bien passée, malgré un changement de lycée qui m'avait bouleversée. Je m'y suis faite, et pour m'aider à supporter les points noirs, j'avais encore les cachets que j'aimais tant, je contrôlais ce que je prenais, et quand je prenais, même si mes doses avaient largement augmenté.
Je ne sais pas quand est-ce que j'ai perdu pied. Mais vers le mois de janvier 2016, je me suis rendu compte que je prenais TOUS LES JOURS en grosse dose mais que le stock de médicaments avait beaucoup diminué : je n'avais presque plus rien. J'ai cherché autre chose, j'ai trouvé de la codéine. J'en ai pris plusieurs mois.
Et plus tard, j'ai trouvé de la morphine dans les tiroirs de ma mère. J'en ai pris aussi, pendant combien de temps, je l'ignore. Beaucoup trop de temps. Une surdose m'a même valu un séjour à l'hôpital après avoir eu un malaise en cours, que j'ai été obligée de faire passer pour un simple excès d'une carence auprès de mes profs ; je ne pouvais pas parler, par peur, par honte surtout. La honte qu'on me prenne pour une folle et qu'on fasse ENCORE des histoires.
J'ai passé le bac de français. J'ai passé mon oral complètement shootée au Ixprim. Pour moi, je me concentrais tellement mieux avec ça, et j'étais nettement moins stressée. Mais vu de l'extérieur, je me dis que c'était pire que tricher. Mon 16/20 ne vaut rien.
Et en juillet 2016, ma copine en a eu marre. Elle n'en pouvait plus et souffrait de me voir ainsi : elle m'a posé le pire ultimatum de ma vie, "c'est ta drogue ou moi".
J'ai fait le mauvais choix. Les trente jours d'essai qu'elle m'avait laissés pour arrêter, ou du moins lui montrer ma bonne foi, on été les pires de ma vie : sevrage forcé du jour au lendemain, je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je suais, tremblais et étais incapable de me concentrer. J'ai pleuré toute la semaine, et ça s'est calmé. Sauf que deux jours plus tard, je suis retombée.
Elle m'a quittée. Et j'ai compris que cette drogue m'avait fait perdre la personne que j'aimais le plus au monde. J'avais fait la plus grosse connerie de mon existence, et je vous promets qu'un an après, j'en souffre encore, une plaie lancinante et suintante qu'aucune pommade ne peut apaiser. J'ai compris que je DEVAIS arrêter. Pour moi, pour elle, pour mes parents qui commençaient à se douter que les médicaments disparus avaient sûrement un lien avec mes malaises à répétition. J'ai essayé d'arrêter début terminale, j'ai subi la semaine de sevrage et j'ai perdu espoir : je n'avais pas de quoi m'occuper la tête et les mains, je ne pouvais plus dormir si je n'avais rien pris dans la journée. Encore quelques malaises en cours, une prof très gentille, très attentionnée qui s'est énormément inquiétée pour moi et à qui aujourd'hui je regrette énormément de ne pas avoir parlé davantage.
Quand j'ai tenté une nouvelle semaine de sevrage, j'ai eu une pensée horriblement douloureuse : ce n'était pas arrêter que je voulais, mais simplement ne jamais être tombée dedans.
Il n'y avait plus énormément de stock de médicaments chez moi. Alors je gardais l'argent de poche que me donnait ma mère pour parer aux éventualités en ville, il m'est même arrivé parfois de ne pas manger du tout à midi pour garder l'argent et aller dans une pharmacie, demander deux ou trois boîtes de Prontalgine pour supporter la semaine. Je me sentais à la fois ridicule et puissante dans ces moments-là.
Le mois dernier, j'ai passé mon bac. Je rêvais tellement de décrocher ce diplôme avec mention que j'ai mis toutes les chances de mon côté : j'ai commencé à travailler sérieusement dès le mois de mars, j'ai révisé quasiment chaque soir, et entre mars et fin avril, il me semble avoir assez bien tenu le coup : quelques dérapages mais je m'étais relevée.
Le 23 avril, après environ 5 semaines de force, j'ai craqué pour aucune raison. Je partais en voyage scolaire et nous étions à peine arrivés dans notre hôtel à Prague que j'ai craqué : j'avais avec moi une boîte d'ibuprofène censée contrer d'éventuels maux de tête, elle s'est vidée en deux jours.
J'avais honte de ce que j'avais fait. J'ai gâché mon voyage avec ça. Un des profs a bien vu que je n'allais pas bien un matin, je marchais à peine droit, j'avais les yeux vitreux et le teint pâle. J'aimais bien ce prof mais une fois de plus, je n'ai rien osé dire.
Je me suis remise au travail physique dès mon retour. J'avais beaucoup de révisions à rattraper et je pense que c'est ça qui m'a sauvée. J'avais de quoi faire de huit heures du matin à vingt-deux ou vingt-trois heures, et j'étais contente de mon efficacité scolaire. J'ai appris à ne plus m'endormir comme une masse sous les effets des médicaments, mais à apprécier les pensées à la con qui d'habitude empêchent les gens de dormir. J'ai recommencé à apprécier d'avoir une vie normale.
Le pire dans tout ça ? L'enfermement, et l'incompréhension. L'incompréhension face à nos propres actes, face à notre perte de repères totale que l'on subit. Le fait de ne pas savoir comment s'y prendre. L'enfermement avec soi-même, la honte et la peur d'affoler les autres, d'être catégorisée en "toxico". Et aussi, cette peine de voir son portefeuille diminuer, vidé d'au moins trente euros par mois dans des conneries qui ne durent que quelques heures mais qui étaient suffisantes à me détruire de l'intérieur.
Ça fait aujourd'hui tout juste dix semaines que je n'ai rien touché. Deux mois et deux semaines, j'entame la troisième semaine. Soixante-dix-sept jours. Je m'en suis sortie seule et même si parfois j'aimerais bien retrouver cette caresse illusoire du monde de la drogue, je tiens le coup. Je n'y pense presque plus et c'est la plus grande fierté que je traîne pour le moment.
J'ai l'impression que ma dépendance s'est calmée aussi discrètement qu'elle est apparue, et j'en suis contente. Même si je ne prends pas cela pour acquis, jamais, je suis contente de mon parcours.
J'espère pour vous que vous ne perdrez non plus jamais espoir dans votre lutte. On sait ce qu'on risque mais on est les seuls à pouvoir entreprendre une vraie bataille, aidés ou non par des proches, des amis, des médecins. Il n'y a que nous, les drogués, pour faire le travail, et pour ressentir cette fierté incompréhensible du point de vue des autres après un jour sans drogue.
Je tiendrai le coup, et vous aussi.
Hors ligne

- Recklinghausen

- Adhérent PsychoACTIF
- Inscrit le 09 Mar 2015
- 6185 messages
Salut,
Merci pour ce partage de cette tranche de vie.
Malheureusement, le forum, pour une question de législation, n'est pas ouvert aux personnes mineures.
Ton compte va donc être mis de côté et tu vas être banni jusqu'à ce que tu passes le cap des 18 ans... Ce qui ne devrait pas être trop long d'après ce que j'ai compris.
Je t'engage à contacter un modérateur ( une personne en rouge ) que tu pourras trouver dans la rubrique " Qui sommes nous " afin de lui donner le jour de ta majorite afin que ton compte soit à nouveau ouvert à cette date.
En attendant, si tu ressentais une déprime, voir un debut de dépression qui pourrait s'expliquer par l'arrêt des opiacés et en particulier du Tramadol ( qui a un effet sur la recapture de la serotonine comme les AntiDepresseurs ), je te conseille de prendre rendez vous dans un CSAPA.
n'hésite pas à signaler que tu souhaites que tes consultations restent anonymes.
Tu y trouveras une batterie de professionnels des addictions qui pourront t'être d'une aide précieuses dans le cadre de ton sevrage de produits psychotropes.
Prends soin de toi et à dans quelques temps, lorsque la barre des 18 ans sera franchie.
Porte toi bien en attendant,
Reck.
Merci pour ce partage de cette tranche de vie.
Malheureusement, le forum, pour une question de législation, n'est pas ouvert aux personnes mineures.
Ton compte va donc être mis de côté et tu vas être banni jusqu'à ce que tu passes le cap des 18 ans... Ce qui ne devrait pas être trop long d'après ce que j'ai compris.
Je t'engage à contacter un modérateur ( une personne en rouge ) que tu pourras trouver dans la rubrique " Qui sommes nous " afin de lui donner le jour de ta majorite afin que ton compte soit à nouveau ouvert à cette date.
En attendant, si tu ressentais une déprime, voir un debut de dépression qui pourrait s'expliquer par l'arrêt des opiacés et en particulier du Tramadol ( qui a un effet sur la recapture de la serotonine comme les AntiDepresseurs ), je te conseille de prendre rendez vous dans un CSAPA.
n'hésite pas à signaler que tu souhaites que tes consultations restent anonymes.
Tu y trouveras une batterie de professionnels des addictions qui pourront t'être d'une aide précieuses dans le cadre de ton sevrage de produits psychotropes.
Prends soin de toi et à dans quelques temps, lorsque la barre des 18 ans sera franchie.
Porte toi bien en attendant,
Reck.
L'amour d'une famille, le centre autour duquel tout gravite et tout brille.
Hors ligne
Sujets similaires dans les forums, psychowiki et QuizzZ
 |
146 | |
 |
31 | |
 |
[ Forum ] Nouvelle Hospitalisation
|
3 |
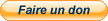 Soutenez PsychoACTIF
Soutenez PsychoACTIF