Vomir
Je tenais à le partager gratuitement pour les usager.es de drogues. Le voici.
VOMIR.
Entre le vendredi 3 juillet à 22h et le dimanche 5 juillet aux alentours de 4h du matin, dans une rave party bas de gamme où le tempo n’a pas dépassé 115 bpm, j’ai volontairement administré à mon organisme le traitement suivant, dans cet ordre et ces quantités : 1 gramme de cocaïne, 1 ecstasy, 1/2 gramme de kétamine, 1 deuxième ecstasy, quelques traces encore de kétamine, 1 deuxième gramme de cocaïne, 1/2 gramme d’héroïne. Le tout accompagné par l’ingestion quasi constante d’alcools divers, d’un flacon de popers et des mystérieux produits de coupe traditionnels.
- Jour 1 -
J’ai erré et vomi quatre jours et quatre nuits avant de trouver la force d’aller m’effondrer aux urgences. Fanny a dit que j’étais pas loin de l’arrêt cardiaque, elle m’a mis sous perfusion pour me réhydrater, j’étais tout sec. Rien gardé depuis la « fête ». Fanny a enfoncé une sonde à l’intérieur de mon sexe pour relier ma vessie à un tuyau en plastique. Elle a dit « Respirez, c’est pas grave si je vous stimule et que vous bandez, on a l’habitude ». J’en étais pas vraiment là dans mes considérations. Entre autres choses, les résidus de ma masculinité généraient un sentiment de complète profanation. Terreur phallique de base. Je suis tombé amoureux direct de Fanny, quelle douceur au milieu du chaos ! Quel professionnalisme. J’ai envie de croire qu’il s’est passé un truc réciproque à ce moment là. Une intensité certaine dans les regards en tout cas. Quel boulot. Quand tout ça sera fini, je l’inviterai à boire un cocktail sans alcool. C’est pas si mal comme début de relation. Ça nous évitera les pudeurs habituelles.
Les premières heures sont confuses. « Ça fait combien de temps que vous avez pas uriné ? » Merde je sais plus. J’étais pas concentré la dessus, aucune idée. J’avais plutôt tenté de déféquer sans succès les jours précédents, mais tout sortait par en haut donc je me disais normal. Je sens qu’ils paniquent autour de moi « il a 950 de créatinine ». Je suis paumé total et je panique. J’entend passer « greffe de foie », « ça te va qu’on échange de pause ? A 11h30 y’a mon mec qui passe. » Et aussi « wesh ils sont graves les patients aujourd’hui ».
Elle vient me parler pour mettre un peu d’ordre. « Bonjour je suis Fanny. Vos reins ne fonctionnent plus, votre foie est gravement endommagé. On va vous emmener en réanimation. » Le mot résonne dans ma tête. Depuis des mois de Covid-19 on en entend parler de la réanimation, ça sonne comme une menace mise à exécution. Mon père est là, ma mère arrive en panique depuis la Normandie - ça fait déjà plusieurs heures que je suis étalé dans la Vip Room des urgences - elle a des yeux que je ne lui connais pas, exorbités. Je réunis toute l’énergie dont je dispose pour sourire. « Coucou maman, t’inquiète - c’est la formule consacrée -, dis toi que là tout de suite je vais mieux que toi ».
La réanimation est un service de luxe. Une chambre par personne, télé gratis. Tout est complètement stérilisé, plus propre que monsieur propre. J’y arrive au terme d’un rallye dans les couloirs de l’hôpital, accompagné par Fanny et brancardier-schumacher qui me laissent entre de bonnes mains. Immédiatement, cinq jeunes femmes entre vingt-cinq et trente ans m’entourent et me parlent, m’examinent, me tripotent, me rassurent, me font des blagues. Embrumé par le délsir je crois monter plus haut que l’étage de la réa, je crois que c’est le ciel et que voici ma récompense. Je suis un kamikaze de la techno, j’ai mené le djihad du caisson et voilà la paix !
« On va vous poser un cathéter pour faciliter les prises de sang, on commence par une petite anesthésie locale. Ça vous dit de mettre un peu de musique sur votre téléphone pour vous décontracter ? » Je met Roudoudou - Peace and Tranquility to Earth. Chef d’oeuvre de simplicité. Il paraît que le type a vécu dans la galère pendant dix ans avant de toucher les droits de sa chanson, qui lui avait été piquée pour des génériques de télé et de radio. Je pense furtivement à l’album génial que je sortirai un jour et je me dis qu’en plus d’une paire d’enceintes je garderai un peu de fric sur mon prêt étudiant pour me payer un avocat, au cas où.
Pour l’instant il faut survivre. On m’aide à rationaliser. « Vous êtes complètement déshydraté. Votre fonction rénale est à plat. On attend de voir si vous pissez dans les heures qui viennent, sinon on sera obligé de vous dialyser. Les drogues que vous avez ingérées ont aussi endommagé le foie, vous faites une hépatite aigüe. On va faire entrer vos parents. Vous êtes majeur vous avez le choix, est-ce qu’on peut parler ouvertement avec eux de ce qui s’est passé ? » Je leur dis que oui bien sûr on n’en n’est plus là, sauf pour l’héro le dites pas à ma mère ! Surprenante pudeur dans le détail. Peut être qu’il faut conserver un garde fou, un palier, ne pas avouer que c’est le fond.
On se touche, on se rassure mutuellement, chacun de nous trois essayant de garder la tête plus froide que les autres. Rapidement on est fixés, le médecin entre. Une femme d’une cinquantaine d’années, que je dirais Iranienne, au regard profond, sérieux et fiable. Je lui voue immédiatement un respect démesuré, et m’accroche à chacune des ondes acoustiques qui émanent de sa bouche. Le verdict tombe sans délibération, sans qu’on m’ait déclaré mes droits ni proposé un avocat - la médecine n’est pas un régime démocratique, j’y reviendrai. Chef d’inculpation : nécrose tubulaire aigüe. Peine : trois à six semaines. Les reins ne fonctionnent plus du tout mais ils devraient repartir d’eux mêmes, c’est ce qu’il se passe dans la plupart des cas.
Il faudra s’habituer à ces « presque toujours », ces horizons funestes que laissent constamment planer les médecins, pesant chaque mot, la mort rodant toujours dans les ombres de leurs déclarations. « Le foie on attend de voir, on fait un bilan demain matin ». Plus tard j’apprendrai qu’à ce stade les médecins avaient parlé de greffe à mes parents, sans l’évoquer devant moi.
C’est une interne qui entre à son tour pour me dialyser. Elle semble avoir mon âge, elle m’impressionne et me plaît immédiatement. Des traits fins, des yeux verts magnifiques au dessus du masque chirurgicale. Des gestes précis, rapides et sûrs d’eux dans cette combinaison high tech et encombrante, de mise dans le bloc stérile. « Bonjour je suis XXX, l’interne de garde ce soir. je vais vous poser un cathéter fémoral. »
C’est déstabilisant ce formalisme avec lequel elle s’adresse à moi. Je me dis que dans des circonstances différentes on aurait pu se sourire, se démasquer. On aurait pu se rencontrer autour d’un verre dans un bar à Ménilmontant, elle ayant un peu dévié de sa rive gauche - elle a la bourgeoisie dans les yeux - et moi m’étant fait traîner à contre coeur depuis notre île par Nadjim qui est en week end le mardi soir et a décrété qu’on devait s’aligner sur lui. On se serait tutoyé, elle aurait dit j’finis médecine, j’aurais dis j’finis mon gramme.
Elle dit quand même « Qu’est ce que vous faites dans la vie ? ». C’est une question qui reviendra souvent, quasiment à chaque contact avec un nouveau soignant, et me mettra à chaque fois dans la même merde. L’erreur est de l’entendre littéralement, alors que ce qu’elle formule en réalité c’est « quelle place occupez vous dans la production sociale ? »
J’ai envie de lui dire la commune ! Que je persiste dans mon être. Que je vis avec des métaphysiciens qui conjurent le chaos, des guerriers sans visages qui creusent des tunnels et des brèches autour du monde, préparent l’apocalypse en essayant de la précipiter. Que je suis musicien stratège, zonard de formation. Que je-on gratte les bourses des facs pour préparer des grands banquets auxquels tout le monde est invité. Que je-on visite les porosités des mondes visibles et invisibles, des mondes plus ou moins légaux.
Je dis « J’essaye de m’organiser. » Tu parles ! Le type est déjà complètement dés- organisé d’un foie et deux reins. Je crois lire dans son regard une certaine circonspection. « Encore un branleur paumé qui rêve sa vie en merco. Il a même l’air de se trouver intéressant » semble-t-elle penser. La réalité se situe certainement quelque part entre ces deux points de vue.
Je me permets de lui demander son âge. Elle a 26 ans, moi 24. Pour finir médecine si tôt, elle a dû tracer sa vie sans regarder derrière. Elle a dû comprendre très vite les enjeux, ce qu’on attendait d’elle et le cahier des charges qu’il fallait qu’elle remplisse. Je la regarde et je me pose mille questions sur ses questions. Comment a-t-elle décidé sans détour qu’elle passerait sa vie à faire des trous dans des corps ? A s’occuper de la viscosité des organes des autres, dans le sang et la peur, à sinuer dans les couloirs froids et inhospitaliers de l’hôpital ? Elle a dû sacrifier beaucoup pour ça. C’est pas comme si c’était l’usine à seize ans, elle a dû faire une sorte de choix. Abnégation chrétienne super - héroïnisée ? Un amour adolescent pour le docteur House ? Peut être pas, sans doute qu’elle a de bien meilleures raisons, ou alors qu’il ne faut pas chercher plus loin que la pure reproduction sociale, que la question n’existe pas sur l’autoroute du déterminisme.
Écographie de l’aine pour trouver l’artère fémorale. La sonde glisse sur une sorte de lubrifiant gluant, à quelques centimètres à droite de ma vessie, cette dernière toujours câblée à une poche où je commence à apercevoir quelques gouttes d’un liquide orange sombre. Sur l’écran, je vois danser des masses abstraites en nuances grises. C’est fou comme rien n’a l’air solide là dedans ! Il n’y a que bulles en mouvement dont j’entends presque la musique poisseuse. Tu parles d’un corps, cet agencement complètement étranger et déstructuré dont je ne sais rien... Aïe sa mère ! L’aiguille a percé l’artère, dans le creux de l’aine, elle remue à l’intérieur pour chercher à bien s’y ancrer. « Ne regardez pas ». Je regarde : le sang pisse d’un jet puissant sur l’interne et je le sens couler dans mon entrejambe, jusqu’à se loger à intérieur de mon cul. Une flaque abondante et glacée. « C’est bon, c’est bon on y est ».
L’aine est maintenant pénétrée par un large tuyau en plastique, que la doc relie à la méga-machine à dialyse. Cette dernière aspire mon sang en continu, le fait passer dans un rein artificiel de couleur bleu qui le nettoie et me le renvoie dans un deuxième tuyau parallèle, m’irriguant à nouveau. C’est mon nouveau meilleur copain pour un petit bout de temps, ce vampire en forme de juke-box.
La première nuit est vertigineuse. La porte se referme après qu’on m’ait déposé un plateau contenant diverses bouillies. Je fais un point sur la situation. Je me rends compte que je suis totalement immobilisé. J’essaye de me redresser légèrement sur le lit, j’ai toutes les peines à y arriver. Depuis que je me suis étalé au matin sur le brancard des urgences je n’ai pas réellement essayé de bouger. Je me suis laissé porter déplacer soulever manipuler anesthésier retourner perforer profaner j’ai dit oui et non et fait la liste des ingrédients de mon cocktail magique c’est à peu près tout. Je prend conscience que je suis paralysé du bas du corps et du buste. Je peux seulement bouger les bras et la tête. Eeeet la têêête, eeet la tête !
Je suis ultra-connecté, un homme moderne ! Sur l’avant bras gauche, le cathéter avec réserve de sang pour faciliter les analyses. A creux de mon bras droit, l’aiguille qui me lie à la perfusion d’eau et de sucre qui continue de me réhydrater, au dessus presque à l’épaule le brassard de prise de tension qui s’active automatiquement tous les quarts d’heure, lui aussi relié à une méga-machine. Plus bas donc, le cathéter fémorale qui aspire mon sang depuis l’aine jusqu’à la dyalise, et cette saleté de sonde urinaire qui loge toujours dans ma bite, qui commence à me brûler terriblement quand je pisse trois gouttes de ce liquide incertain. Et sur mon gros orteil droit, tout au bout du lit, l’espèce de pince à linge électrique dont j’ignore la fonction exacte.
J’ai le dos écrasé qui me brûle partout, impossible à bouger. J’habite une planète où la gravité est multipliée par dix. Partout autour des robots poussent des cris inquiétants, des bip bip et des tuuut qui me font sursauter. Un vrai concert de musique concrète, électro minimaliste trans-humanisée, featuring un Vjay qui envoie mes fréquences cardiaques en visuel. Scénographie léchée. Je suis humain augmenté, c’est mon devenir-cyborg ! Je suis docteur Octopus avec ses bras métalliques escaladant les building de Manhattan le cul dans le nez à Time Square. Puissance diminuée mais techno-remorquée, j’ai enfin une machine-organe. Dieu merci le progrès n’en est pas encore à nous soigner en bluetooth. Je suis complètement exalté. Enfin la libération ! Qu’est ce qui aurait pu m’arrêter sinon ça ? La mise en scène essaye de me faire croire que je suis malade, que c’est un moment d’une gravité absolue, mais je commence à comprendre que c’est tout l’inverse : la début de la possibilité d’une rémission. Là, avec trois organes vitaux sur six en congé, à 50% de vitalité observable, je fais l’expérience de la plénitude. C’est le Blast ! La première nuit de ma nouvelle vie, qui sera diurne et salvatrice. La maladie c’était avant, c’était la décennie que je viens de passer défoncé. A moi les levés de soleil ! J’ai hâte de me rencontrer. De commencer à devenir. C’est la fin d’un voyage et le début d’un autre : j’ai couru à toute allure vers mes propres frontières en ignorant mes territoires. Traverser des mondes sans jamais me sentir chez moi, voyager sans rien ressentir, it’s over. Je ne veux plus rien anesthésier, la douleur est salutaire. Je ne veux plus mentir. Je vais me raser la tête, devenir gros. Énorme ! Nager dans la mer pour tout nettoyer, affronter tout car je ne sais rien. J’arrive au début du désert et je m’apprête à le traverser. Je me sens en paix. C’est le début de l’effet cathartique.
Un évènement plus prosaïque me fait redescendre sur terre : une infirmière entre pour me faire un lavement. N’ayant pas déféqué depuis cinq jours, ils ont décidé que je devais forcer la barricade. Elles s’y prennent à deux pour me tourner sur le côté gauche et m’enfoncer dans les fesses cette sorte d’énorme seringue qui injecte une vague de produit pour me liquéfier de l’intérieur. Elles placent une bassine en métal en dessous pour en récolter l’écume et me reposent par dessus. « Serrez les fesses pendant cinq minutes ». J’exécute. C’est radical : une dizaine de minutes plus tard, j’ai l’impression que c’est mon corps tout entier qui devient rivière. J’inonde. Ça empeste et je suis plus que gêné de devoir appeler l’infirmière pour qu’elle me libère de mon trône aquatique. Elle me torche le cul et je me dis que je ne sais pas de sa position ou de la mienne laquelle est la moins désirable. Sa main à l’intérieur de moi abolit mes dernières prétentions, je comprends que pour un moment il va falloir laisser de côté toute ambition à la dignité.
La première nuit je ne ferme pas l’oeil une minute, le corps douleur et l’esprit zigzag.
Le premier rayon de soleil est délicieux.
- JOURS 2 à 21 -
La drogue est un mensonge magnifique.
Dans l’adversité, l’issue la plus proche et la moins salutaire.
Le meilleur du pire de l’empire du divertissement.
La marchandise parfaite.
Walt Disney World dans les marges.
C’est la domination qui nous masse.
Le capitalisme qui nous masturbe.
Et moi qui jouit tranquillement.
Lo avait ses fesses dans l’avion avant même que j’ai eu le temps de comprendre ce que c’était, des reins - parce qu’en dehors de vieux souvenirs de mon grand père se plaignant des siens, j’en n’avais jamais vraiment entendu parler. Elle a atterri à Roissy et puis elle est montée à l’arrière d’une moto-taxi pour tracer jusqu’à la porte de Montreuil, direction l’hôpital de la Croix Saint Simon. Quand elle est entrée les larmes sont sorties d’un coup, j’ai rien pu empêché. Lo, c’est la personne avec qui je ne peux que m’abandonner. Avec qui tout devient simple. Avant on était ce qu’on appelle un couple, reproduisant des formes qui ne lui sont pas propres, avec tout ce que ça implique de normativité, de névroses et d’exclusivité-trahison. Surtout, un rapport hétéro-patriarcal dans lequel trop souvent elle prenait la place du soin, et moi du risque. Une mauvaise balance dans l’écoute et l’attention dans laquelle j’ai été négligent, et l’ai fait souffrir. Honte aujourd’hui. C’était la sortie du lycée et ça a duré trois ans. A travers ça je crois qu’on a quand même réussi à devenir des alliés, et aujourd’hui pour ma part, en m’étant désaliéné, j’ai ré-appris à l’aimer. Chacun de nous deux vit ses amours, ses sexualités diverses, mais l’évidence reste que la priorité c’est nous. Chacun pour l’autre. On ne couche plus ensemble, au sens scolaire, mais nos corps font des noeuds dans la plus grande des proximités. On se pénètre autrement. Il n’est pas question ici de « relation non-exclusive polyamoureuse », ou je ne sais quelle autre rigidité de gauchistes, ces universitaires du désir qui veulent tout stratifier. Au sujet de qui nous sommes, Lo et moi, je préfère ne rien dire, ne rien instituer. La forme du lien, puisqu’elle est vivante, est en mutation permanente.
Alors que sa mère est gravement malade et qu’elle doit s’occuper d’elle depuis deux ans, elle a sauté dans l’avion sans hésiter, pour passer d’un chevet à un autre. Elle s’assoit à côté de moi et tout s’apaise. Je jure que c’est la dernière fois que cette scène se joue.
On vous ment. Dieu est issu d’un laboratoire. Je l’ai rencontré. Il s’appelle C20H25N30, ou diéthyllysergamide. Il s’appelle diacétylmorphine, et 3,4 méthylènedioxy-N- méthylamphétamine. Il est connu sous plusieurs noms, mais règne sur un monde unique. Ses apôtres sont des chimistes et vivent dans des tours HLM, ils prônent une foi sans spiritualité. Quid des rencontres mystiques ? Nada, Queutchi ! L’Opium, c’est la religion du Bloom.
-
On me transfère. Les résultats hépatiques sont encourageants : mon foie récupère. Direction la chambre 513 dans le service de néphrologie de l’hôpital André Grégoire, à la frontière entre Montreuil et la Boissière. Dans l’ambulance j’ai le droit au sermon de l’infirmière. « Vous avez eu de la chance ». Ouais.
-
Ambiance plus relâchée, plus sobre. Fenêtre bloquée, rideau cassé, lumières qui clignotent ambiance stroboscope. Je constate comme j’ai déjà pu le constater qu’il existe une gamme de couleurs caractéristique des lieux officiels du soin, de l’éducation et du bien être, qui produit le sentiment exactement inverse de celui qu’elle est censée provoquer. Les hôpitaux, les crèches, les maternelles et les centres d’addictologie ont en commun d’être recouverts de ces verts pastels, de ces oranges mornes choisis par des esprits maléfiques en burn-out qui ne savent plus comment déguiser l’ennui.
Green-washing de la dépression chronique de l’époque révélant la sensibilité défaillante d’un système de soin nécrophobe.
-
Le pire à ce stade c’est le dos, ils refusent toujours de me donner des anti-douleurs, ces derniers étant traités par le foie et les reins, trop faibles pour encaisser un doliprane. La blague ! Après toutes ces années de surcharges chimiques hardcore, l’homéopathie pourrait me tuer.
-
Il y a la drogue en pente douce. L’anesthésie quotidienne. L’alcool, les benzodiazépines et les cigarettes qui adoucissent juste ce qu’il faut l’obscurité pour pouvoir s’endormir. Et puis il y a les pentes plus dures : les marathons. Les week-ends sans fin que les stimulants transforment en semaines où les jours sont des nuits les nuits des années où les poudres sont blanches les cailloux transparents qui s’enchaînent sans qu’on ne les distingue plus et encore et encore et boom boom la techno on ne danse plus c’est l’after de l’after chez des inconnus ils sont débiles je les supporte pas mais ils ont de la coke et encore deux ou trois phrases à articuler et puis quelques syllabes et puis plus rien du tout plus d’endurance fatigué au bout du corps je rampe je vomis je m’écroule et puis plus jamais ça j’le jure cette fois j’ai compris tu parles mon cul.
Un de ceux là qui m’a amené ici.
-
Dans le brouillard, les premiers jours, j’appuie sans arrêt sur la télécommande qui appelle les soignants. Étant paralysé, je n’ai aucune autonomie et j’ai besoin d’aide pour me redresser, pour manger, pour monter la couverture sur moi qui est juste à mes pieds parce que j’ai froid, pour partir en quête impossible de cacas introuvables, et j’ai mal, j’ai mal et je les harcèle pour qu’ils me donnent de l’accupan, seul antidouleur auquel j’ai droit qui ne fonctionne qu’à moitié. Bref un vrai relou. J’ai été amené en ambulance direct dans la chambre et n’en sors jamais. Je divague à l’intérieur de moi même et au début j’ai à peine conscience d’être dans un service qui contient plusieurs dizaines de chambres et que je ne suis pas seul. Je met du temps à comprendre qu’il existe toute une économie de l’attention dans laquelle il faut la jouer fine. Laisser les infirmières s’occuper tout le monde, ne pas trop les saouler, autant pour elles que pour moi, puisque plus j’appelle moins elles viennent.
Surtout, il faut capter que tout fonctionne ici selon un protocole rigoureux. Les médecins, les infirmières et les aides soignants n’ont pas les mêmes blouses, il faut les identifier selon la couleur de leurs habits : blanc pour les médecins, jaune canari pour les infirmières, vert pour les aides soignants. Chacun passe chaque jour à une heure précise pour effectuer ses taches propres et on ne peut pas poser n’importe quelle question à n’importe qui, à n’importe quel moment, sous peine de subir une rafale de mépris. Inutile demander un médicament à une infirmière, qui n’a rien le droit de prescrire, ou de signaler à un médecin qu’on ne m’a pas donné de couverts avec le plateau repas. C’est une aide soignante qui me donne le déclic quand je lui demande à quel moment je pourrai marcher : « Je vous amène un canari ! ».
-
Je ne suis pas victime, je paye mes dettes. Toute cette non-aventure a été contractualisée. La drogue est une agence de voyage qui ne fonctionne qu’à crédit. La banque centrale des plans de relance à très court terme. Le plus insipide des guides touristiques, plus faux cul que ceux qui baratinent la bourgeoisie internationale dans l’ouest de paname.
-
Une nuit, je tombe sur une infirmière qui a dû mal lire mon dossier, elle est OK pour me filer un tramadol 50, dérivé morphinique contre-indiqué pour mon hépatite mais je saute sur l’occasion, peut être que si mon dos est soulagé je vais enfin pouvoir dormir, ça fait trois jours. Mauvais calcul. Le manque de sommeil, l’état de choc et la drogue font mauvais ménage. J’appelle Lo dans la nuit en panique, je sais pas trop ce que je lui raconte. J’ai des sales hallucinations, et pas du genre qui fascinent. Des formes psychédéliques se dessinent toutes seules dans mon esprit, des millions de détails d’une géométrie macabre qui tirent en rafales sur mes neurones, même les yeux fermés. Tout est liquide, tout coule. La chambre tourne sur elle même et chute dans un abîme intérieur. J’ai la gerbe. J’ai peur... et finis par m’endormir, enfin.
-
Apparemment, ils ont échangé mon nom et mon prénom aux admissions. Tout le monde m’appelle « Monsieur Simon ». C’est parfait, je me garde bien de toute rectification.
-
Un « pote » par sms : « Yo Simon j’ai appris ce qui t’arrive, j’espère que ça va aller. Sinon, j’ai besoin d’un plan GHB ou GBL pour un plan escort ce soir, t’aurais pas un contact ? ». Ça permet de faire un peu le tri, cette histoire.
D’autres, beaucoup d’autres, desquels je n’attendais pas spécialement d’attention, manifestent leur amitié. Je reçois quantité de messages auxquels j’ai du mal à répondre, et sens une énergie énorme qui se met en place autour de moi. Ça me fait du bien et m’effraie un peu. Je commence à apprécier la solitude.
Des amis sont remontés du plateau de Millevaches pour me voir. « Monsieur Simon, de la visite pour vous ». Trop mignons tous les quatre qui entrent dans ma chambre en marchant sur des oeufs. On parle beaucoup, ça fait longtemps que j’avais pas autant parlé. J’ai du mal à suivre, je me perds un peu. Eux : le squatt, le potager, le bébé de C et T qui vient de naître, le mouvement contre les violences policières. Moi : la quête permanente des intensités et ses écueils, qu’on ne prête pas assez attention à la magie de notre organisme quand il fonctionne, qu’on devrait s’émerveiller de tous les pipis. Suite à ça je les vois tous, l’un après l’autre, aller pisser solennellement, le regard grave. Trop mignons. Avant de partir, H conclut : « Faudra le dire à Deleuze, le corps sans organe, ça marche pas ! ».
-
C’est la deuxième fois que je suis malade dans ma vie. Il y a quinze ans, j’avais fait de l’hyper-pression intracrânienne, une maladie cérébrale. Après sept ponctions lombaires et après m’avoir shooté à la cortisone pendant six mois à cause d’une erreur de diagnostique - ils pensaient que j’avais chopé la maladie de Lyme - ils ont finalement découvert qu’il fallait juste me faire pisser beaucoup pour évacuer mon liquide céfalo- rachidien. J’avais donc été mis sous diurétiques. Deux fois que je suis malade, deux fois qu’il faut juste que je pisse, alors que j’ai la réputation auprès de mes potes de pas pouvoir faire République - Gare du Nord sans faire une pause, à cause des canettes d’Heineken.
-
La sonde urinaire est devenue mon ennemie numéro un. J’ai développé un oedème sur le sexe, sorte de troisième testicule qui a poussé juste en dessous du gland, poche d’eau monstrueuse que je regarde le moins possible mais qui continue d’enfler. J’ai la bite à Elephant man. La tige de plastique à l’intérieur de la verge que je sens en permanence n’est pas le pire. Le pire c’est quand malgré moi je bande, la nuit souvent, et ça me réveille, cet espèce de boomerang difforme qui se dresse dans le désir et la douleur simultanément. Le pire c’est quand mes reins se décident à produire quelques gouttes d’urine, qui doivent passer par ce conduit pour aller s’échouer dans la poche en plastique que je garde à côté de moi, attendant plein d’espoir qu’elle se remplisse. A ce moment je hurle, littéralement. Je crois que j’ai jamais eu de douleur quantitativement similaire. Tout mon « arbre uro-génital » prend feu. Je crois que ma queue va s’arracher, exploser, qu’un bébé dragon va en sortir, mais rien d’aussi spectaculaire ne se produit. Seulement trois gouttes de pisse rouge sang. Moment terrible et merveilleux à la fois, puisque c’est le marqueur principal de la reprise de ma fonction rénale. Je sers les dents et exulte intérieurement. Pisse, Forest, pisse !
-
Mon voisin de la chambre d’à côté est obèse ET sourd ET claustrophobe. Qualités qui auraient pu me le rendre sympathique si elles n’étaient pas accompagnées d’un goût prononcé pour les émissions de télé les plus débiles. Résultat, toute la journée dès 7h du matin, il est étalé devant l’aquarium dont il règle le son au maximum en laissant sa porte ouverte en grand.
Pour l’instant je suis seul en chambre mais le lit vide à côté de moi est menaçant. Un des cousins de l’autre pourrait débarquer.
-
A l’aridité de l’existence métropolitaine répond la recherche frénétique de l’intensité. Dans sa forme la moins créative : l’extase. Une fête, une émeute ont conjuré le néant. On cherche à entretenir un feu à partir d’étincelles trop rares, jusqu’à la pire des parodies. Tout comme la publicité qui ne vend que l’intensification de l’existence, la drogue parle le
langage du vide. Elle le chante.
Comment sauver l’intensité ? Comment reconstruire des ivresses authentiques, qui vaillent la peine qu’on se batte pour les défendre ?
-
L’hôpital est un dispositif qui génère son propre communisme. Entre patients on se regarde, on se reconnait. Sauf ceux qui ne voient plus, dont l’esprit divague. Pour des raisons différentes nous partageons une situation commune qui efface temporairement toutes nos autres appartenances. Nul compte en banque ne permet d’éviter les petites humiliations quotidiennes. On chie dans les bassines, on avale ce qu’on nous prescrit, on méprise les médecins qui nous parlent comme à des enfants passifs, on peste contre leur protocole. Prend garde monsieur, nos corps sont avachis mais nos âmes se redressent !
-
Si parfois j’ai la haine contre les infirmières, si elles me laissent dans la douleur plusieurs heures ou me parlent comme à un débile, je comprend surtout qu’elles font un métier impossible. Et qu’il y en a, des débiles, chez les patients. Je les vois arriver à 6h30 le matin pour celles du jour, et repartir à 19h. Trois ou quatre jours par semaine. 18h30 - 7h pour celles de la nuit. A deux par roulement pour s’occuper de tout le service. En plus de leurs tâches normales de prises des constantes, d’interventions médicales diverses et de livraison des repas, c’est chacun d’entre nous qui a tout le temps besoin de quelque chose, qui a mal aux cheveux ou juste envie de se plaindre. Et elles, toutes des femmes sans exception, racisées pour la plupart, assignées à ce rôle de soin, souvent pour des hommes qui n’ont aucune considération. Je les entends crier contre elles, exiger de l’attention. A partir du moment où je reprend un peu de forces, un peu mes esprits, j’essaye au maximum de me faire petit.
Une infirmière que j’aime bien, la soixantaine et quasi obèse, que j’entends un matin à travers la porte parler à sa collègue qui lui demande comment ça va ce matin. « Oooh, ben comme un matin où j’ai dormi trois heures, hein ! Mon mari qu’a cru qu’il était un cochon toute la nuit t’sais - rrrrrrrrrrr, elle imite le grouinement d’un porc - j’avais envie de l’assommer ! »
Mais assommez, madame ! Assommez !
Je n’en hais qu’une seule. Une nuit que j’ai besoin d’aller aux toilettes, je sonne. Elle arrive déjà vénère, je la sens pas. Je demande de l’aide pour me lever et cheminer jusqu’à la porte qui est à deux mètres. Elle va simplement chercher le déambulateur dans l’angle de la chambre et le pose devant moi en croisant les bras. Au prix d’une contorsion lente et douloureuse je parviens à me mettre debout et à agripper le déambulateur. Elle ouvre la porte des toilettes et se casse sans un mot, me laissant dans un équilibre plus qu’incertain avec ma poche à pisse dans les bras, paniqué. Saloperie. Je titube centimètre par centimètre jusqu’au chiotte - trois bonnes minutes -, hurle un bon coup quand sortent les trois gouttes rituelles, tire la chasse et parvient à revenir dans mon lit, avec le sentiment d’être Ulysse enfin rentré à Ithaque. Et là malheur, j’ai oublié d’éteindre la lumière des toilettes qui m’éblouit et m’empêchera sans doute de dormir toute la nuit. Avec appréhension, je rappelle donc l’infirmière. Elle pète littéralement un plomb : « Monsieur vous nous manquez de respect là ! Y’a pas que vous ici ! Vous allez apprendre à nous respecter maintenant parce que moi j’ai pas que ça à faire, merde ! » Avec dans le ton une malveillance absolue. Je sens dans son regard qu’elle me méprise au plus haut point, que je ne suis à ses yeux qu’une petite chose fragile et répugnante. C’est ça, je la dégoûte ! Elle m’a agressé. Je reviendrai lui faire du mal.
-
Petite rétrospective
Premier souvenir de drogue : j’ai 7 ans. On me donne un somnifère parce que je fais des insomnies. Mais je refuse de dormir et rapidement, un effet euphorisant arrive, foudroyant pour le gamin que j’étais. J’adore, je suis mort de rire et complètement sous le charme. Le lendemain c’est Noël et je gâche le dîner de famille en faisant ce que je considère rétrospectivement comme ma première crise de manque. J’ai le singe, comme disent les Italiens. Je hurle, je pleure, j’en veux encore. Mais mon père, toxicomane sous méthadone depuis plusieurs années, analyse vite le problème. Hors de question, au lit ! Misère.
Première ivresse, 12 ans : au Pays Basque , une bande de « grands » de 18 ans qui font des paris entre eux pour savoir au bout de combien de gins tonics je serais torché. Ils me servent verre sur verre et en moins de 10 minutes, je dois en boire sept ou huit. Ils partent en soirée et me laissent derrière. C’est une révélation : j’ai trouvé ma voie, ce que je veux faire dans la vie. Je suis ivre mort.
Premières cigarettes, 12 ans : avec une fille de 15 ou 16 ans qui se la raconte un peu et m’impressionne. Elle me parle de ses soirées, de sexe. Des pétards. Elle m’achète mon premier paquet : des Fortuna rouge, 4,80 balles à l’époque ! Je me mets très vite à un paquet jour.
Premier pétard, 13 ans : avec une fille, Emma, dont je suis fou amoureux - une Italienne avec qui quelques semaines plus tard on « fuguerait » une semaine chez elle à Vintimille, rejoindre son père lui aussi toxicomane. On est dans un parc et je lui fais croire que je suis un habitué. Quand la première taf me brule, j’étouffe mon étouffement et fait le connaisseur : « Ouais, pas mal ».
13/14/15 ans : Déscolarisés, on fait ça avec plusieurs amis successifs - Zakaria, Nacim, Camille - sur plusieurs périodes : on fait la manche le matin - non pas que je sois miséreux mais à ce moment là en rupture avec ma mère et tout ce qui ressemble à une institution - on achète du shit et des clopes, un kebab chacun. On sniffe des trucs obscurs et pas chers : du déo, du détergent, et le must, de l’eau écarlate. Pour 2,50 euros la bouteille, tu shoot une famille pendant trois jours. On remplit des paquets de clopes en moins de trente minutes en taxant autour de Ménilmontant et on mélange de l’alcool fort de basse qualité avec des sodas sous-marque.
Première coke, 15 ans : on s’est cotisés pour un gramme à 70e. On sait pas doser, on est quatre donc on coupe en quatre, et hop plus plus rien. Sensation d’être électrifié tout en nageant dans la douceur. Heureusement que l’effet s’arrête au bout de 30min et qu’on avait tout tapé : on était en route pour aller se faire tatouer.
16/17 ans : « We jammin’ we jammin’ we jammin’ we jammin’ ». Toujours déscolarisé.
Premier exta, 17 ans : Trois jours de fête sans dormir sur les plages de Crête. J’ai rencontré Roonie, un Anglais dont le père s’est tiré avec une fille et a laissé son fils sans un rond mais avec un sac plein de MD en lui disant démerde toi, ça part bien ce truc dans le coin. Du coup on devient potes, et du coup il arrose. Là c’est le basculement : en rentrant en France s’ensuivent la première kéta, la première héro, le premier acide et les premiers champignons. Et tous ceux qui suivront.
17/18/19/20/21/22/23/24 ans : Toutes les merveilles précédemment citées et dans tous les sens. Paradoxalement, c’est aussi le moment de ma réintégration sociale. Je découvre le lycée, obtiens un bac, travaille un an comme animateur socio-culturel puis m’inscrit à l’université. Au début, la drogue m’a tellement aidé.
-
Je suis dialysé trois fois par semaine. On m’emmène chaque fois dans une vaste salle équipée de dizaines de vampires machiniques. Tous ceux qui sont là sont en insuffisance rénale chronique, sont des dialysés à vie ou en attente de greffe sur des années. Miroir peu rassurant : c’est ce que je risque. De devoir venir dans cette salle toute ma vie, trois fois par semaine pendant quatre heures me faire sucer le sang. Une fois branché, on ne bouge plus. On parvient à lire pendant la première heure puis on s’écroule, épuisé. Toujours cette sensation que la gravité augmente. Après ça, toute la journée, on est ce qu’ils appellent « fatigué ». Mais ça n’a rien à voir avec de la fatigue. On a le poids d’une montagne sur le corps. Parfois je ne peux plus rien articuler. Bon. Il paraît qu’à long terme on récupère mieux son énergie, et c’est vrai que j’en vois certains bondir hors du lit une fois débranchés, et repartir courir leur vie. On m’explique aussi que certains sont dialysés chez eux, que différents dispositifs existent. Qu’on peut vivre. Mais quelle vie ! Un jour sur deux foutu, impossible de s’éloigner, sauf à rigoureusement préparer son admission ailleurs. Fini l’impro. Restrictions alimentaires, liquides, médicamenteuses, obligation d’un contrôle total et de chaque instant de tout ce qui nous affecte. Fatigue permanente. Je les vois, pour la plupart, maigres, rachitiques, le regard angoissé et le dos plié, rabougris. Beaucoup d’amour sur eux. Beaucoup d’amour.
On m’explique que si je sors de l’hôpital et que je dois rester dialysé, ils enverront, trois fois par semaine, une ambulance pour venir me chercher chez moi et me ramener après. Je me dis que c’est fou ce que peuvent une carte d’identité française et une carte vitale, quand on sait le nombre de personnes obligées de s’exiler à cause d’une insuffisance rénale, en quête d’une dialyse gratuite sous peine de mort imminente.
-
Je commence à reprendre des forces. À marcher même. Hier, quelle aventure, je suis allé au bout du couloir. La kiné a dit que bientôt je pourrai descendre les escaliers. Can’t wait.
-
La musique me manque. Le sexe pas du tout. D’une manière générale, la musique m’a toujours apporté plus de satisfaction que le sexe.
-
J’alterne des moments de grande déprime et de grande excitation. L’effet cathartique continue de faire son boulot et le sevrage aussi. Au bout de deux semaines sans alcool, c’est la révolution dans mon esprit. Je n’ai jamais eu les idées aussi claires. Je lis, écris, fais des plans sur la comète, organise mes plans de bataille, prépare la guerre qui s’annonce. Parce que je sais qu’ici c’est facile, de ne rien consommer, et que ma sobriété n’est due qu’à un concours de circonstances. Que tout se jouera après. Néanmoins j’éprouve beaucoup de satisfaction, et un grand calme.
-
La drogue est tristement devenue indissociable du sexe, et inversement. J’ai commencé à adopter le chemsex, cette pratique qui consiste à prendre des drogues et avoir des rapports sexuels en même temps pour augmenter exponentiellement le plaisir des deux. Cette dernière année, combien de soirées qui ne pouvaient pas se terminer avant que j’ai trouvé une partenaire pour rentrer et partager ces longues heures d’extase ? A défaut, quand ça ne marchait pas, ces longues heures de masturbation et de drogue en solitaire, et ces réveils plein de dégoût et de haine de soi. Glauquissime. Le sexe est tellement bon sous stimulants qu’il est devenu pas évident d’être stimulé sans. Cette dernière année, mes quelques coïts sobres étaient sans saveur. Ça fera partie de ma rééducation.
-
Il faut tuer le temps. Je suis tombé sur la série Vikings. C’est incroyable de sexisme rétrograde et de virilisme commun. Pas un personnage féminin qui ne soit là pour densifier un personnage masculin : l’admirer le soigner le conseiller l’épouser le faire jouir l’attendre le consoler. A l’exception de certaines guerrières arborant tous les attributs de la virilité, certainement censées représenter des personnages de femmes fortes et émancipées mais ne dévoilant finalement que les fantasmes masculins de leurs scénaristes.
On regarde pour le héro, Ragnar Lothbrock, la série ne tient que par là. Le type a conquis l’Angleterre et la France juste avec ses yeux bleus et son triceps. Mais j’avoue, je craque un peu. Je regarde pour le voir, parce qu’il est magnifique. Juste ce qu’il faut de mystère pour m’obliger à cliquer sur « épisode suivant », parce que je veux le connaître, qu’il arrête de me torturer avec son sourire en coin. Je veux qu’il me regarde à son tour. Ai-je du désir pour lui ou est-il une transposition narcissique de moi même ? Quelle est la nature de cette jouissance masturbatoire que j’ai à le contempler ?
-
Quelle douceur ce matin, illuminé par les promesses de l’aube, l’esprit plus clair qu’à d’innombrables autres réveils.
J’entends Montreuil murmurer que la vie sera longue, que le futur est de retour.
Je découvre un fait étrange : le temps semble être une entité continue. C’est à dire qu’entre les jours il existe un chemin, un passage. Un sentier certes sinueux et terrifiant mais qui m’amène au prochain aurore, indemne.
Moi qui avait toujours cru que le monde mourrait chaque fois, pour renaître chaque jour encore plus fragile, sans doute jusqu’à disparaître totalement dans quelque flaque inodore.
Je découvre ce matin la nuit. Comme elle est longue ! Comme elle est belle et juste ! Alors que mon corps se désintoxique, vomissant toutes ces nuits qui n’en n’étaient pas, obscurités gesticulantes sous les pluies acides.
Je suis apaisé.
Je me rappelle ce que j’avais oublié : RIEN N’EST FINI, TOUT COMMENCE !
-
Je croyais que j’étais devenu débile, que mon cerveau était foutu. Détruites les cellules, disparues les connections neuronales ! Mais elles reviennent massivement et mon esprit devient une machine à produire des formes et du sens. Je ne peux plus dormir l’usine s’emballe je n’arrive plus à la saboter. Mauvais toto ! Je pensais que je ne penserais plus mais c’est juste que je ne pensais plus à penser ! Je suis comme Bruce tout puissant qui ayant trahi le devoir de Dieu en négligeant les prières des fidèles se voit envahi par elles et ne sait plus les ordonner. Il les transforme en post-it, j’essaye de les transformer en phrases. C’est toutes les années d’amnésie à écarter les problèmes qui reviennent se venger, organisées comme jaja en bataillons déterminés. Elles ne me laisseront plus l’occasion de fuir. C’est la guerre ! C’est un flux sans fin. Un sacré bordel. Mon abstinence sexuelle forcée qui en rajoute une couche. Mes nuits sont tourmentées par des délices pervers, c’est mon inconscient qui ne sait plus où foutre le foutre et qui appelle de ses voeux l’orgasme que je lui refuse. Vivre c’est bander, après l’amour on dort. Vertige : envie insoutenable de sauter dans le vide qui cohabite conjointement avec la terreur de le faire. Je suis menace, prêt à tout. Je suis volcanique.
T’es complètement hystérique ouais ! Allez, un Xanax et au lit.
-
Depuis que mon foie a montré des signes de rémission, cette crypto cure de désintox est devenue une potentielle orgie de drogues. Les médecins ne sont pas addictologues et j’ai le droit à absolument tout ce que je veux. Il suffit que je dise que j’ai mal quelque part pour qu’on me donne du Tramadol, que je suis angoissé pour qu’on me donne du Xanax, que je n’arrive pas à dormir pour qu’on me donne du Valium. C’est fou, accès permanent et illimité aux psychotropes légaux, le tout remboursé par la sécu et sans avoir besoin de fouiller les ruelles sombres. Il faut que je commence à m’auto-réguler et combatte le singe en moi qui en veut toujours plus.
Je garde certaines habitudes. De la même manière qu’il fallait toujours qu’il y ait à disposition une bouteille de vin pleine quelque part, même sans y toucher, pour rassurer mon singe, je prends des demi doses et cache un peu partout des demi Valiums, au cas où je tomberais sur une infirmière mal lunée qui déciderait que j’en demande trop. Je suis un écureuil qui planque des noisettes dans son arbre, en prévision des coups durs.
-
Les problèmes de drogue sont des problèmes inintéressants.
Ils se placent en écran entre soi et l’intérêt qu’on pourrait porter au monde.
Un petit voile misérable qui donne à l’existence un aspect fantasmagorique.
Une vie vautrée dans le plasma.
-
Ils décident de changer mon catétaire dialyse pour que je puisse gagner en mobilité, vraiment me mettre à marcher. On me renvoie en service de réanimation pour l’intervention. Encore une fois je tombe sur une interne et c’est sa première. Il s’agit de percer l’artère jugulaire, dans le cou, pour y mettre un nouveau tuyau, et de m’enlever celui à l’aine. Le couteau sous la gorge. Quand je lui demande si elle maîtrise, elle balance sa main d’un côté et de l’autre en se pinçant les lèvres, genre « plus ou moins ». Ce qui devait durer 10 minutes dure 1h30. Elle perce au mauvais endroit, puis n’arrive pas à percer l’artère. J’ai le visage recouvert d’un tissu stérilisé lui même recouvert de sang, je ne vois rien. Finalement, son supérieur prend la main et fait ce qui doit être fait.
Je suis paralysé du cou pour deux ou trois jours. J’attend une heure encore que le brancardier arrive pour me remonter.
-
C’est la dialectique autonomie - dépendance qui opère dans le corps comme dans la lutte.
-
J’ai beaucoup d’absences. Tout à l’heure après avoir mangé je suis allé dans la salle de bain pour me laver les mains. J’ai bien mis deux minutes à me rendre compte que je me lavais les dents.
-
On ne nous implique pas du tout dans le processus de guérison. On pourrait rester allongé sans rien dire à espérer guérir. Le dispositif hospitalier est complètement infantilisant. On nous donne des cachets sans prendre la peine de nous dire de quoi il s’agit. Il arrive même que quelqu’un entre et vous pique sans vous expliquer pourquoi. Je saoule les médecins avec mille questions que je consigne dans mon cahier pour ne pas les oublier, les pensées étant tellement fuyantes ces temps ci. Je veux tout comprendre, j’essaye d’avoir le plus possible de maîtrise sur la situation et les médecins n’aiment pas ça.
-
L’addictologue de l’hôpital passe. Elle me regarde gravement derrière ses grandes lunettes carrées et son masque. Une voix qui se veut douce et rassurante qui me parle comme à une brebis égarée. « Comment ça va ? » « Ça va oh ! »
Elle m’invite à poser des questions. C’est bien la seule alors pourquoi pas mais je la préviens : si je commence à poser des questions je peux devenir chiant. Est ce qu’elle a des réponses déjà ?
- Posez toutes les questions que vous voulez
- Qu’est ce qui caractérise spécifiquement une drogue ? C’est quoi l’addiction ? Le cerveau est une machine psycho-stimulée par tous les détails du monde. Il sécrète des endorphines au contact de n’importe quel plaisir. L’amour, le sucre, l’aventure, une tasse de café au réveil, le chant des oiseaux sur le lac du Chammet, le regard de Loretta qui comprend tout. Toutes ces substances meuvent en moi des neurotransmetteurs. Décharge d’adrénaline, libération de sérotonine. Je crois qu’il est impossible de trouver une « ontologie » des drogues du point de vue de la psycho- activité. On pourrait dire que la drogue est essentiellement un agencement juridique, sémantique et répressif situé dans une structure sociale déterminée. Il y a des gens qui retrouvent Cyril Hanouna tous les soirs comme on ouvre une bière. Si on prend l’exemple d’une rupture amoureuse, le sentiment de manque n’est il pas complètement caractéristique d’une drogue ? On pourrait dire que l’addiction c’est l’ensemble des habitudes, des affections dont quelqu’un a besoin pour tenir debout - mis à part les nécessités vitales, manger boire dormir. En quoi suis-je plus un drogué qu’un autre ?
- Vous voyez bien dans quel état vous vous retrouvez. Les drogues sont les produits qui affectent de façon nocive et directe votre vie psychique et votre organisme.
Super.
-
Je développe des réflexes de défense contre les infirmières qui me parlent comme des maîtresses d’école. Un jour, parce qu’en deux semaines d’alitement j’ai complètement fondu et qu’il faut que je me muscle, je suis en position de gainage au milieu de la chambre. L’avant du corps posé sur les avants bras et l’arrière sur le bout des orteils. Au moment où je lâche et mes genoux touchent le sol, une infirmière entre. « Monsieur Simon, mais qu’est-ce que vous faites ?! », « La prière, madame, la prière ! »
-
Mon oedème au sexe est devenu surdimensionné et invivable. Elles n’ont jamais vu ça dans le service, une horreur pareille, et ne savent pas quoi faire. Il faudrait faire remonter la peau au-dessus du gland mais elle est coincée en dessous du monstre et mes propres tentatives échouent, trop douloureuses. Elles font venir deux urologues qui « par chance » sont dans le coin. Ils disent pas de problème. Comme c’est très inhabituel pour le service, les médecins décident que c’est d’intérêt publique que les infirmières viennent voir comment ils procèdent. Et voilà que deux néphrologues et deux infirmières arrivent pour profiter du spectacle. Six médecins les yeux rivés sur ma bite et moi focus sur le soleil qui se couche loin sur Montreuil, je tente de faire en trois minutes ce qui est le travail d’une vie - faire le vide, atteindre l’éveil, trouver le Bouddah. Les deux urologues commencent une sorte de massage pour faire remonter l’oedème et sortir l’eau. Je mords mon poing, mon bras, tout ce qui est à porté de mâchoire. « Vous voulez qu’on fasse une pause ? » Non bordel allez y qu’on en finisse. Au bout de dix minutes la bataille est gagnée. Je souffle, trempé de sueur. « On va devoir vous circoncire Monsieur Simon ». Ma mère va être contente, elle va pouvoir appeler le rabbin et revendiquer ce qu’elle a toujours été convaincue d’être : une mère juive.
-
Je parle avec ma mère de mes lectures. J’évoque, avec prudence, combien Preciado me fait du bien et ouvre des possibles qui entrent en résonance avec mon sexe mutilé, dévirilisé. Sa perspective queer de désidentification, de désertion de l’identité me permet d’envisager des formes de démasculinisation, de construction d’une subjectivité autre, composée, multiple, joyeuse. Des mots qui permettent, et qui dores et déjà ont bousculé mon genre. J’ai plutôt eu l’habitude d’être confronté par des féministes à une permanente assignation. Je suis un homme cis, et c’est gravé dans le marbre sociologique. L’opération « d’allié » consiste alors à identifier en soi les comportements oppressifs, et à les annihiler. Il s’agit d’une soustraction dans l’être. Hors j’ai l’impression que pour affronter en moi la tentation du privilège, j’ai besoin de construire une perspective désirable, une nouvelle subjectivité qui subvertit l’oppresseur, le destitue. En même temps, il est trop facile de se fondre dans une abstraction, il faut savoir d’où on parle et où le patriarcat nous situe. Identifier les matérialités du rapport de force, social et intérieur. Ce n’est pas parce que le genre est une construction aliénante sans véritablement de fondement biologique qu’il suffit de décréter sa propre non- appartenance, ce serait nier l’évidence. Ce serait invisibiliser une nouvelle fois le discours de celles et ceux qui sont assignés femmes, et l’oppression spécifique qu’ils et elles subissent. Comment construire des lignes de fuite ? La masculinité, si elle occupe la place privilégiée dans le système sexe-genre, est tout autant assignation, normativité et mutilation du point de vu du corps singulier, et de la subjectivité en devenir. Comment construire un lieu où le libre jeu des formes-de-genre puisse s’exprimer, sans étouffer les différences ? L’identité peut elle être à la fois solide et soluble ?
J’ai pensé à voix haute et j’en ai trop dit. Ma mère, prenant comme toujours le parti de mes études : « Mais, Simon... Tu vas pas devenir une femme ?! Non. Tu vas devenir : ingénieur du son. »
-
Il va falloir un certain temps pour que mes yeux ressortent de leurs orbites. Ce sont des troglodytes, ils ont creusé des galeries dans mon visage et semblent se méfier de tout regard.
-
Je marche seul dans l’hôpital la nuit. Après 20h tout est désert, même plus personne à l’accueil. On dirait que c’est abandonné depuis un siècle. Étrange sentiment de liberté post-apo à traîner mes pattes à la vitesse d’une tortue dans un silence de mort, un silence pandémique. Je ne vais pas jusqu’à dire qu’il n’y a « pas un chat » parce que justement, seule âme qui vive, beauté absolue, merveille noire et blanche d’une symétrie type yin et yang, je me suis fais un ami félin. Ensemble nous avons fait un pacte et créé une société secrète : la camaraderie des rôdeurs nocturnes aux pelages ambigus.
-
Je suis englué dans mon père. Peut être comme tous les fils. Mon rapport aux drogues est hanté par le sien. C’est d’une clarté absolue. Hanté par l’admiration que j’ai voué à son travail, à ses dessins, à son humour et à sa solitude.
Le topo : comme souvent dans les couples hétéros modernes, après la séparation de mes parents quand j’avais sept ans, ma mère a pris en charge le réel. C’est à dire le temps plein le toit la bouffe l’école l’argent, ce genre d’inévitabilités. Et j’allais chez mon père le week-end, de temps en temps, profiter du temps libre et jouer avec lui. C’était plus permissif, moins anxiogène. Il habitait un atelier dans le quartier de belleville, tout en bois et en taches de peintures, rempli de petites choses partout, de photos de dessins d’objets de merveilles de livres et de couleurs. Une odeur sans équivalent de tabac froid et de transpiration qui reste encore aujourd’hui pour moi la plus agréable qui soit. Une odeur de liberté dans les sinus de l’enfant que j’étais. Artiste solitaire et totalement engagé dans son oeuvre, dessinateur brillant, lecteur assidu de Debord et des situationnistes, il vit son insurrection seul, au stylo et au RSA. Refus du travail salarié, refus du monde. Un peu de tout puis surtout héroïne puis surtout méthadone. Voilà mon héros, mon modèle, mon talisman. Adolescent, la brulure en moi qui nourrit ma colère et mon inadaptabilité. Je sais alors que la vie qu’on essaye de me faire vivre est un mensonge. Que la vie réelle, comme aiment dire les situs, est autrement plus intense. Elle est faite de beautés et d’extravagances, de mots d’esprit, de long discours sur les mensonges spectaculaires-marchands, d’odeur de tabac froid, et inévitablement, de drogues. Voilà je crois comment se noue la certitude inconsciente que la drogue fait partie du salut.
J’ai mis du temps à comprendre le revers de la médaille. Son manque de fiabilité, sa fuite. Sa méchanceté, ses problèmes d’égo. Et sa faiblesse, dont la drogue est à la fois cause et conséquence. J’ai mis du temps à comprendre le travail exemplaire de ma mère, protectrice dans l’ombre quand j’étais face au chaos. Néanmoins, je suis fier d’être son fils de façon irréductible. Tout chez lui m’habite. Son regard, sa malice, ses faiblesses. Je ne connais rien d’aussi beau que ses dessins.
A la fois pour ne rien oublier de ce qui se passe et me souvenir du danger, et pour arborer fièrement cette filiation, je viens de lui demander de me dessiner une machine-organe, pour me la faire tatouer. Pourtant je n’ai pas de tatouages et suis assez méfiant à leur égard. Il n’y a qu’une forme-de-lui que je voudrais inscrire dans ma chaire, finalement, pour rendre visible ce qui est déjà là.
-
Décilitre par décilitre, chaque jour la jauge urinaire augmente. Ça va aller. Mes reins récupèrent. On commence à me parler d’arrêter la dialyse. Je vais sortir. Une date est fixée. Je ne suis pas guéri mais je peux être convalescent chez moi, il n’y a plus de risque immédiat et je coûte cher à l’État. Dommage, je commençais presque à apprécier. Ne rien faire, être seul comme je ne l’avais pas été depuis longtemps, sentir mon corps se recomposer, composer, lire, tenir ce journal de confinement...
-
Bien sûr que la drogue n’est pas que néant, mensonge et bras soporifique du capital. Bien sûr que je la vomis, que j’ai besoin de la vomir.
Bien sûr qu’elle est merveilles et voyages. Surtout, qu’elle déplace. Elle bouge le cul des trop sûrs d’eux, remet en perspective. Elle désidentifie. Déstructure certitudes, appartenances et orientations sexuelles, propulse vers des possibles insoupçonnés. Elle fait nager dans ciels profonds ou voler dans des océans infinis. Elle permet la rencontre, réuni des bandes, accompagne l’amour. Donne la force d’affronter l’inafrontable, troque la faiblesse contre le courage ou détend l’hyper-activité. Tout ça est vrai et tout l’inverse aussi. Elle est source d’aventures ambivalentes. Ses forces sont aussi ses faiblesses. Certaines drogues nous affectent durablement, et il faut qu’elles soient accompagnées de travail, de rituels et d’attention. C’est une affaire sérieuse. Certaines ouvrent à des mondes complexes dans lesquels il faut savoir manoeuvrer, trouver son chemin dans le labyrinthe pour atteindre l’absolu en son centre. Chaque substance a son langage, ses possibles et ses écueils. Ce qui est destructeur, c’est une manière de s’y rapporter. C’est ce que les occidentaux en font, comme marchandises, comme milieux et finalement, comme drogues. Parce que rien n’est drogue en soi. Il y a des substances et des usages, des affects qu’on crée avec elles. La substance n’est qu’un élément d’un rhizome plus vaste, et ce n’est pas elle qui porte le coup fatal.
- Jours d’après, peut-être -
Te es Brumien - né au pays de Brume, où tous les êtres et toutes les choses sont sans contours. L’ennemi intérieur, le terroriste, est insaisissable. Vous êtes en guerre avec la vapeur. Dans cette lutte, tous les êtres et toutes les choses essayent sans relâche de prendre forme. De devenir. Mais l’inconsistance des sols embourbe toute tentative d’enracinement. Vous instituez dans les sables mouvants. Au milieu de la fumée, il y a les fumistes - ceux qui se donnent une forme-de-forme. Ils brillent quelques secondes d’un éclat terne puis rechutent dans l’hébétude dont ils étaient issus. Icarre.
Ils chantent soleil ardent mais brûlent flamme faiblarde. Où est chaleur constante ? Densité continue qui pèse le poids du pour-toujours ? Aime ! S’il te plaît. Applaudis toi mais pas trop fort. Écoute. Cris de rage impuissants des êtres intensifs, ils veulent trop vite le monde mais le monde se refuse à eux, alors prophétisent sa fin. À peine humides se croient tsunami. L’apocalypse ne se surfe pas. Concentre toi sur le sang qui circule dans tes artères, irrigue ton coeur. C’est lui ta vague. Pour inonder ta vie et submerger ton ennemi, concentre toi sur l’hémoglobine. Celui de la mère qui abreuve, celui de l’ami qui coule dans la bataille. Prends soin. Le communisme est tout proche. Primitif.
Marche sur ligne de crête. Ne laisse pas ton corps se répandre, mais cherche à gagner en amplitude. La crise de la présence n’est pas une crise de l’affirmation. Prends le temps. Ressens chaque centimètre, chaque seconde - grandes enjambées n’amènent nulle part. Rampe. Complote avec les insectes, lie toi aux détails. Construis machine de guerre micro-bactériologique. Nulle besoin de pénétrer, traverse ! Et sois traversé. Sois mille en restant un. Investis des territoires sans les envahir, la cartographie est un travail intime.
Chie du caca en forme de voilier, deviens anus-sculpteur. Toute la merde dans ton ventre est carrière de pierres précieuses. Creuse les galeries qu’il faut pour trouver saphirs et rubis, sans t’exploiter. N’exige de toi aucun rendement, aucune performance. Ne laisse pas ton regard sur le regard de l’autre te tyranniser. Tu n’as aucune valeur et pourtant toutes ces richesses. Communise les sans te trahir, sans te perdre dans le flux terrible de la communauté. Appartiens toi.
Catégorie : Tranche de vie - 24 avril 2023 à 11:47
#Livre #Vomir
1
Certes, ton style (dont je ne suis pas fan en premier lieu, étant plutôt du côté de la littérature classique) est en construction, - cela se sent dans certaines imperfections de tes tournures de phrases et d'autres détails syntaxiques - mais tu as déjà réussi à te forger une plume particulière. Rares sont les personnes qui y arrivent vraiment et nombreux sont les gens à croire qu'ils sont parvenus à le faire. On en voit passer pas mal ici.
Ton édition est largement méritée, on sent que c'est bossé et que c'est pas des mots que tu as balancé à l'arrache en te prenant pour un poète nouvelle génération. J'ai beaucoup aimé notamment les petites piques en filigrane au gauchisme et à la bourgeoisie.
Force à toi et un grand meci!
Dur de faire un commentaire à la hauteur du texte. Cest tellement au-dessus de ce que je peux faire que ça serait ridicule. Tu joues dans la cour de grands ! On se sent tout petit, on n'ose pas :)
Ah si, l'expression "englué dans mon père", putain c'que c'est bien trouvé.
Le rendu est superbe, l'ambiance super bien restituée, on s'y croirait, on est transporté en pleine immersion, dans les moindres détails. La trivialité du corps et de ses fluides, la perte de dignité, la déshumanisation, les infirmières qui te parlent comme à un gosse, ou qui t'engueulent quand tu appelles, les médocs qu'on te donne sans te dire ce que c'est, et ça fait chier les infirmières si tu demandes, le code couleur des blouses, le bâtiment désert la nuit, etc. Y a plein de trucs qu'on perçoit quand on y est, mais dont ne prend conscience qu'en te lisant. Genre le truc des couleurs mornes communes aux "lieux officiels du soin, de l’éducation et du bien être", maintenant que tu le dis, ça parait évident, j'avais déjà remarqué en fait, mais j'aurais pas pu le formuler consciemment.
L'idée que c'est pas parce que le genre n'a aucun fondement biologique que c'est simple de renier son appartenance : bien vu. Et mention spéciale pour la perspective désirable vs la soustraction dans l'être, ça me parle ça !
Encore merci du partage.
Force à tes reins et au reste :)

Texte absolument magnifique et incroyable.. J'ai adoré !
Un énorme merci, portes toi bien !!!

Merci pour ce texte que j'ai lu d'une traite.
J'ai commander ton livre.
Carpe diem et bon courage.
Je me pose évidemment des questions sur la suite, je te souhaite encore des journées et des nuits qui se suivent pour ne former finalement qu'un long voyage.
A bientôt peut être sur le reste de ton blog,

Ma meilleure amie me l'a offert il y a de ça quelques semaines, autant dire qu'il a une place de choix dans ma bibliothèque.
Tout ce que je ressens sur l'existence, l'humanité, la prise de produits... résumé en quelques pages avec justesse et infinie finesse.
Lecture nécessaire, qui m'accompagnera jusqu'à la fin de mon existence (place de choix au côté de Demian, du grand Hesse). Merci pour tout, infiniment.

Dsl de faire ma fan girl hahah
J’espère que ça va au mieux que tu peux. J’ai hâte de lire un nouveau truc de toi, t’as un bon style.

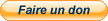 Soutenez PsychoACTIF
Soutenez PsychoACTIF