Les tatouages nous bloquent-ils dans le passé ?
Pas plus tard que hier, je regardais Alice au pays des merveilles. Lorsque le film fut fini, je fus parcouru d'une grande nostalgie, à la limite des larmes. Ce n'est pas le film en lui même qui m'a mis dans cet état, mais l'idée de me rendre de nouveau compte que chaque histoire, aussi merveilleuses soit elles, ont une fin. C'est douloureux de se dire que les meilleurs moments que l'on à vécu ne pourront jamais se revivre de la même manière que dans nos souvenirs. Bien sûr il faut avancer et vivre de nouveaux moments. Mieux ? Juste différent. Mais pourquoi tout à forcement une fin. Peut être que sans fin rien n'aurait de sens. Pour en revenir au tatouage, est-ce bien judicieux de s'ancrer à vu d'œil lorsqu'il s'agit d'un tatouage que l'on fait pour soi, un moment de sa vie qui est la représentation de ce genre d'histoire. Un histoire terminé dont il peut être parfois bon de se souvenir mais qui nous rappel à revivre constamment la nostalgie de ce qui fut mais qui ne sera jamais plus ?
Ou peut être ne s'agit il que de moi ? Peut être que les gens qui sont en paix avec eux même n'ont aucun mal à faire un petit saut dans le passé ? Qu'en pensez-vous ?
Précision : Je me suis permis de poser un post sur le tatouage après avoir vu que le premier post d'un blog de PA concerne ce même sujet, les tatouages (page 409 section blog)
Pour poursuivre un peu sur ma réflexion : Le tatouage n'ancre pas dans le présent. Je veux dire par là que la vie est en mouvement constant. Et de ce fait, puis que nous l'abritons, nous le sommes aussi. Nous ne sommes jamais le personnes que nous étions la veille. Et je me demande si s'accrocher à ces histoires n'est pas moyen involontaire comme inconscient d'aller à contre courant ? D'essayer de lutter contre le caractère éphémère de la vie, d'aller contre la mort.
Catégorie : Opinion - 27 novembre 2021 à 01:46
#passé #tatouage
1
La nature est faite ainsi, vie, mort, vie etc. Mais l'humain (au sens large et primitif) dans sa nature et son égo, cherche à contrôler ce cycle, à le fuir, il a peur des nouvelles expériences, et encore plus de la mort. Alors qu'elle fait parti de la vie. Beaucoup refuse de vivre sans le savoir car il refuse de mourir.
Pour le lien avec les tatouages, j'en ai plein, et qui sont comme des écrits de mon histoire, où je suis le seul a y comprendre les mystères et les significations.
Pour la plupart ils ont été comme des rites de passage pour accepté mon histoire et transcender cela. Ou pour me rappeler certaine notion que cette frénésie du monde peu faire oublier.
Mais j'ai aussi des tatouage qui ont de belle signification, pour la naissance et la vie de ma fille par exemple, ou sur le lien que je peux avoir la nature et le cosmos. Et je me rappel de tous ces beau moment qui sont certes en sois fini, mais qui ont maintenant évolué et qui sont emprunt d'autant de magie.
De mon point de vue, c'est une façon d'écrire son histoire sur soi. Et l'histoire n'est la que pour nous enseigner sur le passé. Même emprunte de nostalgie, c'est aussi accepter que cela est fini, et remarquer qu'avec le temps on a réellement grandi et évolué.
Dernière modification par ImNobody (27 novembre 2021 à 11:38)
J'imagine que regarder parfois en arrière ne signifie pas forcement faire du sur-place. Je comprend mieux désormais. Puis tu as l'air d'être vraiment à l'aise et au claire avec ça. Je suis content d'avoir pu changer ma perception, merci pour ça :)
Pour ma part, j'aime les tatouages sans être fan absolu, mais je m'en étais fait faire un, au pire de ma période de dépendance alcoolique. Il symbolisait plusieurs choses assez fortes pour moi (le signe pi). Beaucoup trop visible (partie visible du poignet).
Cette période de ma vie ayant été très sombre, presque léthale, j'en suis sorti et ce tatouage trop voyant ne me correspondait plus. Je l'ai donc fait enlever. On devine clairement la cicatrice cependant car le premier centre laser où j'ai commencé les séances n'était pas top apparemment.
S'il avait été à un autre endroit je pense que je l'aurais gardé. Je ne renie pas cette période, au contraire, je la regarde avec une sorte de fierté quand je vois ce que je suis devenu depuis et ce dont j'ai réussi à me sortir.
Mais là c'était trop voyant, trop moche -il deviait vers la gauche du poignet avec l'age (et pas top professionnellement). J'ai toujours la cicatrice comme souvenir

Non il nous bloquent pas mais y contribue, c’est comme quand t’écoute une musique à un moment marquant de ta vie, et que tu la réécoute après ça va te rappeler ce moment sauf que une musique c’est éphémère tandis que le tatouage est aussi éphémère mais jusqu’à à la mort en théorie, donc si tu te tatou un truc pendant une phase Breson de ta vie y’a de forte chance à parier que ce tatouage pourra te mettre mal à l’idée de le voir tant que tu n’aura pas fais un travail de résilience sur toi même et où cela ne t’importe plus mais t’évoque au contraire une force.
Regarde moi je me suis fais opérer, et pour moi les cicatrices sont les vrais tatouages de la vie, et elle me rappelle sans cesse ce moment où j’ai merder avec les opiacés mais aujourd’hui je regarde les cicatrices et j’en suis fière car j’ai réussis a passer au delà de ceci et je regarde en avant en étant fière de la merde dans laquelle j’étais et comment j’ai sus m’en sortir
Si je m'étais fait tatouer ce que je voulais quand j'avais 20 ans (typiquement l'âge où tu n'as pas forcement conscience du fait que tu vas évoluer tout au long de ta vie) je pense qu'effectivement aujourd'hui j'aurais tendance à me sentir soit un peu con de l'avoir fait soit je me serais enfermé dans cette symbolique/philosophie à cause de mon égo et donc j'aurais eu bien plus de mal à avancer.
Aussi les moments marquant de ma vie restent de ma tête (c'est le principe) donc je n'ai jamais ressenti le besoin de l'encrer sur ma peau, surtout que généralement c'est des trucs assez perso.
Du coup j'ai toujours envie de ma faire tatouer mais je ne sais pas quoi, les tatouages purement esthétiques ne m'intéressent pas (je préfère que l'artiste me dessine ça sur une toile
 ).
).En vrai on devrait attendre minimum 50 ans pour se faire tatouer

Figuration a écrit
Je suis fan d'Alice au pays des merveilles, que je regarde chaque année (le Disney), sans compter le livre bien sûr et autres. Ma fille s'appelle... je vous laisse deviner...
Pour ma part, j'aime les tatouages sans être fan absolu, mais je m'en étais fait faire un, au pire de ma période de dépendance alcoolique. Il symbolisait plusieurs choses assez fortes pour moi (le signe pi). Beaucoup trop visible (partie visible du poignet).
Cette période de ma vie ayant été très sombre, presque léthale, j'en suis sorti et ce tatouage trop voyant ne me correspondait plus. Je l'ai donc fait enlever. On devine clairement la cicatrice cependant car le premier centre laser où j'ai commencé les séances n'était pas top apparemment.
S'il avait été à un autre endroit je pense que je l'aurais gardé. Je ne renie pas cette période, au contraire, je la regarde avec une sorte de fierté quand je vois ce que je suis devenu depuis et ce dont j'ai réussi à me sortir.
Mais là c'était trop voyant, trop moche -il deviait vers la gauche du poignet avec l'age (et pas top professionnellement). J'ai toujours la cicatrice comme souvenir
Je pense comprendre également. Il y a une différence entre le fait de référer de temps à autre un souvenir et le fait de vivre à travers lui. J'imagine aussi qu'à force on ne fait plus autant attention au dessin ? Est-ce que tu remarques ta cicatrise à chaque fois tu passes tes yeux devant ou c'est devenu normal voir presque invisible ?
Anonyme813 a écrit
Si je m'étais fait tatouer ce que je voulais quand j'avais 20 ans (typiquement l'âge où tu n'as pas forcement conscience du fait que tu vas évoluer tout au long de ta vie) je pense qu'effectivement aujourd'hui j'aurais tendance à me sentir soit un peu con de l'avoir fait soit je me serais enfermé dans cette symbolique/philosophie à cause de mon égo et donc j'aurais eu bien plus de mal à avancer.
Aussi les moments marquant de ma vie restent de ma tête (c'est le principe) donc je n'ai jamais ressenti le besoin de l'encrer sur ma peau, surtout que généralement c'est des trucs assez perso.
Du coup j'ai toujours envie de ma faire tatouer
Je pense exactement la même chose ! Du coup je suis de nouveau perdu. J'imagine qu'il n'y pas une seule réponse, ça doit certainement dépendre des personnes tout simplement.
Parce que cette phrase résume littéralement mot pour mot la raison pour laquelle je ne me fait pas tatouer (même si comme toi j'en ai envie depuis ado) "je me serais enfermé dans cette symbolique/philosophie à cause de mon égo et donc j'aurais eu bien plus de mal à avancer."
Zopi7.5 a écrit
Les tatouages nous bloquent ils dans le passé ?
Non il nous bloquent pas mais y contribue, c’est comme quand t’écoute une musique à un moment marquant de ta vie, et que tu la réécoute après ça va te rappeler ce moment sauf que une musique c’est éphémère tandis que le tatouage est aussi éphémère mais jusqu’à à la mort en théorie, donc si tu te tatou un truc pendant une phase Breson de ta vie y’a de forte chance à parier que ce tatouage pourra te mettre mal à l’idée de le voir tant que tu n’aura pas fais un travail de résilience sur toi même et où cela ne t’importe plus mais t’évoque au contraire une force.
+ 1
Anonyme813 a écrit
Regarde moi je me suis fais opérer, et pour moi les cicatrices sont les vrais tatouages de la vie, et elle me rappelle sans cesse ce moment où j’ai merder avec les opiacés mais aujourd’hui je regarde les cicatrices et j’en suis fière car j’ai réussis a passer au delà de ceci et je regarde en avant en étant fière de la merde dans laquelle j’étais et comment j’ai sus m’en sortir
Je trouve que c'est pas tout à fait la même chose. La cicatrice que tu as eu à cause du moment ou tu as merdé a été j'imagine (involontaire). Or un tatouage est (généralement) volontaire. Je pense avoir saisie l'idée pour laquelle se faire tatouer peut nous aider à nos remémorer nos erreurs, d'en faire une force tout comme de ne pas les reproduire. Personnellement je penche plus vers la théorie de Cobe mais je viens de me rendre en répondant à Figuration qu'il n'y a pas probablement pas une seule réponse. Merci à tous de m'avoir aiguillé, profitez à fond de la vie ^^
Mais tout ça nourrit l'identité narrative donc est construite par chacun, sans chemin obligé. D'où des vécus différents. Amicalement
https://www.lepoint.fr/philosophie/rico … 6_3963.php
Paul Ricœur (1913-2005) analyse dans nombre de ses textes le grand détour que doit entreprendre le sujet pour revenir à soi. Avec cette démarche se trouve mis au jour un sujet qui représente davantage un point d'arrivée de l'effort philosophique que son point de départ. Mais qui est le sujet s'il n'est pas une vérité purement formelle ? Qui est celui qui se trouve en se comprenant et en s'interprétant ? Qui suis-je, moi qui dis « je » ?
À cette question, nous répondons spontanément en mettant en avant nos traits de caractère, nos façons d'être, bref, ce qui demeure fixe et nous identifie comme étant la même personne malgré les changements. Or cette forme d'identité a ses limites. Car, à strictement parler, la permanence dans le temps de ce que je suis ne permet pas de répondre à la question « qui suis-je ? », mais plutôt « que suis-je ? ». Ricœur, pour parer à ce glissement, propose de distinguer deux types d'identité : la première au sens de l'idem ou « mêmeté » (idem signifie « le même » en latin), et l'autre au sens de l'ipse ou du soi-même (on parlera alors d'« ipséité »). L'identité-mêmeté vaut pour tout objet qui subsiste dans le temps. Mais si tant est que le sujet n'existe pas simplement à la façon d'une chaise ou d'une pierre, son identité ne saurait se réduire à celle de l'idem. Elle renvoie plutôt à la dimension de l'ipséité qui se manifeste concrètement par le maintien volontaire de soi devant autrui, par la manière qu'a une personne de se comporter telle qu'« autrui peut compter sur elle ». Ce qu'illustre pour Ricœur la figure emblématique de la promesse dans laquelle j'engage d'abord qui je suis et non ce que je suis (c'est précisément au-delà de ce que je suis aujourd'hui que je m'engage à tenir parole).
Deux bouts de la chaîne
L'ipséité ne se substitue pas pour autant à la mêmeté du sujet, mais la complète. Et c'est ici qu'intervient l'identité narrative, c'est-à-dire ce qui déploie la relation dialectique unissant les pôles de l'idem et de l'ipse. Cette notion, qui apparaît pour la première fois chez Ricœur dans la conclusion de Temps et récit (Seuil, 1983-1985), repose sur l'idée que tout individu s'approprie, voire se constitue, dans une narration de soi sans cesse renouvelée. Il ne s'agit pas d'une histoire objective, mais de celle que, scripteur et lecteur de ma propre vie, « je » me raconte sur moi-même. L'identité personnelle se constitue ainsi au fil des narrations qu'elle produit et de celles qu'elle intègre continuellement. Ce faisant, loin de se figer dans un noyau dur, le « je » se transforme à travers ses récits propres mais aussi à travers ceux qui sont transmis par la tradition ou la littérature qui s'y greffent, ne cessant de restructurer l'ensemble de l'histoire personnelle.
Je viens de tomber sur ton blog et c'est drôle je me posais un peu la même question récemment.
J'ai 16 tattoo sur le corps, la plupart faits à l'arrache, ou sur un coup de tête, bourré ou défoncé : un mort-aux-vaches, des épées, un tramp stamp de feuilles de laurier (je te jure !), le lapin Duracell, un coeur en flamme raté fait à l'aiguille et encre de Chine... ma peau raconte sûrement une histoire mais laquelle, lesquelles ? Les tattoos racontent bien ce qu'on veut qu'ils racontent ; et je n'en regrette aucun. Une archive personnelle, des archives... On en revient à Ricoeur dont Prescripteur a mentionné, à juste titre, le nom et l'oeuvre.
Le tattoo c'est aussi une encre (une ancre ?) qui ne dit mot (sauf lettrages, bien entendu, et encore, pas sûr...), une image qui se passe de mot comme un agir, une douleur, un moment qui nous permettraient de nous soustraire au langage. Ils ne fondent en rien notre identité (de idem, "le même" en latin) mais notre circularité, notre imprévisibilité, notre indicible. Le tattoo est paradoxalement un trait unaire indélébile qui vient rappeler le trait d'union invisible entre soi et l'existence, trait d'union dont la peau est la première pelure et la plus importante. C'est pour ça qu'il n'a aucune valeur propre (il ne circule pas sauf dans le temps et le corps en mouvement, ne change pas de propriétaire, ne "dit" rien en somme que l'image qu'on en voit même s'il peut se prêter à l'équivocité, il ne fait pas oeuvre mais "moi-peau", il est donc, si on suit cette logique, toujours identique à qui on est, n'importe quand, n'importe où). Le tattoo ne rappelle pas la différence mais l'équivalence de soi à soi, équivalence autrement signifiée que par le truchement du langage habituel; aucune valeur donc sauf peut-être sentimentale (si on tient vraiment à "donner du sens-t'y-mental" ?). Pour botter en touche, carré noir sur fond blanc aurait dit Malévitch...
Amicalement,
J
Anonyme813 a écrit
Le tattoo est paradoxalement un trait unaire indélébile qui vient rappeler le trait d'union invisible entre soi et l'existence, trait d'union dont la peau est la première pelure et la plus importante. C'est pour ça qu'il n'a aucune valeur propre (il ne circule pas sauf dans le temps et le corps en mouvement, ne change pas de propriétaire, ne "dit" rien en somme que l'image qu'on en voit même s'il peut se prêter à l'équivocité, il ne fait pas oeuvre mais "moi-peau", il est donc, si on suit cette logique, toujours identique à qui on est, n'importe quand, n'importe où). Le tattoo ne rappelle pas la différence mais l'équivalence de soi à soi, équivalence autrement signifiée que par le truchement du langage habituel; aucune valeur donc sauf peut-être sentimentale (si on tient vraiment à "donner du sens-t'y-mental" ?). Pour botter en touche, carré noir sur fond blanc aurait dit Malévitch...
Amicalement,
J
C'est si bien exprimé, ça me fait plaisir de lire cela ici.
Psilosophia a écrit
Anonyme813 a écrit
Le tattoo est paradoxalement un trait unaire indélébile qui vient rappeler le trait d'union invisible entre soi et l'existence, trait d'union dont la peau est la première pelure et la plus importante. C'est pour ça qu'il n'a aucune valeur propre (il ne circule pas sauf dans le temps et le corps en mouvement, ne change pas de propriétaire, ne "dit" rien en somme que l'image qu'on en voit même s'il peut se prêter à l'équivocité, il ne fait pas oeuvre mais "moi-peau", il est donc, si on suit cette logique, toujours identique à qui on est, n'importe quand, n'importe où). Le tattoo ne rappelle pas la différence mais l'équivalence de soi à soi, équivalence autrement signifiée que par le truchement du langage habituel; aucune valeur donc sauf peut-être sentimentale (si on tient vraiment à "donner du sens-t'y-mental" ?). Pour botter en touche, carré noir sur fond blanc aurait dit Malévitch...
Amicalement,
JC'est si bien exprimé, ça me fait plaisir de lire cela ici.
Merci Psilosophia !
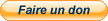 Soutenez PsychoACTIF
Soutenez PsychoACTIF